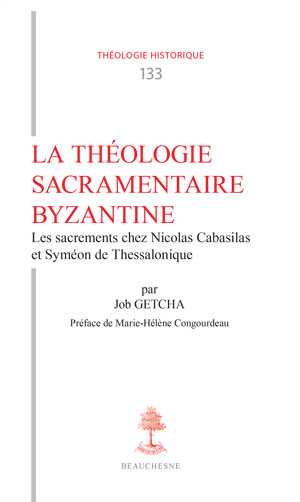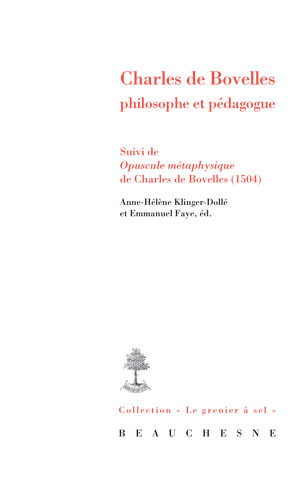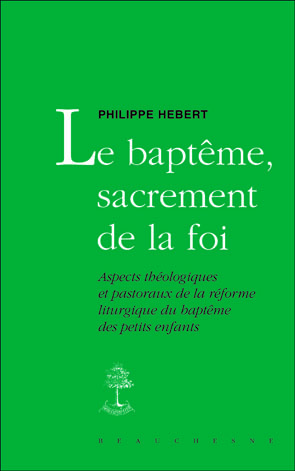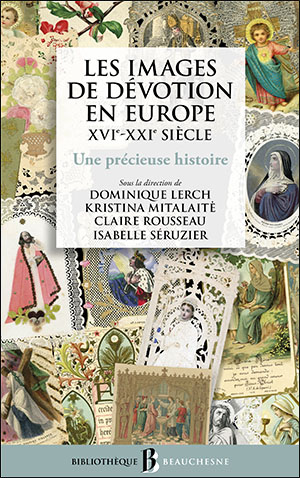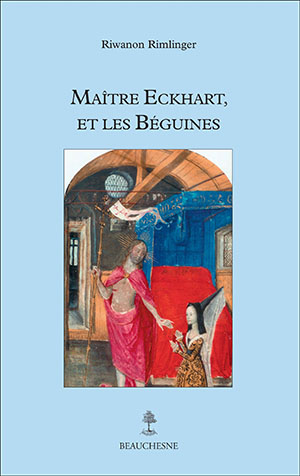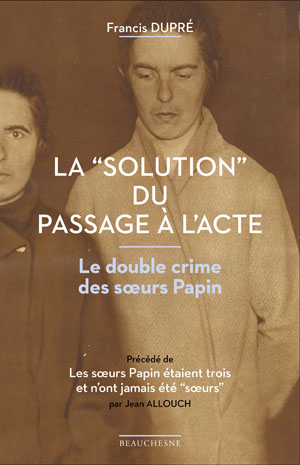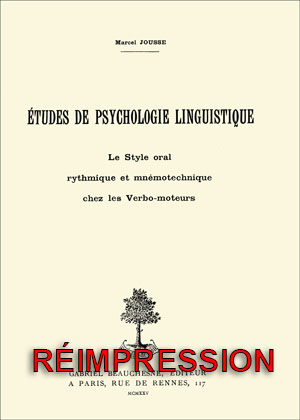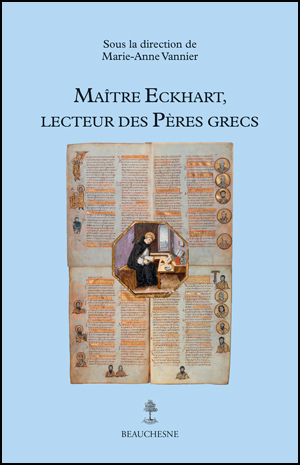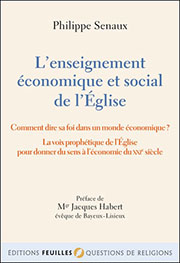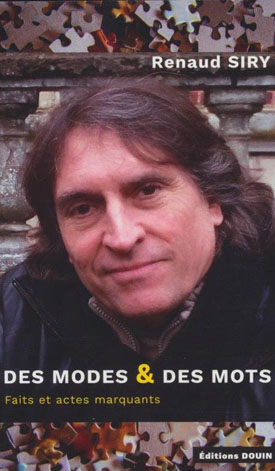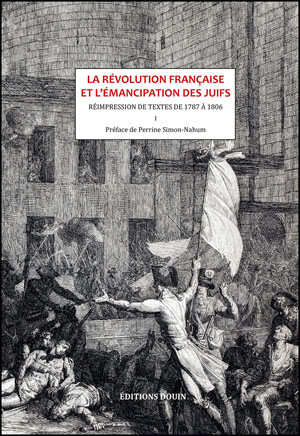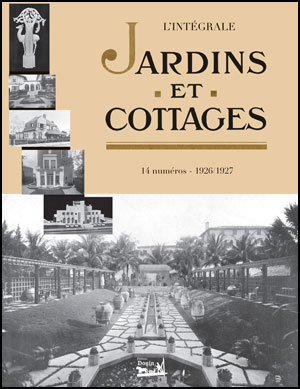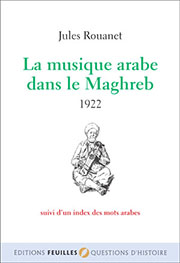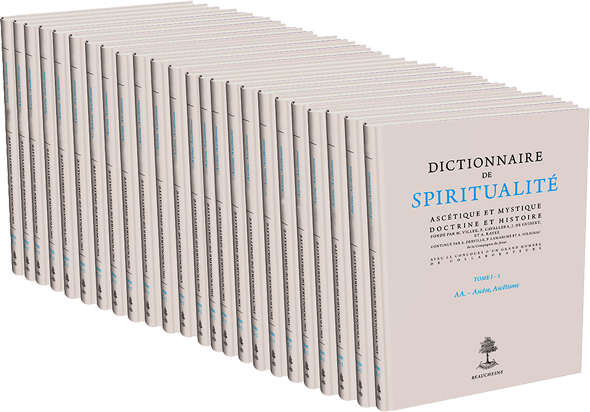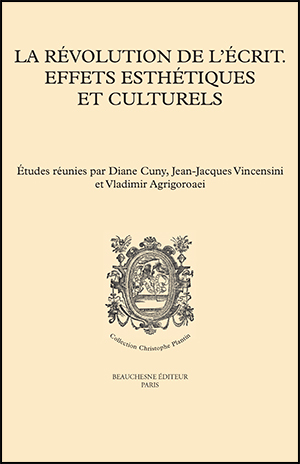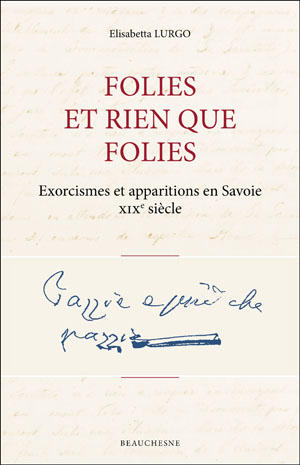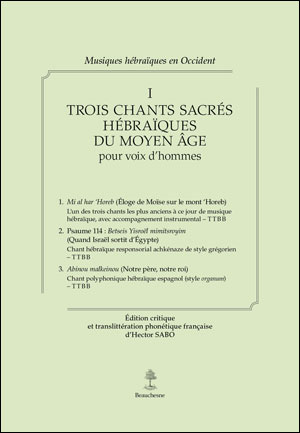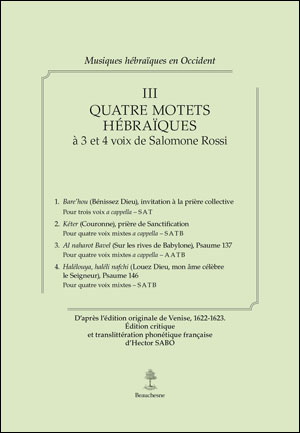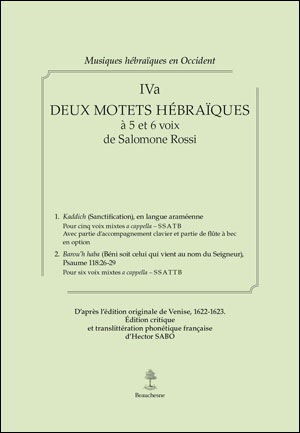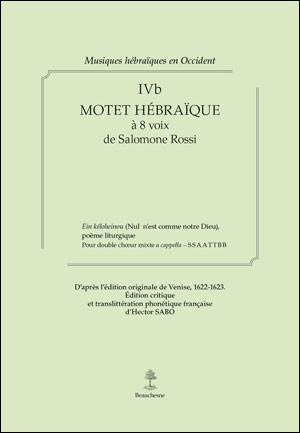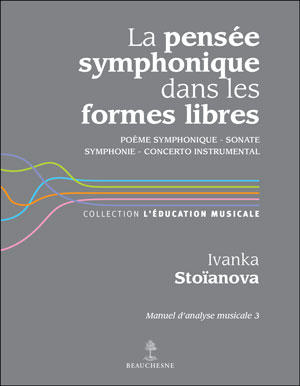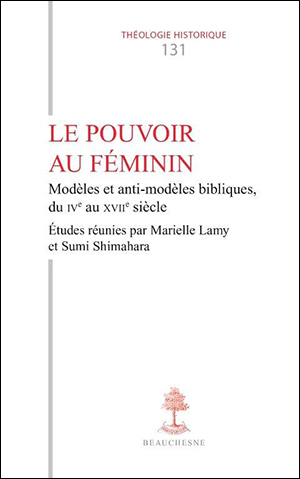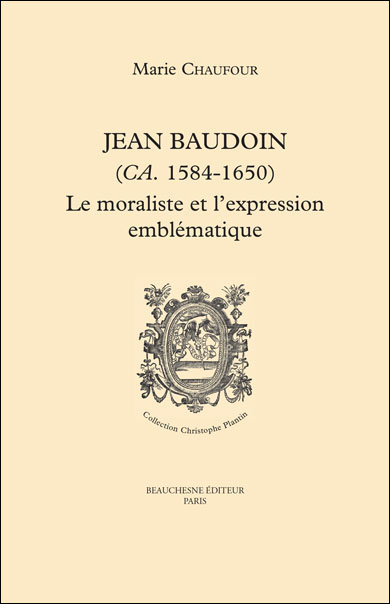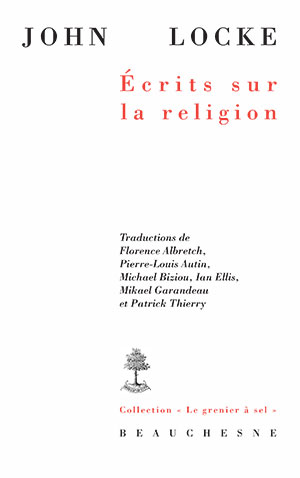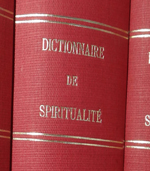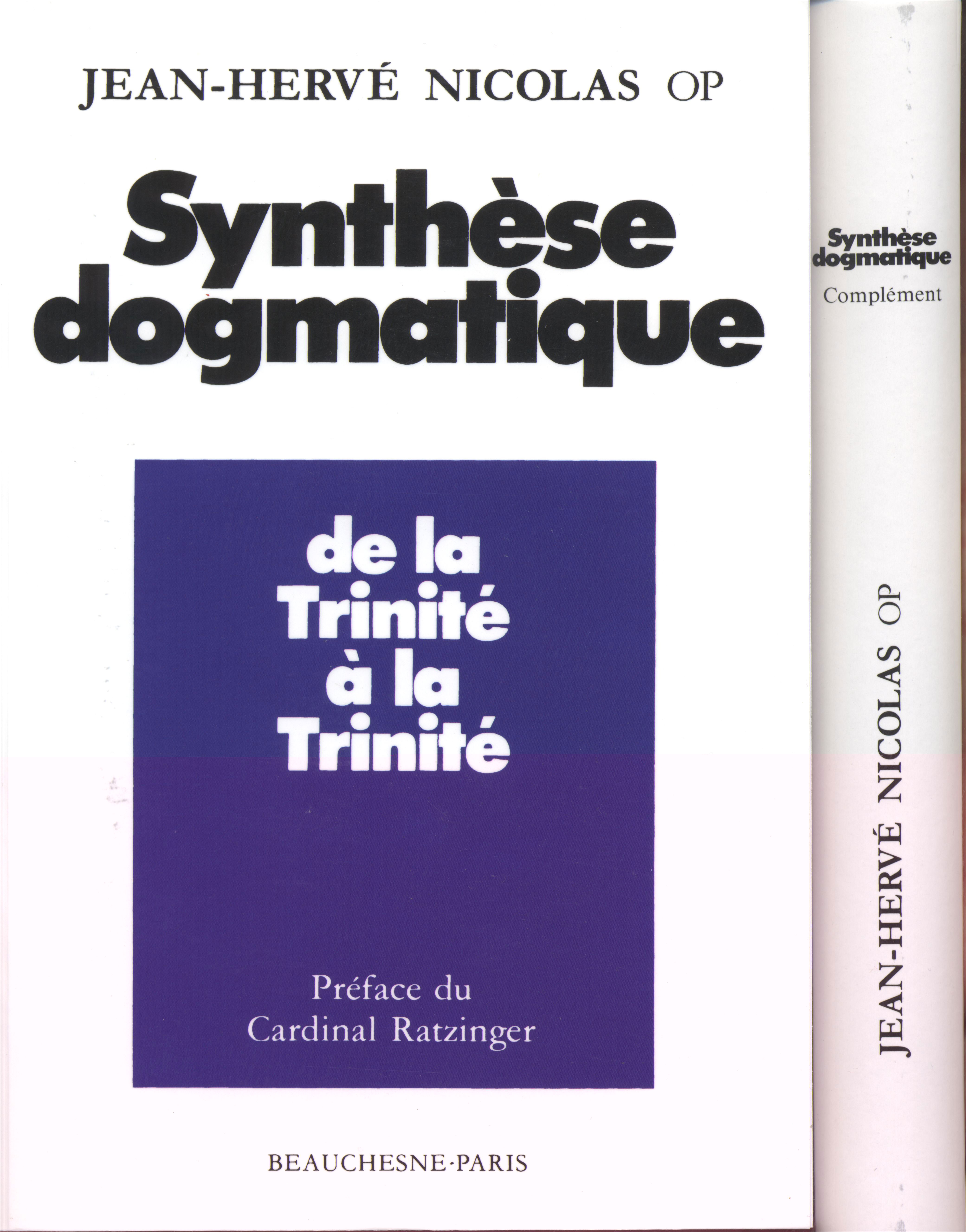74.00 €
TH n°013 L'ÉGLISE PRIMITIVE FACE AU DIVORCE
Date d'ajout : mardi 06 juin 2017
par Louis de NAUROIS
REVUE DE DROIT CANONIQUE
On ne peut qu'admirer l'érudition et la probité de ce savant ouvrage.
Il n'est certes pas d'une lecture facile, ni distrayante, mais comment eût-il pu en être autrement, compte tenu du projet de l'auteur, passer en revue les textes patristiques concernant l’attitude de l'Église, jusqu'au 5e siècle, face au problème du divorce. Il était communément admis, jusqu'il y a peu, que cette attitude était négative ; mais récemment un courant s'est manifesté en doctrine, qui interprète autrement qu'on ne le faisait d'ordinaire les textes connus, ou prétend en citer d'autres en sens inverse, d'où résulterait qu'il n'existe pas de tradition ferme en la matière ; ce qui permettrait un « renversement de vapeur » de la part de l'Église, avec admission possible de la dissolution du mariage (au delà des cas aujourd'hui acceptés, mariage non consommé et mariage non sacramentel) sans rupture avec la tradition. Le P. Crouzel entend faire une étude exhaustive des textes disponibles, les examiner minutieusement, interpréter les textes peu clairs en fonction du contexte, de manière à présenter un dossier complet et indiscutable. La conclusion il 1aquelle il arrive est ferme. A part quelques rares exceptions nettement isolées, et qu'il est au surplus souvent possible de récuser parce qu'elles constituent non des témoignages sur la pensée commune de l'Église mais des opinions personnelles des auteurs de ces passages (Ambrosiaster notamment), et en dehors de quelques obscurités, la doctrine des Pères jusqu'aux occidentaux du Ve siècle est constante : le remariage n'est pas permis, après séparation, même si cette séparation est causée par l'adultère de l'un des conjoints (ou si l'un d'eux n'est pas chrétien ; le « privilège paulin » n'est pas encore admis).
Les difficultés d'une telle tâche étaient nombreuses : certains textes sont altérés, ou bien nous en possédons plusieurs versions divergentes, et la reconstitution du texte authentique est malaisée. La pensée de certains Pères est, pour nous occidentaux du XXe siècle, difficile à saisir. Comment toujours savoir si un auteur parle en son nom personnel et comme exégète, ou comme témoin de la pensée de l'Église de son temps ? Comment, en présence d'un doute, reconstituer le contexte dans lequel il convient de replacer le texte pour l'interpréter correctement, contexte de l'auteur et contexte de la discipline générale de l'Église ?
Le problème est traité par les Pères de l'Église dans la perspective de l'Écriture et plus spécialement du Nouveau Testament, saint Paul et Évangiles. Le principe est net, la répudiation suivie de remariage est interdite en règle générale. Il ne pourrait y avoir d'hésitation que pour le cas d'adultère (laissons de côté le cas du mariage d'un chrétien avec un non baptisé). En ce cas la répudiation est parfois imposée mais très rares sont les Pères qui autorisent le remariage ; quelques-uns l'interdisent explicitement ; un nombre non négligeable de textes ne formulent que le principe général de l'interdiction du remariage, sans se prononcer sur le cas d'adultère. C'est ici surtout que l'interprétation du P. Crouzel diffère de celle proposée par quelques auteurs récents, par référence au contexte, celui des auteurs eux-mêmes et plus encore, me semble-t-il, celui de 1a discipline générale de l'Église. S'il y avait exception pour le cas d'adultère, elle serait clairement exprimée, comme elle le sera ultérieurement pour les Églises d'Orient. Le premier à aborder la question est Hermas ; il interdit nettement au conjoint de la femme adultère de prendre une nouvelle épouse après la répudiation. L'A. montre que ce qui nous choque aujourd'hui n'a rien de surprenant à l'époque envisagée : la répudiation de la femme adultère est permise, voire obligatoire, sans que le remariage soit autorisé. Voilà, si j'ai bien compris l'ensemble de l'ouvrage, le point sans doute le plus important. Je n'ai pas qualité, n'étant pas patrologue, pour ajouter mon grain de sel au débat. Dire, comme je serais tenté de le faire, que la position de l’A. me semble reposer sur une forte probabilité, sans entraîner totalement ma conviction, n'ajouterait rien aux arguments de ses adversaires ni n'enlèverait rien aux siens. Je me contenterai donc de quelques remarques, pas nécessairement critiques, sur des points particuliers.
Les auteurs contemporains que combat l'A. disent ceci, entre autres raisons pour admettre plus ou moins largement la permission du remariage, au cas notamment d'adultère : les Pères qui ne font pas explicitement état de cette exception la laisseraient cependant sous-entendre ; ils ne s'exprimeraient pas plus clairement par souci pastoral de ne pas sembler encourager ou faciliter le remariage, interdit hors de ces cas. De fait, il s'agit parfois (pas toujours, et l'argument ne vaudrait alors pas autant) d'homélies, genre oratoire qui ne se prête guère à la casuistique. Le P. Crouzel répond avec feu : « peut-on concevoir des vérités évangéliques (ici la permission du remariage) qu'on ne veut pas dire aux chrétiens de peur qu'elles ne les dépravent ? Peut-on imaginer qu'un pasteur, continuellement confronté aux difficultés matrimoniales des fidèles... hésite à exprimer clairement la doctrine qui pourrait les libérer ? » (p. 361). L'argument n'est pas pleinement convaincant : on ne trouve guère, aujourd'hui, dans les sermons, lettres pastorales ou discours divers, d'allusions aux « dispenses » de mariage non consommé ou non sacramentel, et la concession des dispenses de mariage non sacramentel est subordonnée à la garantie que l'opinion publique n'en déduira pas que l'Église favorise le divorce. Il reste, il est vrai, que l'historien qui, dans quelques siècles, étudiera notre époque contemporaine aura à sa disposition les documents administratifs relatifs, précisément, à ces dispenses…
L'A. souligne justement la nécessité de ne pas transposer indûment dans notre langage canonique contemporain les termes employés ici ou là par les pères de la primitive Église. « Dissolution » du mariage signifie aujourd'hui permission du remariage. Il est parfaitement clair dans certains textes qu'il n'en allait pas de même autrefois ; or on peut penser que, tous les pères ont employé le terme dans le même sens. Il est légitime d'en conclure que lorsque les Pères emploient le mot « dissolution » cela n'implique pas que le remariage était permis… , même si l'interdiction n'est pas explicitement formulée. Mais peut-on aller plus loin et dire que puisque la « dissolution » ne comporte pas par elle-même le pouvoir de se remarier reconnu à l'un des époux ou aux deux, par là-même elle ne le comporte jamais. Ce n'est pas évident (je ne pense du reste pas que l'auteur le dise). Je dirai surtout ceci à propos de la nécessité de ne pas transposer le sens des termes d'une époque à l'autre : nous distinguons aujourd'hui nettement entre empêchements dirimants et simplement prohibitifs, la sanction étant la nullité pour les premiers, non pour les seconds. Nous ne trouvons pas trace de cette distinction chez les Pères. Mais alors les interdictions qu'ils formulent à propos du remariage correspondent-elles nécessairement à ce que nous appelons, aujourd'hui l'empêchement dirimant de lien. A lire tel ou tel texte pastoral contemporain, ou peu ancien, on penserait volontiers que l'Église met sur le même plan les mariages « mixtes » (au sens strict, entre catholique et baptisé non catholique) et les mariages « dispars » (entre catholique et non baptisé) conclus sans dispense d'empêchement ; seuls pourtant les seconds sont nuls. Pour l'ancienne Église, il semble clair en certains textes que l'interdiction a pour sanction ce que nous appelons aujourd'hui 1a nullité du second mariage (pour bigamie) ; on parle en effet d'union adultérine (ou entachée de bigamie). Mais c'est beaucoup moins net en d'autres textes. Peut-on alors voir en chaque cas d'interdiction de remariage ce que nous appelons aujourd'hui empêchement dirimant sanctionné par la nuI1ité , L'A. ne semble pas s'être posé la question.
On en arrive ainsi à une question très vaste : avons-nous la certitude que la discipline de l'Église ancienne était unanime ?
Malgré ces menues chicanes, la lecture de l'ouvrage me laisse bien sur l'impression qu'au minimum et malgré quelques imprécisions ou obscurités la primitive Église était résolument hosti1e aux secondes noces du vivant des deux époux (elle l'était même parfois après la mort de l'un d'eux) ; l'hésitation, le cas échéant, ne me semble possible qu'au cas ,de répudiation pour adultère.
Le P. Crouzel a entendu présenter avant tout un dossier ; il n'a cependant pas omis d'aborder, en fin de son ouvrage, la question d'actualité de l'attitude de l'Église en présence des divorcés civilement remariés, à la 1umière .de ses conclusions sur l'attitude de l'Église primitive en face du divorce. Une question liminaire est de savoir dans quelle mesure nous sommes, aujourd'hui, liés par cette attitude de l'Église primitive, en pensant avec l'A. qu'elle est de refus inconditionnel de tout remariage du vivant des deux époux. L'A. l'admet, (p. 382) ; quelques réserves me semblent légitimes. Les hésitations des siècles qui ont suivi ceux étudiés, et l'évolution admettant progressivement la dissolution au cas de non-consommation et de mariage non sacramentel (cf. les études de MM. Gaudemet, Franzen & Huizing dans Le lien matrimonial, Revue de droit canonique, T. XXI, u. (1-4, 1971), déjà, permettraient peut-être de mettre en doute l'existence d'une véritable « Tradition » s'imposant comme telle. Le P. Crouzel ne s'est pas contenté d'étudier l'attitude de l'Église primitive face au divorce (dissolution avec permission de remariage du vivant des deux époux), il a également abordé la question des secondes noces après veuvage, et montré que certains pères leur étaient plus ou moins fortement hostiles. Ceci montre que le mariage n'était pas toujours, dans la primitive Église, tenu dans l'estime dont il jouit aujourd'hui. Pour admettre l'autorité, aujourd'hui, de la discipline de la primitive Église, ne devrait-on pas tenir compte de la différence des « climats » ? S'en tenir au « dispositif » de la discipline de l'Église primitive en négligeant les « motifs » s'impose-t-il ? Mais voici à présent ce que je voudrais souligner, en juriste : le contexte, dans lequel se présentent les textes du Nouveau Testament et de la discipline de l'Église primitive est celui du divorce par répudiation unilatérale ou par consentement mutuel ; notre contexte contemporain est, ou pourrait être, celui de la dissolution du mariage prononcée par une autorité publique (l’Église, pour les catholiques, l'État, ou l'autorité religieuse dont ils se réclament, pour les autres), pour des causes précises ; c'est, tout autre chose. Indissolubilité « intrinsèque » dans le Nouveau Testament et la primitive Église, cela implique-t-il nécessairement indissolubilité « extrinsèque » ? J'entends bien que dans les législations anciennes les causes de répudiation étaient ou pouvaient être limitées, et que leur existence était ou pouvait être contrôlée ; que de nos jours, de fait, on en arrive souvent, par divers moyens, au divorce par consentement mutuel. La différence reste, théoriquement au moins, importante entre le divorce condamné par les Pères, et celui que l'on pourrait concevoir aujourd'hui. Je regrette que le P. Crouzel n'ait pas abordé la question.
Comme beaucoup de canonistes, théologiens ou pasteurs d'aujourd'hui, l'A. se résout pourtant difficilement à admettre la situation douloureuse des divorcés civilement remariés quand ils sont profondément chrétiens (ce qui n'est pas du tout rare). Quelle « solution » trouver pour leur venir en aide ? D'abord « disparition de la présomption canonique en faveur du mariage, c'est-à-dire que dans le cas de doute sérieux sur la validité, sans cependant de preuves juridiques suffisantes pour emporter l'évidence, la question pourrait être résolue, soit par les juges ecclésiastiques, soit par un indult pontifical, au bénéfice des personnes plutôt qu'à celui des institutions » (p. 381~82). Quelques remarques s'imposent. Personne, en premier lieu, n'exige « l'évidence » de la nullité pour le prononcé de celle-ci ; ce qui est requis, c'est la « certitude morale », et c'est autre chose que l'évidence. Ensuite, on peut en effet concevoir un certain assouplissement du système des preuves externes et juridiques (dès maintenant, on constate le crédit plus grand fait par les tribunaux ecclésiastiques à la déposition des parties sous la foi du serment). Point n'est besoin, dans cette perspective de la certitude morale et des modes de preuve admissibles, d'un recours à un indult pontifical pour le prononcé de la nullité. Enfin, il me semble radicalement impossible d'aller plus loin (si tant est que l'A. le demande). La décision risquerait d'être « constitutive » d'un état de droit nouveau, et non plus « déclarative » d'un état de droit existant, et alors elle contredirait le principe même de l'indissolubilité, et camouflerait derrière un constat de nullité ce qui ne serait en réalité rien d'autre qu'un divorce. Il n'y a en effet dans la présomption à renverser rien de particulier au mariage. Le principe actori incumbit probatio est de portée générale, et la règle standum est pro validitate n'en est qu'une application parmi beaucoup d'autres. Renoncer à ce principe et à cette règle, ce serait détruire tout l'ordre social, ruiner toute sécurité juridique, se livrer à l'arbitraire du juge, avec tous les dangers que cela comporterait. Prendre en considération les personnes plutôt que les institutions, ce serait admettre que dans tel cas particulièrement intéressant la nullité serait prononcée bien que la certitude morale de la nullité ne soit pas acquise, et refusée dans tel autre cas identique juridiquement, mais moins « intéressant ». Et si l'on pose en principe que tous les cas sont intéressants (et ne le sont-ils pas effectivement tous ?), ce serait renverser purement et simplement la charge de la preuve et admettre que c'est au défenseur du lien de démontrer la validité du mariage pour la seule raison que les époux ne s'entendent pas, au delà de ce qui est dès maintenant acquis ou admissible quant aux présomptions de fait, et notamment parmi celles-ci les relations entre les époux après la célébration du mariage comme mode de preuve des dispositions des fiancésnau moment de la célébration (liberté, réticences diverses) ; autrement dit ce serait faire de ce qui est présomption de fait une présomption de droit. Ce serait donc passer de l'indissolubilité à la dissolubilité car, chacun le sait, la présomption de droit a précisément pour but de permettre au juge de faire comme si ce qui n'a peut-être pas été, ou a peut-être été, a certainement été, ou n'a certainement pas été. Concrètement, ce serait mettre en doute, plus ou moins arbitrairement, la sincérité, la liberté des époux au moment du mariage, alors que les relations sociales sont nécessairement fondées sur la présomption que chacun, quand il agit, le fait librement et en connaissance de cause.
II est vrai, hélas, à exiger la preuve juridique de l'existence d'un cas de nullité on court de risque de refuser la déclaration de nullité, en l'absence de preuve juridique, alors qu'il y a peut-être pourtant nullité. La seule possibilité d'y remédier consiste alors, et c'est là le vrai problème, à faire confiance aux affirmations des époux ; ce n'est malheureusement pas toujours possible, et l’appréciation des cas où c'est possible reste hasardeuse. Quelque solution qu'on adopte, il y aura toujours des risques d'erreur, inévitablement. J'admets du reste qu'on prenne le risque de la mauvaise foi, et qu'on renvoie les parties à leur conscience, en certains cas. Mais c'est là, me semble-t-il l'autre chose que ce que préconise le P. Grouzel.
Bien des cas de désunion se présentent alors que le mariage est incontestablement valide, et que cette validité n'est pas niée par les époux désunis. Seconde voie de salut suggérée par l'A., par conséquent, pour ceux qui, après divorce, contractent une seconde union civile, en partant cette fois de quelques précédents patristiques : « tolérer dans une certaine mesure, bien qu'elle soit adultère, une union conclue devant les instances civiles et qui ne peut être rompue par suite des responsabilités qui en découlent » (p. 382) ; ces responsabilités concernent en particulier l'éducation des enfants nés de cette union. De quelle « tolérance » s'agit-il ? L'Église ne considère ni ne traite des divorcés remariés civilement comme des « réprouvés », la « pastorale des divorcés » est, fort heureusement, à l'ordre du jour. Les quelques inhabilités prévues par le code ne sont pas très « méchantes », et on peut les adoucir encore. « Cette tolérance ira-t-elle jusqu'à réadmettre aux sacrements de pénitence et d'eucharistie des divorcés remariés » (p. 382) ; il s'agit évidemment de ceux qui sont de fait dans l'impossibilité de se séparer, comme de vivre comme frère et sœur, cas nullement chimérique. Je ne vois guère, concrètement, qu'il puisse s’agir d'autre chose.
« Comment enlever à cette mesure toute ambiguïté devant l'opinion publique ? » (p. 383). Je répondrais volontiers ceci : d'une part, l'opinion publique n'est pas en cause dans la mesure où les sacrements sont administrés secreto ; d'autre part et surtout, si la mesure est légitime, il faut éduquer l'opinion publique ; si elle ne l'est pas, il ne faut pas la prendre; ainsi, c'est le fond de la question qu'il faut débattre, et pour le faire, il faut poser complètement le problème. Il était admis jusqu'à présent que pour être admis aux sacrements de pénitence et d'eucharistie il fallait non seulement regretter ses fautes passées et n'être pas en état actuel de faute « formelle », mais encore n'être pas en situation « matériellement » « irrégulière » ; cet état matériellement irrégulier suffisait à justifier l'exclusion des sacrements, fût-il exempt de faute formelle actuelle. Telle est bien en effet parfois la situation des divorcés civilement remariés (il n'y a pas de faute formelle à faire ce que l’on ne peut pas ne pas faire, et nous admettons, par hypothèse, que certains divorcés remariés ne peuvent pas se séparer, ni vivre comme frère et sœur). Est-il théologiquement possible de renoncer à la dernière condition, et de se contenter pour l'admission aux sacrements du regret des fautes passées et de l'absence de faute formelle actuelle ? Je n'ai pas à le dire. Remarquons simplement ceci : d'une part, cette admission aux sacrements de certains divorcés remariés civilement, positis ponendis, conduira inéluctablement, en fait, à mettre sur le même plan, et ceci non simplement devant l'opinion publique, ceux de qui l'union est illégitime, et ceux de qui elle est légitime ; on aura beau alors proclamer hautement le principe de 1'indissolubilité du mariage ! on en arrivera pratiquement à la légitimité du second mariage per usum. Inversement, on fera valoir que la réception des sacrements aidera 1es pseudo-conjoints à se sanctifier, voire à s'acheminer à la séparation ou à la vie comme frère et sœur, à la mesure des possibilités concrètes et des forces données par la grâce sacramentelle, par une purification de l'amour. Impasse ?
Je me pose la question suivante : le meilleur « stimulant » spirituel résulte-t-il nécessairement de l'admission aux sacrements, ou au contraire le « jeûne » ne peut-il pas être plus efficace ? A mon sens, les sacrements sont le moyen normal, mais non le seul, d'écoulement de la grâce ; il serait inconcevable qu'en les instituant le Christ ait entendu se limiter, et mettre ceux qui, sans faute formelle actuelle, sont dans l'impossibilité de les recevoir, en position d'infériorité par rapport aux autres. Voilà pourquoi je n'attacherai pas trop d'importance à cette question. Quand Il m'arrive de recevoir des divorcés remariés, je ne les traite pas en réprouvés, je les assiste de mon mieux, je les incite à se sanctifier en leur expliquant qu'ils ne sont pas en état (bien que sans faute actuelle de leur part) de recevoir les sacrements, et je puis porter témoignage que dans la plupart des cas ils comprennent fort bien cette position. Je suis bien entendu disposé à adopter l'autre position, sans réticence, si l'Église l’admet un jour sans équivoque.
Tout ceci me conduit à une dernière remarque, de portée plus générale. Je suis frappé des doléances de maints théologiens, canonistes et pasteurs au sujet de ce problème du divorce et de lia situation des divorcés civilement remariés. La plupart d'entre eux sont parmi les plus « prudents », les plus « sages ». Ils cherchent des « voies de salut » dans le cadre du principe intangible de l'indissolubilité du mariage. Mon avis personnel est que de telles recherches sont vouées à l'échec, ne conduisent qu'à des « échappatoires ». L'élargissement des cas de nullité est en certains cas tout à fait légitime ; mais il ne le serait pas s'il était cherché systématiquement et sans discrimination (surtout quand la cause invoquée est sans lien avec la mésentente) ; logiquement, en effet, il devrait conduire à refuser a priori le mariage partout où la nullité serait soupçonnée ; or les gens se marient « tels qu’ils sont » et on ne saurait sans manquer à la justice refuser le mariage à ceux qui ne sont pas dans la plénitude idéale de tous leurs moyens. Échappatoires aussi, à mon sens, l'application au mariage du « pouvoir vicaire » en vertu duquel le souverain pontife pourrait dissoudre tout mariage (même sacramentel consommé) ou la séduisante et brillante théorie de la « non-consommation existentielle dans la foi », etc. (cf. mon article sur Le problème de la dissolution du mariage par l'Église, Nouvelle revue théologique, T. 93, janvier 1971, p. 50). L'admission des divorcés civilement remariés aux sacrements ressemble elle aussi à une échappatoire.
J'ai de la peine à croire que le Christ et le Saint-Esprit nous acculent à ces échappatoires. Comment concevoir que des textes que l'on dit parfaitement clairs, ceux de l'écriture comme ceux des pères de l'Église primitive, conduisent à ses situations telles que « pour en sortir » il faille les torturer, les violer ou les « tourner » plus ou moins habilement. De deux choses l'une, me semble-t-il : ou bien ces textes disent bien ce que l’on prétend qu'ils veulent dire, et alors il faut les respecter sans biaiser ou bien, effectivement, il est des circonstances où l'on ne peut ni imposer aux époux de rester ensemble, ni, s'ils se séparent, leur interdire de « refaire leur vie ». Mais alors ce ne peut être cette interdiction que le Christ a voulue, et il faut interpréter autrement qu'on ne le fait actuellement ses paroles, et admettre que la tradition de l'Église primitive, si tradition il y a comme le veut le P. Crouzel, n’a pas une portée universelle et intemporelle, et donc ne s'impose pas nécessairement aujourd'hui. Je ne vois pas le moyen de sortir de ce dilemme.
On ne peut qu'admirer l'érudition et la probité de ce savant ouvrage.
Il n'est certes pas d'une lecture facile, ni distrayante, mais comment eût-il pu en être autrement, compte tenu du projet de l'auteur, passer en revue les textes patristiques concernant l’attitude de l'Église, jusqu'au 5e siècle, face au problème du divorce. Il était communément admis, jusqu'il y a peu, que cette attitude était négative ; mais récemment un courant s'est manifesté en doctrine, qui interprète autrement qu'on ne le faisait d'ordinaire les textes connus, ou prétend en citer d'autres en sens inverse, d'où résulterait qu'il n'existe pas de tradition ferme en la matière ; ce qui permettrait un « renversement de vapeur » de la part de l'Église, avec admission possible de la dissolution du mariage (au delà des cas aujourd'hui acceptés, mariage non consommé et mariage non sacramentel) sans rupture avec la tradition. Le P. Crouzel entend faire une étude exhaustive des textes disponibles, les examiner minutieusement, interpréter les textes peu clairs en fonction du contexte, de manière à présenter un dossier complet et indiscutable. La conclusion il 1aquelle il arrive est ferme. A part quelques rares exceptions nettement isolées, et qu'il est au surplus souvent possible de récuser parce qu'elles constituent non des témoignages sur la pensée commune de l'Église mais des opinions personnelles des auteurs de ces passages (Ambrosiaster notamment), et en dehors de quelques obscurités, la doctrine des Pères jusqu'aux occidentaux du Ve siècle est constante : le remariage n'est pas permis, après séparation, même si cette séparation est causée par l'adultère de l'un des conjoints (ou si l'un d'eux n'est pas chrétien ; le « privilège paulin » n'est pas encore admis).
Les difficultés d'une telle tâche étaient nombreuses : certains textes sont altérés, ou bien nous en possédons plusieurs versions divergentes, et la reconstitution du texte authentique est malaisée. La pensée de certains Pères est, pour nous occidentaux du XXe siècle, difficile à saisir. Comment toujours savoir si un auteur parle en son nom personnel et comme exégète, ou comme témoin de la pensée de l'Église de son temps ? Comment, en présence d'un doute, reconstituer le contexte dans lequel il convient de replacer le texte pour l'interpréter correctement, contexte de l'auteur et contexte de la discipline générale de l'Église ?
Le problème est traité par les Pères de l'Église dans la perspective de l'Écriture et plus spécialement du Nouveau Testament, saint Paul et Évangiles. Le principe est net, la répudiation suivie de remariage est interdite en règle générale. Il ne pourrait y avoir d'hésitation que pour le cas d'adultère (laissons de côté le cas du mariage d'un chrétien avec un non baptisé). En ce cas la répudiation est parfois imposée mais très rares sont les Pères qui autorisent le remariage ; quelques-uns l'interdisent explicitement ; un nombre non négligeable de textes ne formulent que le principe général de l'interdiction du remariage, sans se prononcer sur le cas d'adultère. C'est ici surtout que l'interprétation du P. Crouzel diffère de celle proposée par quelques auteurs récents, par référence au contexte, celui des auteurs eux-mêmes et plus encore, me semble-t-il, celui de 1a discipline générale de l'Église. S'il y avait exception pour le cas d'adultère, elle serait clairement exprimée, comme elle le sera ultérieurement pour les Églises d'Orient. Le premier à aborder la question est Hermas ; il interdit nettement au conjoint de la femme adultère de prendre une nouvelle épouse après la répudiation. L'A. montre que ce qui nous choque aujourd'hui n'a rien de surprenant à l'époque envisagée : la répudiation de la femme adultère est permise, voire obligatoire, sans que le remariage soit autorisé. Voilà, si j'ai bien compris l'ensemble de l'ouvrage, le point sans doute le plus important. Je n'ai pas qualité, n'étant pas patrologue, pour ajouter mon grain de sel au débat. Dire, comme je serais tenté de le faire, que la position de l’A. me semble reposer sur une forte probabilité, sans entraîner totalement ma conviction, n'ajouterait rien aux arguments de ses adversaires ni n'enlèverait rien aux siens. Je me contenterai donc de quelques remarques, pas nécessairement critiques, sur des points particuliers.
Les auteurs contemporains que combat l'A. disent ceci, entre autres raisons pour admettre plus ou moins largement la permission du remariage, au cas notamment d'adultère : les Pères qui ne font pas explicitement état de cette exception la laisseraient cependant sous-entendre ; ils ne s'exprimeraient pas plus clairement par souci pastoral de ne pas sembler encourager ou faciliter le remariage, interdit hors de ces cas. De fait, il s'agit parfois (pas toujours, et l'argument ne vaudrait alors pas autant) d'homélies, genre oratoire qui ne se prête guère à la casuistique. Le P. Crouzel répond avec feu : « peut-on concevoir des vérités évangéliques (ici la permission du remariage) qu'on ne veut pas dire aux chrétiens de peur qu'elles ne les dépravent ? Peut-on imaginer qu'un pasteur, continuellement confronté aux difficultés matrimoniales des fidèles... hésite à exprimer clairement la doctrine qui pourrait les libérer ? » (p. 361). L'argument n'est pas pleinement convaincant : on ne trouve guère, aujourd'hui, dans les sermons, lettres pastorales ou discours divers, d'allusions aux « dispenses » de mariage non consommé ou non sacramentel, et la concession des dispenses de mariage non sacramentel est subordonnée à la garantie que l'opinion publique n'en déduira pas que l'Église favorise le divorce. Il reste, il est vrai, que l'historien qui, dans quelques siècles, étudiera notre époque contemporaine aura à sa disposition les documents administratifs relatifs, précisément, à ces dispenses…
L'A. souligne justement la nécessité de ne pas transposer indûment dans notre langage canonique contemporain les termes employés ici ou là par les pères de la primitive Église. « Dissolution » du mariage signifie aujourd'hui permission du remariage. Il est parfaitement clair dans certains textes qu'il n'en allait pas de même autrefois ; or on peut penser que, tous les pères ont employé le terme dans le même sens. Il est légitime d'en conclure que lorsque les Pères emploient le mot « dissolution » cela n'implique pas que le remariage était permis… , même si l'interdiction n'est pas explicitement formulée. Mais peut-on aller plus loin et dire que puisque la « dissolution » ne comporte pas par elle-même le pouvoir de se remarier reconnu à l'un des époux ou aux deux, par là-même elle ne le comporte jamais. Ce n'est pas évident (je ne pense du reste pas que l'auteur le dise). Je dirai surtout ceci à propos de la nécessité de ne pas transposer le sens des termes d'une époque à l'autre : nous distinguons aujourd'hui nettement entre empêchements dirimants et simplement prohibitifs, la sanction étant la nullité pour les premiers, non pour les seconds. Nous ne trouvons pas trace de cette distinction chez les Pères. Mais alors les interdictions qu'ils formulent à propos du remariage correspondent-elles nécessairement à ce que nous appelons, aujourd'hui l'empêchement dirimant de lien. A lire tel ou tel texte pastoral contemporain, ou peu ancien, on penserait volontiers que l'Église met sur le même plan les mariages « mixtes » (au sens strict, entre catholique et baptisé non catholique) et les mariages « dispars » (entre catholique et non baptisé) conclus sans dispense d'empêchement ; seuls pourtant les seconds sont nuls. Pour l'ancienne Église, il semble clair en certains textes que l'interdiction a pour sanction ce que nous appelons aujourd'hui 1a nullité du second mariage (pour bigamie) ; on parle en effet d'union adultérine (ou entachée de bigamie). Mais c'est beaucoup moins net en d'autres textes. Peut-on alors voir en chaque cas d'interdiction de remariage ce que nous appelons aujourd'hui empêchement dirimant sanctionné par la nuI1ité , L'A. ne semble pas s'être posé la question.
On en arrive ainsi à une question très vaste : avons-nous la certitude que la discipline de l'Église ancienne était unanime ?
Malgré ces menues chicanes, la lecture de l'ouvrage me laisse bien sur l'impression qu'au minimum et malgré quelques imprécisions ou obscurités la primitive Église était résolument hosti1e aux secondes noces du vivant des deux époux (elle l'était même parfois après la mort de l'un d'eux) ; l'hésitation, le cas échéant, ne me semble possible qu'au cas ,de répudiation pour adultère.
Le P. Crouzel a entendu présenter avant tout un dossier ; il n'a cependant pas omis d'aborder, en fin de son ouvrage, la question d'actualité de l'attitude de l'Église en présence des divorcés civilement remariés, à la 1umière .de ses conclusions sur l'attitude de l'Église primitive en face du divorce. Une question liminaire est de savoir dans quelle mesure nous sommes, aujourd'hui, liés par cette attitude de l'Église primitive, en pensant avec l'A. qu'elle est de refus inconditionnel de tout remariage du vivant des deux époux. L'A. l'admet, (p. 382) ; quelques réserves me semblent légitimes. Les hésitations des siècles qui ont suivi ceux étudiés, et l'évolution admettant progressivement la dissolution au cas de non-consommation et de mariage non sacramentel (cf. les études de MM. Gaudemet, Franzen & Huizing dans Le lien matrimonial, Revue de droit canonique, T. XXI, u. (1-4, 1971), déjà, permettraient peut-être de mettre en doute l'existence d'une véritable « Tradition » s'imposant comme telle. Le P. Crouzel ne s'est pas contenté d'étudier l'attitude de l'Église primitive face au divorce (dissolution avec permission de remariage du vivant des deux époux), il a également abordé la question des secondes noces après veuvage, et montré que certains pères leur étaient plus ou moins fortement hostiles. Ceci montre que le mariage n'était pas toujours, dans la primitive Église, tenu dans l'estime dont il jouit aujourd'hui. Pour admettre l'autorité, aujourd'hui, de la discipline de la primitive Église, ne devrait-on pas tenir compte de la différence des « climats » ? S'en tenir au « dispositif » de la discipline de l'Église primitive en négligeant les « motifs » s'impose-t-il ? Mais voici à présent ce que je voudrais souligner, en juriste : le contexte, dans lequel se présentent les textes du Nouveau Testament et de la discipline de l'Église primitive est celui du divorce par répudiation unilatérale ou par consentement mutuel ; notre contexte contemporain est, ou pourrait être, celui de la dissolution du mariage prononcée par une autorité publique (l’Église, pour les catholiques, l'État, ou l'autorité religieuse dont ils se réclament, pour les autres), pour des causes précises ; c'est, tout autre chose. Indissolubilité « intrinsèque » dans le Nouveau Testament et la primitive Église, cela implique-t-il nécessairement indissolubilité « extrinsèque » ? J'entends bien que dans les législations anciennes les causes de répudiation étaient ou pouvaient être limitées, et que leur existence était ou pouvait être contrôlée ; que de nos jours, de fait, on en arrive souvent, par divers moyens, au divorce par consentement mutuel. La différence reste, théoriquement au moins, importante entre le divorce condamné par les Pères, et celui que l'on pourrait concevoir aujourd'hui. Je regrette que le P. Crouzel n'ait pas abordé la question.
Comme beaucoup de canonistes, théologiens ou pasteurs d'aujourd'hui, l'A. se résout pourtant difficilement à admettre la situation douloureuse des divorcés civilement remariés quand ils sont profondément chrétiens (ce qui n'est pas du tout rare). Quelle « solution » trouver pour leur venir en aide ? D'abord « disparition de la présomption canonique en faveur du mariage, c'est-à-dire que dans le cas de doute sérieux sur la validité, sans cependant de preuves juridiques suffisantes pour emporter l'évidence, la question pourrait être résolue, soit par les juges ecclésiastiques, soit par un indult pontifical, au bénéfice des personnes plutôt qu'à celui des institutions » (p. 381~82). Quelques remarques s'imposent. Personne, en premier lieu, n'exige « l'évidence » de la nullité pour le prononcé de celle-ci ; ce qui est requis, c'est la « certitude morale », et c'est autre chose que l'évidence. Ensuite, on peut en effet concevoir un certain assouplissement du système des preuves externes et juridiques (dès maintenant, on constate le crédit plus grand fait par les tribunaux ecclésiastiques à la déposition des parties sous la foi du serment). Point n'est besoin, dans cette perspective de la certitude morale et des modes de preuve admissibles, d'un recours à un indult pontifical pour le prononcé de la nullité. Enfin, il me semble radicalement impossible d'aller plus loin (si tant est que l'A. le demande). La décision risquerait d'être « constitutive » d'un état de droit nouveau, et non plus « déclarative » d'un état de droit existant, et alors elle contredirait le principe même de l'indissolubilité, et camouflerait derrière un constat de nullité ce qui ne serait en réalité rien d'autre qu'un divorce. Il n'y a en effet dans la présomption à renverser rien de particulier au mariage. Le principe actori incumbit probatio est de portée générale, et la règle standum est pro validitate n'en est qu'une application parmi beaucoup d'autres. Renoncer à ce principe et à cette règle, ce serait détruire tout l'ordre social, ruiner toute sécurité juridique, se livrer à l'arbitraire du juge, avec tous les dangers que cela comporterait. Prendre en considération les personnes plutôt que les institutions, ce serait admettre que dans tel cas particulièrement intéressant la nullité serait prononcée bien que la certitude morale de la nullité ne soit pas acquise, et refusée dans tel autre cas identique juridiquement, mais moins « intéressant ». Et si l'on pose en principe que tous les cas sont intéressants (et ne le sont-ils pas effectivement tous ?), ce serait renverser purement et simplement la charge de la preuve et admettre que c'est au défenseur du lien de démontrer la validité du mariage pour la seule raison que les époux ne s'entendent pas, au delà de ce qui est dès maintenant acquis ou admissible quant aux présomptions de fait, et notamment parmi celles-ci les relations entre les époux après la célébration du mariage comme mode de preuve des dispositions des fiancésnau moment de la célébration (liberté, réticences diverses) ; autrement dit ce serait faire de ce qui est présomption de fait une présomption de droit. Ce serait donc passer de l'indissolubilité à la dissolubilité car, chacun le sait, la présomption de droit a précisément pour but de permettre au juge de faire comme si ce qui n'a peut-être pas été, ou a peut-être été, a certainement été, ou n'a certainement pas été. Concrètement, ce serait mettre en doute, plus ou moins arbitrairement, la sincérité, la liberté des époux au moment du mariage, alors que les relations sociales sont nécessairement fondées sur la présomption que chacun, quand il agit, le fait librement et en connaissance de cause.
II est vrai, hélas, à exiger la preuve juridique de l'existence d'un cas de nullité on court de risque de refuser la déclaration de nullité, en l'absence de preuve juridique, alors qu'il y a peut-être pourtant nullité. La seule possibilité d'y remédier consiste alors, et c'est là le vrai problème, à faire confiance aux affirmations des époux ; ce n'est malheureusement pas toujours possible, et l’appréciation des cas où c'est possible reste hasardeuse. Quelque solution qu'on adopte, il y aura toujours des risques d'erreur, inévitablement. J'admets du reste qu'on prenne le risque de la mauvaise foi, et qu'on renvoie les parties à leur conscience, en certains cas. Mais c'est là, me semble-t-il l'autre chose que ce que préconise le P. Grouzel.
Bien des cas de désunion se présentent alors que le mariage est incontestablement valide, et que cette validité n'est pas niée par les époux désunis. Seconde voie de salut suggérée par l'A., par conséquent, pour ceux qui, après divorce, contractent une seconde union civile, en partant cette fois de quelques précédents patristiques : « tolérer dans une certaine mesure, bien qu'elle soit adultère, une union conclue devant les instances civiles et qui ne peut être rompue par suite des responsabilités qui en découlent » (p. 382) ; ces responsabilités concernent en particulier l'éducation des enfants nés de cette union. De quelle « tolérance » s'agit-il ? L'Église ne considère ni ne traite des divorcés remariés civilement comme des « réprouvés », la « pastorale des divorcés » est, fort heureusement, à l'ordre du jour. Les quelques inhabilités prévues par le code ne sont pas très « méchantes », et on peut les adoucir encore. « Cette tolérance ira-t-elle jusqu'à réadmettre aux sacrements de pénitence et d'eucharistie des divorcés remariés » (p. 382) ; il s'agit évidemment de ceux qui sont de fait dans l'impossibilité de se séparer, comme de vivre comme frère et sœur, cas nullement chimérique. Je ne vois guère, concrètement, qu'il puisse s’agir d'autre chose.
« Comment enlever à cette mesure toute ambiguïté devant l'opinion publique ? » (p. 383). Je répondrais volontiers ceci : d'une part, l'opinion publique n'est pas en cause dans la mesure où les sacrements sont administrés secreto ; d'autre part et surtout, si la mesure est légitime, il faut éduquer l'opinion publique ; si elle ne l'est pas, il ne faut pas la prendre; ainsi, c'est le fond de la question qu'il faut débattre, et pour le faire, il faut poser complètement le problème. Il était admis jusqu'à présent que pour être admis aux sacrements de pénitence et d'eucharistie il fallait non seulement regretter ses fautes passées et n'être pas en état actuel de faute « formelle », mais encore n'être pas en situation « matériellement » « irrégulière » ; cet état matériellement irrégulier suffisait à justifier l'exclusion des sacrements, fût-il exempt de faute formelle actuelle. Telle est bien en effet parfois la situation des divorcés civilement remariés (il n'y a pas de faute formelle à faire ce que l’on ne peut pas ne pas faire, et nous admettons, par hypothèse, que certains divorcés remariés ne peuvent pas se séparer, ni vivre comme frère et sœur). Est-il théologiquement possible de renoncer à la dernière condition, et de se contenter pour l'admission aux sacrements du regret des fautes passées et de l'absence de faute formelle actuelle ? Je n'ai pas à le dire. Remarquons simplement ceci : d'une part, cette admission aux sacrements de certains divorcés remariés civilement, positis ponendis, conduira inéluctablement, en fait, à mettre sur le même plan, et ceci non simplement devant l'opinion publique, ceux de qui l'union est illégitime, et ceux de qui elle est légitime ; on aura beau alors proclamer hautement le principe de 1'indissolubilité du mariage ! on en arrivera pratiquement à la légitimité du second mariage per usum. Inversement, on fera valoir que la réception des sacrements aidera 1es pseudo-conjoints à se sanctifier, voire à s'acheminer à la séparation ou à la vie comme frère et sœur, à la mesure des possibilités concrètes et des forces données par la grâce sacramentelle, par une purification de l'amour. Impasse ?
Je me pose la question suivante : le meilleur « stimulant » spirituel résulte-t-il nécessairement de l'admission aux sacrements, ou au contraire le « jeûne » ne peut-il pas être plus efficace ? A mon sens, les sacrements sont le moyen normal, mais non le seul, d'écoulement de la grâce ; il serait inconcevable qu'en les instituant le Christ ait entendu se limiter, et mettre ceux qui, sans faute formelle actuelle, sont dans l'impossibilité de les recevoir, en position d'infériorité par rapport aux autres. Voilà pourquoi je n'attacherai pas trop d'importance à cette question. Quand Il m'arrive de recevoir des divorcés remariés, je ne les traite pas en réprouvés, je les assiste de mon mieux, je les incite à se sanctifier en leur expliquant qu'ils ne sont pas en état (bien que sans faute actuelle de leur part) de recevoir les sacrements, et je puis porter témoignage que dans la plupart des cas ils comprennent fort bien cette position. Je suis bien entendu disposé à adopter l'autre position, sans réticence, si l'Église l’admet un jour sans équivoque.
Tout ceci me conduit à une dernière remarque, de portée plus générale. Je suis frappé des doléances de maints théologiens, canonistes et pasteurs au sujet de ce problème du divorce et de lia situation des divorcés civilement remariés. La plupart d'entre eux sont parmi les plus « prudents », les plus « sages ». Ils cherchent des « voies de salut » dans le cadre du principe intangible de l'indissolubilité du mariage. Mon avis personnel est que de telles recherches sont vouées à l'échec, ne conduisent qu'à des « échappatoires ». L'élargissement des cas de nullité est en certains cas tout à fait légitime ; mais il ne le serait pas s'il était cherché systématiquement et sans discrimination (surtout quand la cause invoquée est sans lien avec la mésentente) ; logiquement, en effet, il devrait conduire à refuser a priori le mariage partout où la nullité serait soupçonnée ; or les gens se marient « tels qu’ils sont » et on ne saurait sans manquer à la justice refuser le mariage à ceux qui ne sont pas dans la plénitude idéale de tous leurs moyens. Échappatoires aussi, à mon sens, l'application au mariage du « pouvoir vicaire » en vertu duquel le souverain pontife pourrait dissoudre tout mariage (même sacramentel consommé) ou la séduisante et brillante théorie de la « non-consommation existentielle dans la foi », etc. (cf. mon article sur Le problème de la dissolution du mariage par l'Église, Nouvelle revue théologique, T. 93, janvier 1971, p. 50). L'admission des divorcés civilement remariés aux sacrements ressemble elle aussi à une échappatoire.
J'ai de la peine à croire que le Christ et le Saint-Esprit nous acculent à ces échappatoires. Comment concevoir que des textes que l'on dit parfaitement clairs, ceux de l'écriture comme ceux des pères de l'Église primitive, conduisent à ses situations telles que « pour en sortir » il faille les torturer, les violer ou les « tourner » plus ou moins habilement. De deux choses l'une, me semble-t-il : ou bien ces textes disent bien ce que l’on prétend qu'ils veulent dire, et alors il faut les respecter sans biaiser ou bien, effectivement, il est des circonstances où l'on ne peut ni imposer aux époux de rester ensemble, ni, s'ils se séparent, leur interdire de « refaire leur vie ». Mais alors ce ne peut être cette interdiction que le Christ a voulue, et il faut interpréter autrement qu'on ne le fait actuellement ses paroles, et admettre que la tradition de l'Église primitive, si tradition il y a comme le veut le P. Crouzel, n’a pas une portée universelle et intemporelle, et donc ne s'impose pas nécessairement aujourd'hui. Je ne vois pas le moyen de sortir de ce dilemme.
Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com
Le moteur peut rechercher dans différents champs :
- Un nom d’auteur (AUTEUR)
- Un mot du titre (TITRE)
- Un ISBN
- Un mot du texte de présentation (TEXTE)
- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).
La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.
En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.
Search engine www.editions-beauchesne.com
The engine can search in different fields:
- An author's name (AUTEUR)
- A word from the title (TITRE)
- An ISBN
- A word from the presentation text (TEXTE)
- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).
The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.
Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.