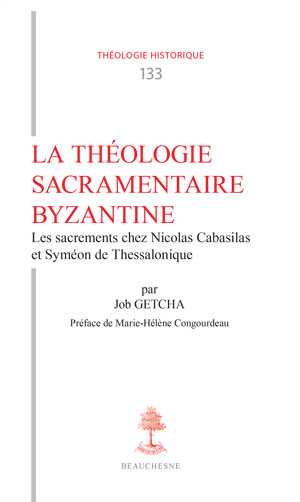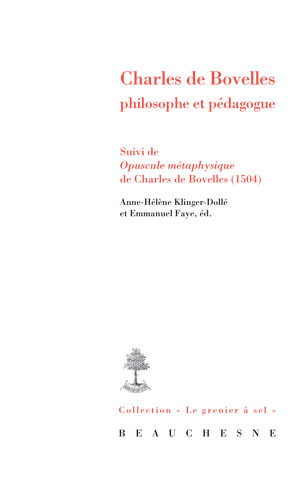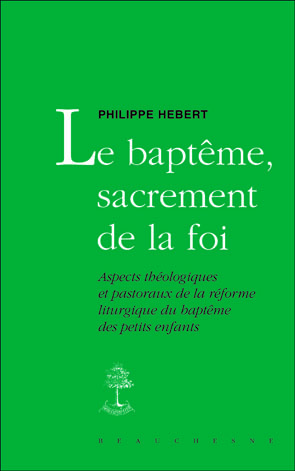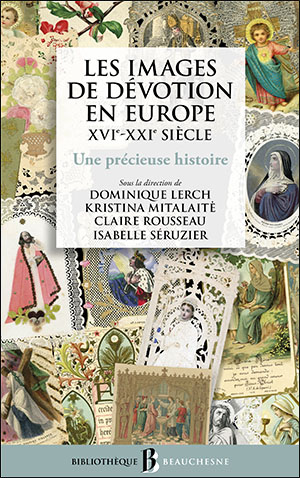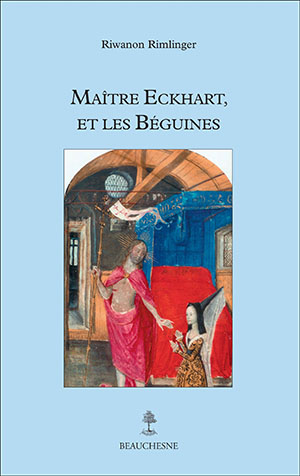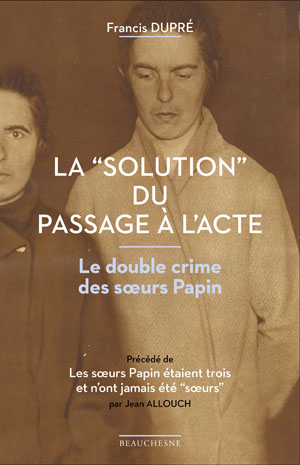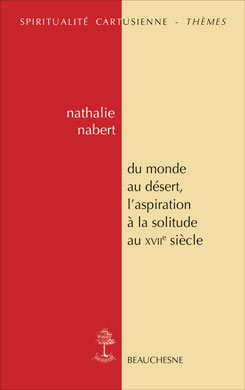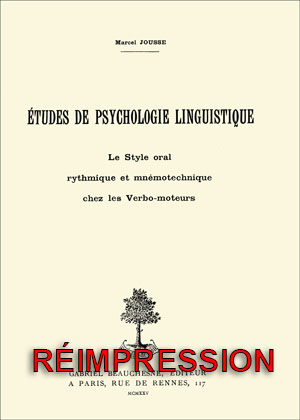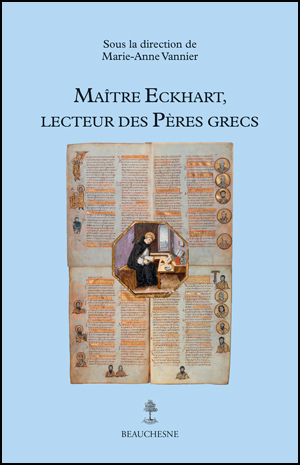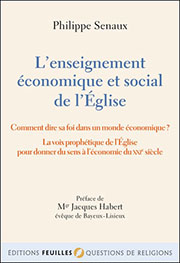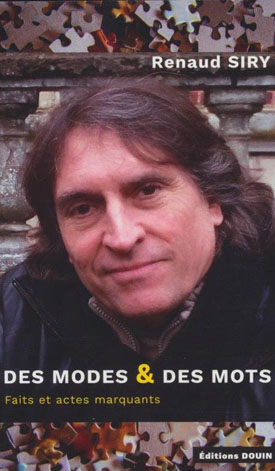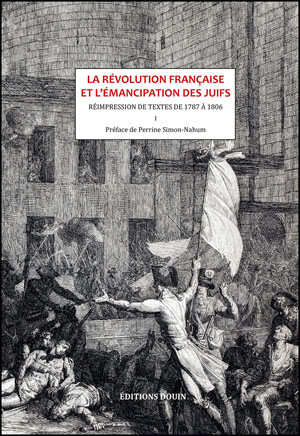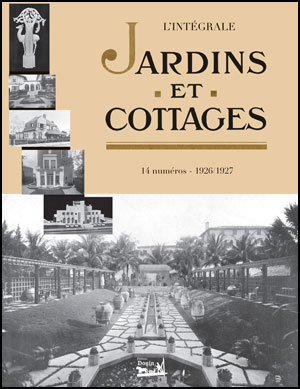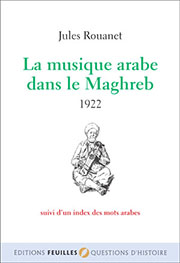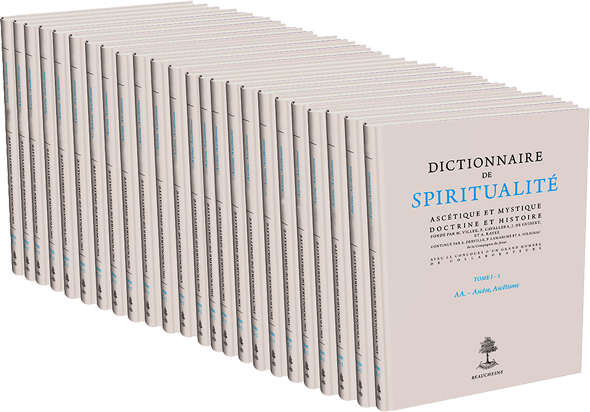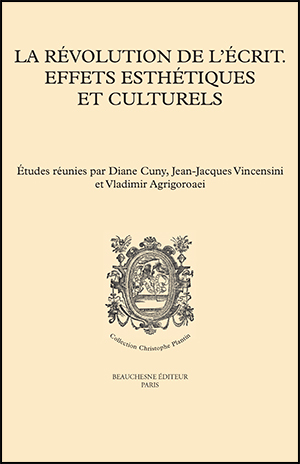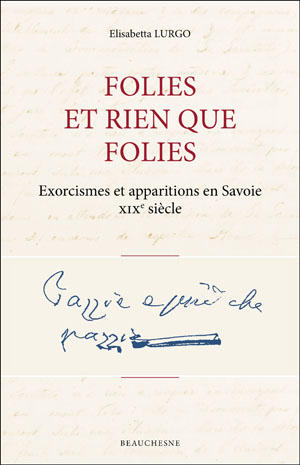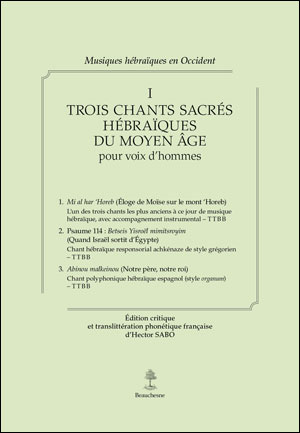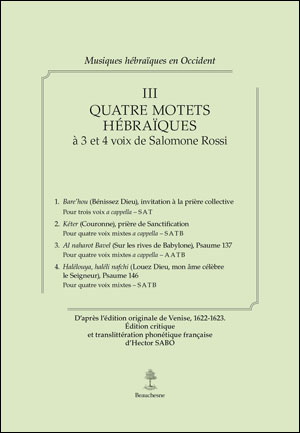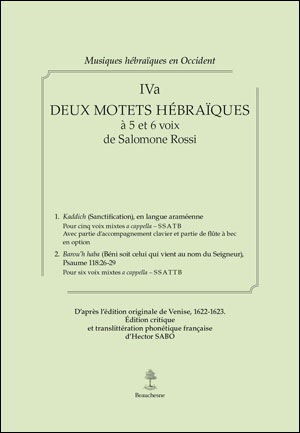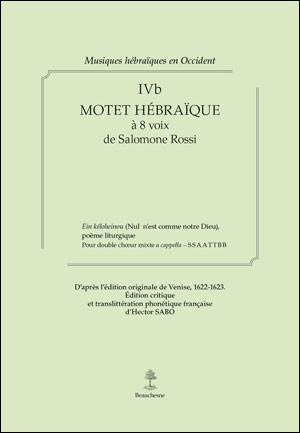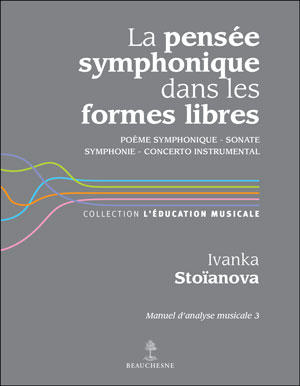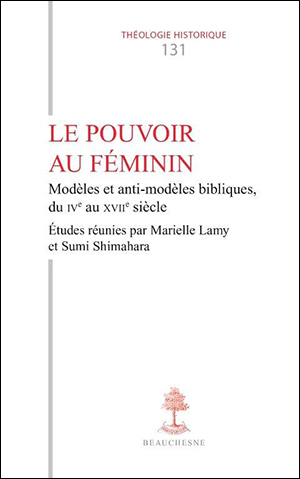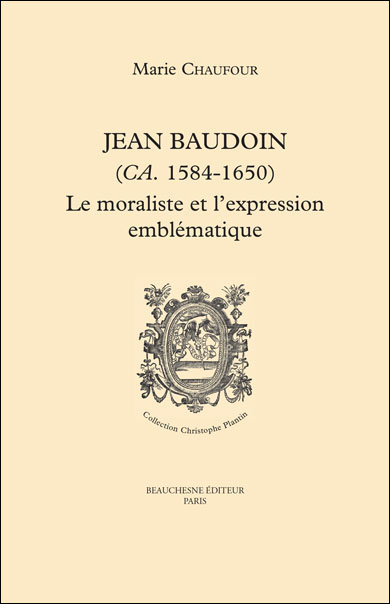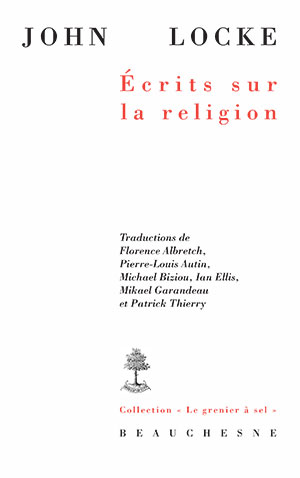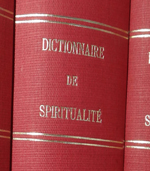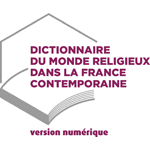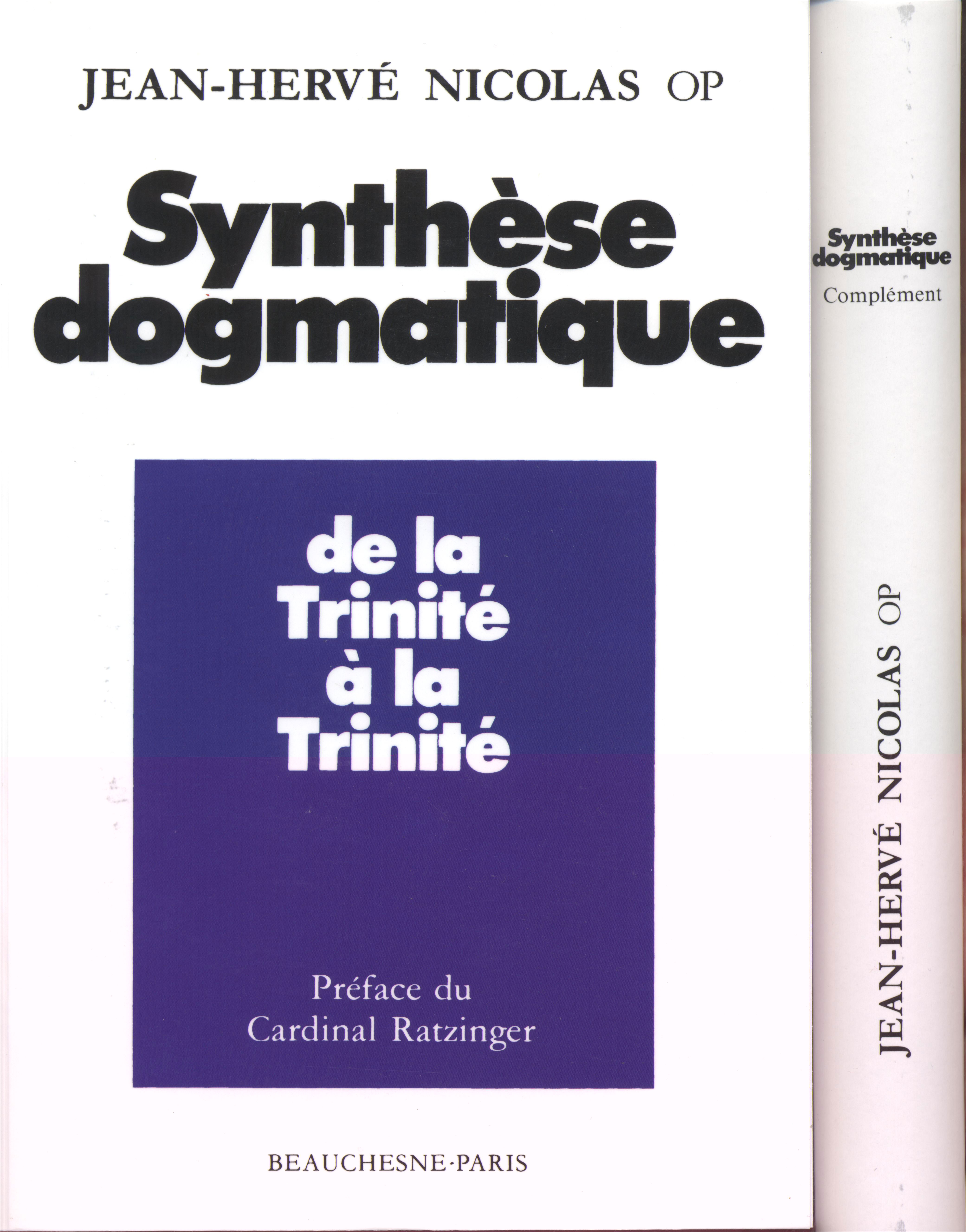40.50 €
TH n°020 SOPHRONE DE JÉRUSALEM. VIE MONASTIQUE ET CONFESSION DOGMATIQUE
Date d'ajout : mardi 13 juin 2017
par A. DE HALLEUX
REVUE DE THÉOLOGIE DE LOUVAIN, 1974, 4
Disciple et ami monastique de Jean Moschus, père spirituel de Maxime le Confesseur, avant de devenir le patriarche de Jérusalem (634-t639) qui ouvrit la ville sainte au Calife Omar, Sophrone fut aussi le premier grand défenseur de l'orthodoxie chaIcédonienne contre le monoénergisme des patriarches Serge de Constantinople et Cyr d'Alexandrie. Le P. v. Sch. vient de lui consacrer une monographie surclassant toute la littérature précédente. La biographie se trouve désormais récrite, l'authenticité des œuvres, même inédites, réexaminée et la théologie synthétisée pour la première fois. On appréciera surtout l'ampleur avec laquelle l'auteur a embrassé le sujet. Averti de la dimension dogmatique de l'expérience monastique et de la « rigueur théologale » de la vie des saints, il a tenu à situer Sophrone dans le milieu de la laure palestinienne de St-Sabas, indéfectiblement attachée au dyophysisme chalcédonien depuis son fondateur Euthyme. Les aspects liturgique et homilétique, hagiographique et ascétique de l'œuvre sophronienne se composent en une symphonie théologique dont la richesse avait jusqu'ici échappé aux objectifs étroits du positivisme historique.
Le P. v. Sch. a raison de réagir contre cet historicisme, qui tend à réduire le passé à ses conditionnements politiques ou psychologiques. L'histoire de l'Église est sous-tendue par des facteurs qui, visibles aux seuls yeux de la foi, n'en sont que bien plus réels que la prétendue factualité historique. L'empirie doit donc être dépassée, ou approfondie, par le croyant, en une sorte de méditation mystique dévoilant la dimension surnaturelle dont les faits constituent le signe. Mais l'historien peut-il légitimement en tant que tel, c'est-à-dire au niveau de sa méthode critique, faire intervenir l'explication surnaturelle que postule l'herméneutique de la foi ? Si la réaction contre l'historicisme devait impliquer l'oubli de la distinction entre l'histoire et sa théologie, on risquerait d'en revenir aux confusions d'une conception prélogique du monde.
Les témoignages orthodoxes peuvent être non seulement abordés avec « sympathie méthodologique », mais aussi reçus en pleine communion de foi. Mais lorsque les deux démarches se confondent, le danger devient grand de voir absolutiser une saisie particulière qui, pour atteindre le vrai, n'en demeure pas moins historiquement conditionnée. Le point de vue exprimé par les sources chalcédoniennes des VIe et VIIe s. ne saurait être identifié sans plus avec l'expression absolue d'une vérité intemporelle. À perdre de vue l'incarnation historique de la réflexion christologique et son évolution depuis le concile de 451, on s'engage malgré soi dans une mauvaise apologétique. Certes, l'auteur est loin de céder à ce travers. Mais lorsqu'il affirme que Sophrone ne se rattache pas à une école particulière, mais à la Tradition (p. 175) et lorsqu'il se défend d'entrer dans l'analyse du langage technique de la christologie sous prétexte que le patriarche n'en appelle qu'à la réalité du mystère (p. 176), la réaction légitime contre une science patrologique trop exclusivement attachée aux formules provoque un court-circuit aussi dangereux qu'injustifié.
La canonisation en orthodoxie du chalcédonisme byzantin des VIe et VIle s. ne peut d'ailleurs s'opérer qu'au prix d'une fixation analogue et complémentaire des monophysismes historiques en l'hérésie opposée, repoussoir d'autant plus commode qu'il reste abstrait et artificiel. Force est ici de reconnaître dans le travail du P. v. Sch. une incompréhension regrettable de la tradition monophysite, qu'il s'est contenté de lire à travers la caricature polémique des chalcédoniens. Ainsi Julien d'Halicarnasse reste-t-il caractérisé comme l'aphthartodocète, représentant typique du monophysisme radical dans son aboutissement logique (p. 12414, 171, 172), c'est-à-dire dans le phantasiasme dont on charge Eutychès (p. 181), alors que la christologie julianite se rapproche étonnamment de l'explication « tropique » du chalcédonien Sophrone. Et ce dernier partage la plupart des traits positifs qui lui sont ici crédités, - y compris ce que l'auteur regarde comme sa réponse par excellence au monoénergisme, c'est-à-dire la liberté que le Verbe incarné conserve, dans sa condition humaine, vis-à-vis des passions naturelles elles-mêmes (p. 220-222), avec un monophysite comme Philoxène de Mabbog. Loin de n'être que des politiciens ambitieux, aveuglés par le nationalisme ethnique (p. 39-40), les prélats monophysites demeuraient aussi convaincus que leurs adversaires de témoigner, et jusqu'au martyre, la vraie foi dans le mystère du Christ. Loin d'être des rationalistes réduisant ce mystère aux dimensions d'un système spéculatif, représentation conceptuelle d'une impossible synthèse entre le divin et l'humain (p. 172-173), les théologiens monophysites proclamaient, eux aussi, le scandale et la folie du paradoxe de Dieu inhumané, souffrant et mourant pour le salut du monde.
La concordance foncière de Sophrone avec ses adversaires devient plus frappante encore dès qu'on a remarqué l'inspiration nettement alexandrine de sa christologie. Certes, le patriarche repousse comme impie la formule sévérienne de l'une nature composée, à laquelle il oppose celle de l'une hypostase composée. Mais il n'en conserve pas moins une conception cyrillienne de l' « union naturelle » et il affectionne des assertions de saveur singulièrement « théopaschite » : « L'Impassible est proclamé passible et Celui qui a une nature immortelle est annoncé comme mortel par nature » (p. 167; cfr p. 163, 218). Il n'est pas jusqu'aux termes mêmes par lesquels le P. v. Sch. résume la position sophronienne qui ne seraient contresignés des deux mains par tous les monophysites syriens : « Un de la Trinité devient réellement homme sans que la nature divine comme telle soit passible » (p. 126). En effet, les deux partis maintenaient également, sans les confondre, le lien entre la Trinité et l'économie (p. 122-126).
L'auteur y voit pourtant une différence essentielle. Les monoénergistes et les monothéIites, en héritiers logiques de l'apollinarisme (p. 171), auraient conçu l'activité du Christ comme une détermination passive de la nature humaine divinisée par la nature divine (p. 192, 213-214). Sophrone, de son côté, refuserait pareille communication des idiomes : l'écart infini entre les deux natures excluant pour lui tout contact (p. 213), leur communion et leur synergie ne pourraient s'opérer que dans l'hypostase unique (p. 214-215). Mais on peut se demander dans quelle mesure la nature divine, comprise au sens des monophysites cyrilliens, respectueux eux aussi de la « différence naturelle », ne s'identifie pas en fait avec l'hypostase au sens néochaIcédonien dans lequel la comprendrait Sophrone.
Certes, le P.v. Sch. interprète tout autrement la notion sophronienne d'hypostase : elle dénoterait le registre de l'obéissance du Fils à son Père dans la kénose, de l'incarnation à la croix, la synergie des natures signifiant, dès lors, que le Christ, dans son abaissement volontaire, opéra les œuvres de la nature humaine de façon filiale, c'est-à-dire selon le tropos nouveau de la nature humaine, dont le logos fondamental restait inchangé (p. 192-199, 216-222). Mais cette interprétation de type existentiel n'est-elle pas étrangère à la mentalité objectivante des Pères post-nicéens ? Avant de la recevoir, il faudrait avoir été convaincu que, chez Sophrone, l'hypostase filiale ne désigne pas, dans l'économie, le principe métaphysique dernier de l'être du Verbe incarné et, dans la triadologie, le caractère métaphysique de la génération dans l'homoousie.
En fin de compte, ce qui sépare Sophrone de ses adversaires monoénergistes ne se ramènerait-il pas à la seule fidélité à la formule dyophysite chalcédonienne, prolongée par le principe scolastique selon lequel les opérations dérivent des natures qu'elles manifestent ? Auquel cas l'importance des formules dans l'histoire du dogme christologique se confirmerait, d'autant plus que le dyoénergisme du patriarche répond mieux à l'agit enim utraque forma romain qu'à l'alexandrinisme « théopaschite » de sa propre christologie.
Disciple et ami monastique de Jean Moschus, père spirituel de Maxime le Confesseur, avant de devenir le patriarche de Jérusalem (634-t639) qui ouvrit la ville sainte au Calife Omar, Sophrone fut aussi le premier grand défenseur de l'orthodoxie chaIcédonienne contre le monoénergisme des patriarches Serge de Constantinople et Cyr d'Alexandrie. Le P. v. Sch. vient de lui consacrer une monographie surclassant toute la littérature précédente. La biographie se trouve désormais récrite, l'authenticité des œuvres, même inédites, réexaminée et la théologie synthétisée pour la première fois. On appréciera surtout l'ampleur avec laquelle l'auteur a embrassé le sujet. Averti de la dimension dogmatique de l'expérience monastique et de la « rigueur théologale » de la vie des saints, il a tenu à situer Sophrone dans le milieu de la laure palestinienne de St-Sabas, indéfectiblement attachée au dyophysisme chalcédonien depuis son fondateur Euthyme. Les aspects liturgique et homilétique, hagiographique et ascétique de l'œuvre sophronienne se composent en une symphonie théologique dont la richesse avait jusqu'ici échappé aux objectifs étroits du positivisme historique.
Le P. v. Sch. a raison de réagir contre cet historicisme, qui tend à réduire le passé à ses conditionnements politiques ou psychologiques. L'histoire de l'Église est sous-tendue par des facteurs qui, visibles aux seuls yeux de la foi, n'en sont que bien plus réels que la prétendue factualité historique. L'empirie doit donc être dépassée, ou approfondie, par le croyant, en une sorte de méditation mystique dévoilant la dimension surnaturelle dont les faits constituent le signe. Mais l'historien peut-il légitimement en tant que tel, c'est-à-dire au niveau de sa méthode critique, faire intervenir l'explication surnaturelle que postule l'herméneutique de la foi ? Si la réaction contre l'historicisme devait impliquer l'oubli de la distinction entre l'histoire et sa théologie, on risquerait d'en revenir aux confusions d'une conception prélogique du monde.
Les témoignages orthodoxes peuvent être non seulement abordés avec « sympathie méthodologique », mais aussi reçus en pleine communion de foi. Mais lorsque les deux démarches se confondent, le danger devient grand de voir absolutiser une saisie particulière qui, pour atteindre le vrai, n'en demeure pas moins historiquement conditionnée. Le point de vue exprimé par les sources chalcédoniennes des VIe et VIIe s. ne saurait être identifié sans plus avec l'expression absolue d'une vérité intemporelle. À perdre de vue l'incarnation historique de la réflexion christologique et son évolution depuis le concile de 451, on s'engage malgré soi dans une mauvaise apologétique. Certes, l'auteur est loin de céder à ce travers. Mais lorsqu'il affirme que Sophrone ne se rattache pas à une école particulière, mais à la Tradition (p. 175) et lorsqu'il se défend d'entrer dans l'analyse du langage technique de la christologie sous prétexte que le patriarche n'en appelle qu'à la réalité du mystère (p. 176), la réaction légitime contre une science patrologique trop exclusivement attachée aux formules provoque un court-circuit aussi dangereux qu'injustifié.
La canonisation en orthodoxie du chalcédonisme byzantin des VIe et VIle s. ne peut d'ailleurs s'opérer qu'au prix d'une fixation analogue et complémentaire des monophysismes historiques en l'hérésie opposée, repoussoir d'autant plus commode qu'il reste abstrait et artificiel. Force est ici de reconnaître dans le travail du P. v. Sch. une incompréhension regrettable de la tradition monophysite, qu'il s'est contenté de lire à travers la caricature polémique des chalcédoniens. Ainsi Julien d'Halicarnasse reste-t-il caractérisé comme l'aphthartodocète, représentant typique du monophysisme radical dans son aboutissement logique (p. 12414, 171, 172), c'est-à-dire dans le phantasiasme dont on charge Eutychès (p. 181), alors que la christologie julianite se rapproche étonnamment de l'explication « tropique » du chalcédonien Sophrone. Et ce dernier partage la plupart des traits positifs qui lui sont ici crédités, - y compris ce que l'auteur regarde comme sa réponse par excellence au monoénergisme, c'est-à-dire la liberté que le Verbe incarné conserve, dans sa condition humaine, vis-à-vis des passions naturelles elles-mêmes (p. 220-222), avec un monophysite comme Philoxène de Mabbog. Loin de n'être que des politiciens ambitieux, aveuglés par le nationalisme ethnique (p. 39-40), les prélats monophysites demeuraient aussi convaincus que leurs adversaires de témoigner, et jusqu'au martyre, la vraie foi dans le mystère du Christ. Loin d'être des rationalistes réduisant ce mystère aux dimensions d'un système spéculatif, représentation conceptuelle d'une impossible synthèse entre le divin et l'humain (p. 172-173), les théologiens monophysites proclamaient, eux aussi, le scandale et la folie du paradoxe de Dieu inhumané, souffrant et mourant pour le salut du monde.
La concordance foncière de Sophrone avec ses adversaires devient plus frappante encore dès qu'on a remarqué l'inspiration nettement alexandrine de sa christologie. Certes, le patriarche repousse comme impie la formule sévérienne de l'une nature composée, à laquelle il oppose celle de l'une hypostase composée. Mais il n'en conserve pas moins une conception cyrillienne de l' « union naturelle » et il affectionne des assertions de saveur singulièrement « théopaschite » : « L'Impassible est proclamé passible et Celui qui a une nature immortelle est annoncé comme mortel par nature » (p. 167; cfr p. 163, 218). Il n'est pas jusqu'aux termes mêmes par lesquels le P. v. Sch. résume la position sophronienne qui ne seraient contresignés des deux mains par tous les monophysites syriens : « Un de la Trinité devient réellement homme sans que la nature divine comme telle soit passible » (p. 126). En effet, les deux partis maintenaient également, sans les confondre, le lien entre la Trinité et l'économie (p. 122-126).
L'auteur y voit pourtant une différence essentielle. Les monoénergistes et les monothéIites, en héritiers logiques de l'apollinarisme (p. 171), auraient conçu l'activité du Christ comme une détermination passive de la nature humaine divinisée par la nature divine (p. 192, 213-214). Sophrone, de son côté, refuserait pareille communication des idiomes : l'écart infini entre les deux natures excluant pour lui tout contact (p. 213), leur communion et leur synergie ne pourraient s'opérer que dans l'hypostase unique (p. 214-215). Mais on peut se demander dans quelle mesure la nature divine, comprise au sens des monophysites cyrilliens, respectueux eux aussi de la « différence naturelle », ne s'identifie pas en fait avec l'hypostase au sens néochaIcédonien dans lequel la comprendrait Sophrone.
Certes, le P.v. Sch. interprète tout autrement la notion sophronienne d'hypostase : elle dénoterait le registre de l'obéissance du Fils à son Père dans la kénose, de l'incarnation à la croix, la synergie des natures signifiant, dès lors, que le Christ, dans son abaissement volontaire, opéra les œuvres de la nature humaine de façon filiale, c'est-à-dire selon le tropos nouveau de la nature humaine, dont le logos fondamental restait inchangé (p. 192-199, 216-222). Mais cette interprétation de type existentiel n'est-elle pas étrangère à la mentalité objectivante des Pères post-nicéens ? Avant de la recevoir, il faudrait avoir été convaincu que, chez Sophrone, l'hypostase filiale ne désigne pas, dans l'économie, le principe métaphysique dernier de l'être du Verbe incarné et, dans la triadologie, le caractère métaphysique de la génération dans l'homoousie.
En fin de compte, ce qui sépare Sophrone de ses adversaires monoénergistes ne se ramènerait-il pas à la seule fidélité à la formule dyophysite chalcédonienne, prolongée par le principe scolastique selon lequel les opérations dérivent des natures qu'elles manifestent ? Auquel cas l'importance des formules dans l'histoire du dogme christologique se confirmerait, d'autant plus que le dyoénergisme du patriarche répond mieux à l'agit enim utraque forma romain qu'à l'alexandrinisme « théopaschite » de sa propre christologie.
Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com
Le moteur peut rechercher dans différents champs :
- Un nom d’auteur (AUTEUR)
- Un mot du titre (TITRE)
- Un ISBN
- Un mot du texte de présentation (TEXTE)
- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).
La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.
En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.
Search engine www.editions-beauchesne.com
The engine can search in different fields:
- An author's name (AUTEUR)
- A word from the title (TITRE)
- An ISBN
- A word from the presentation text (TEXTE)
- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).
The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.
Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.