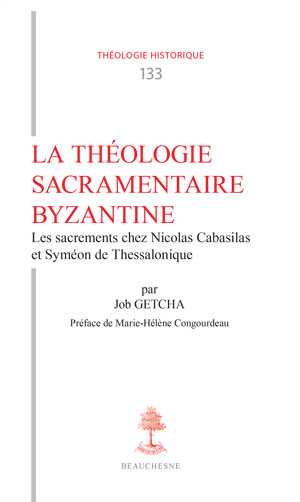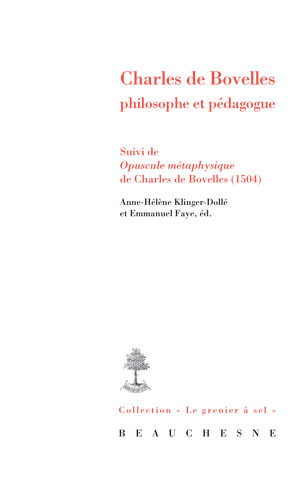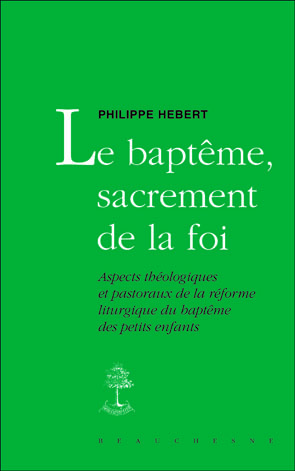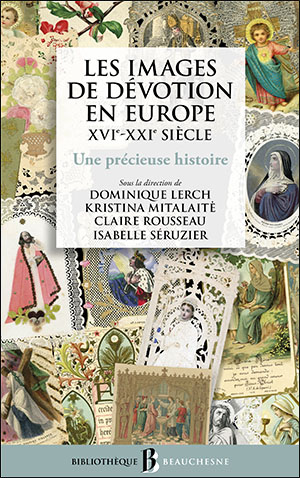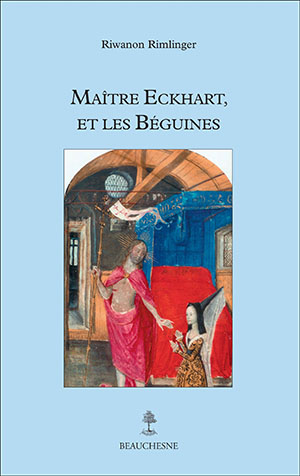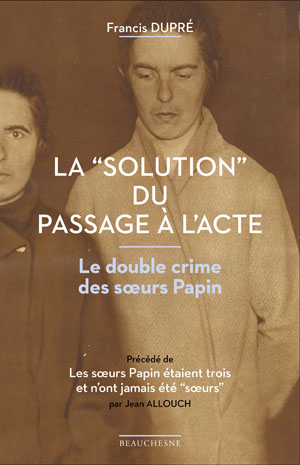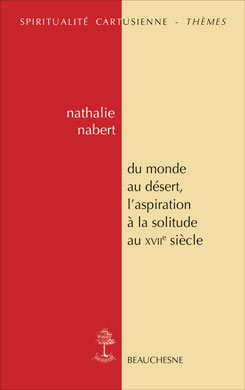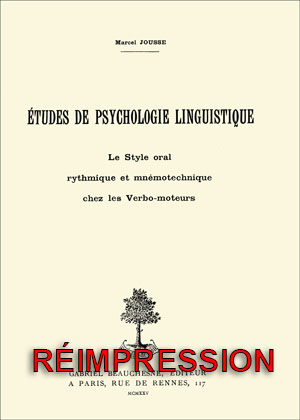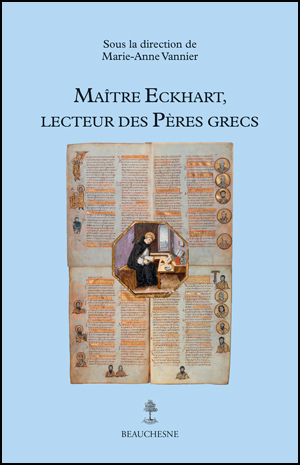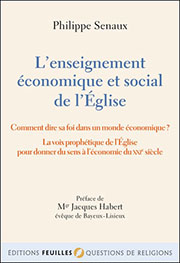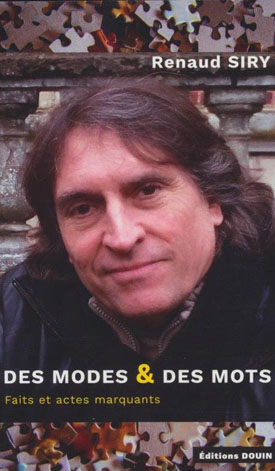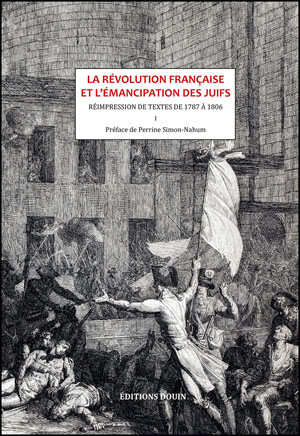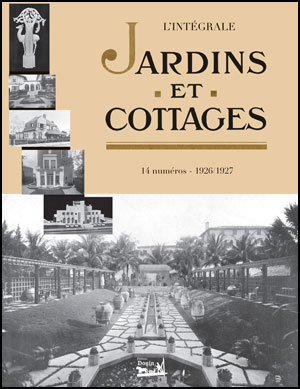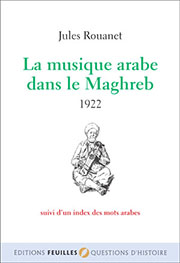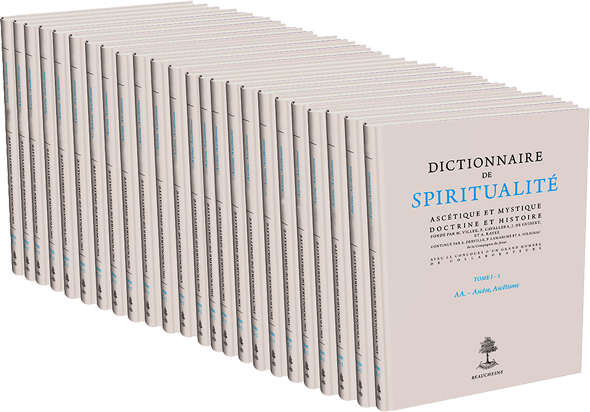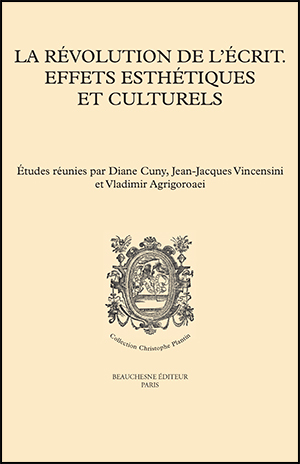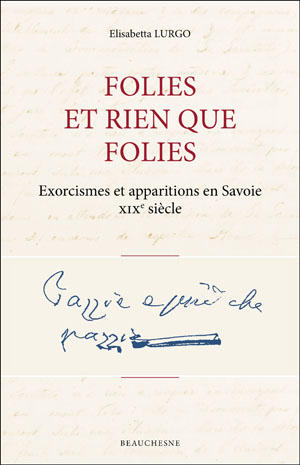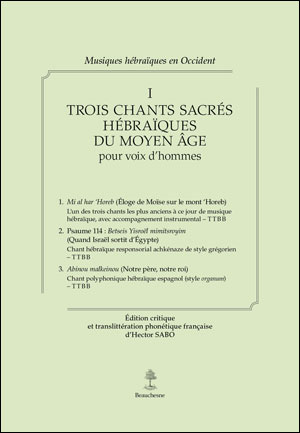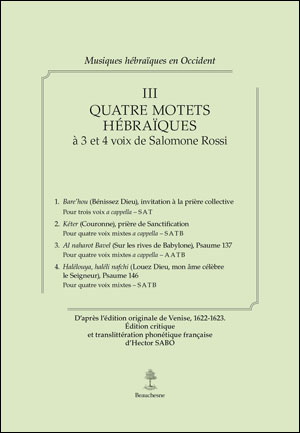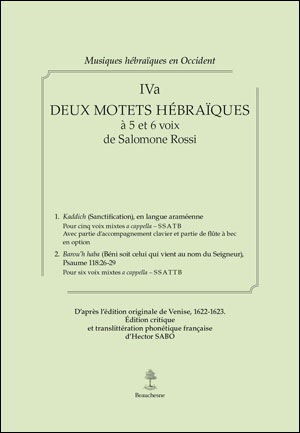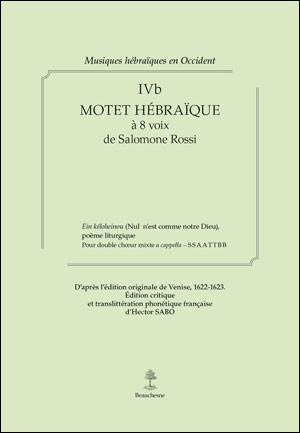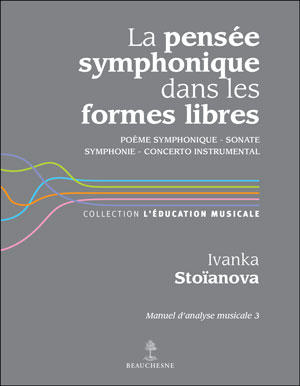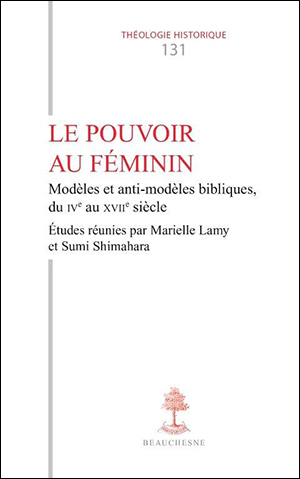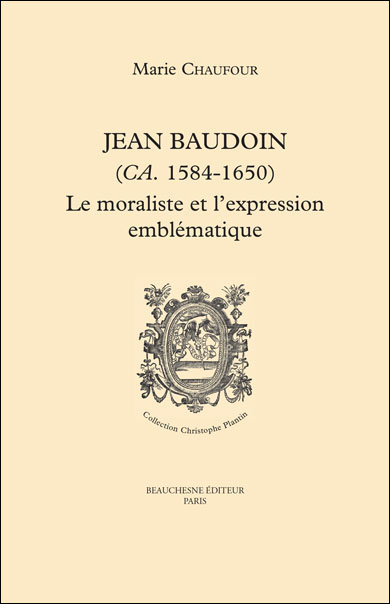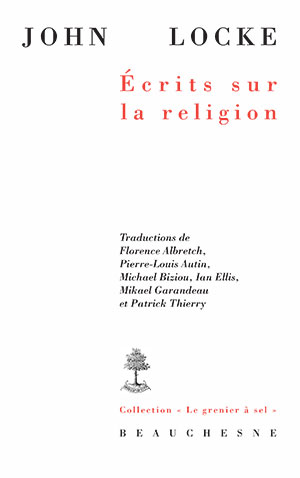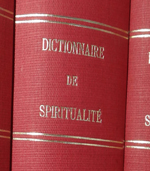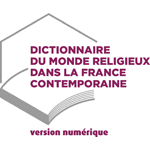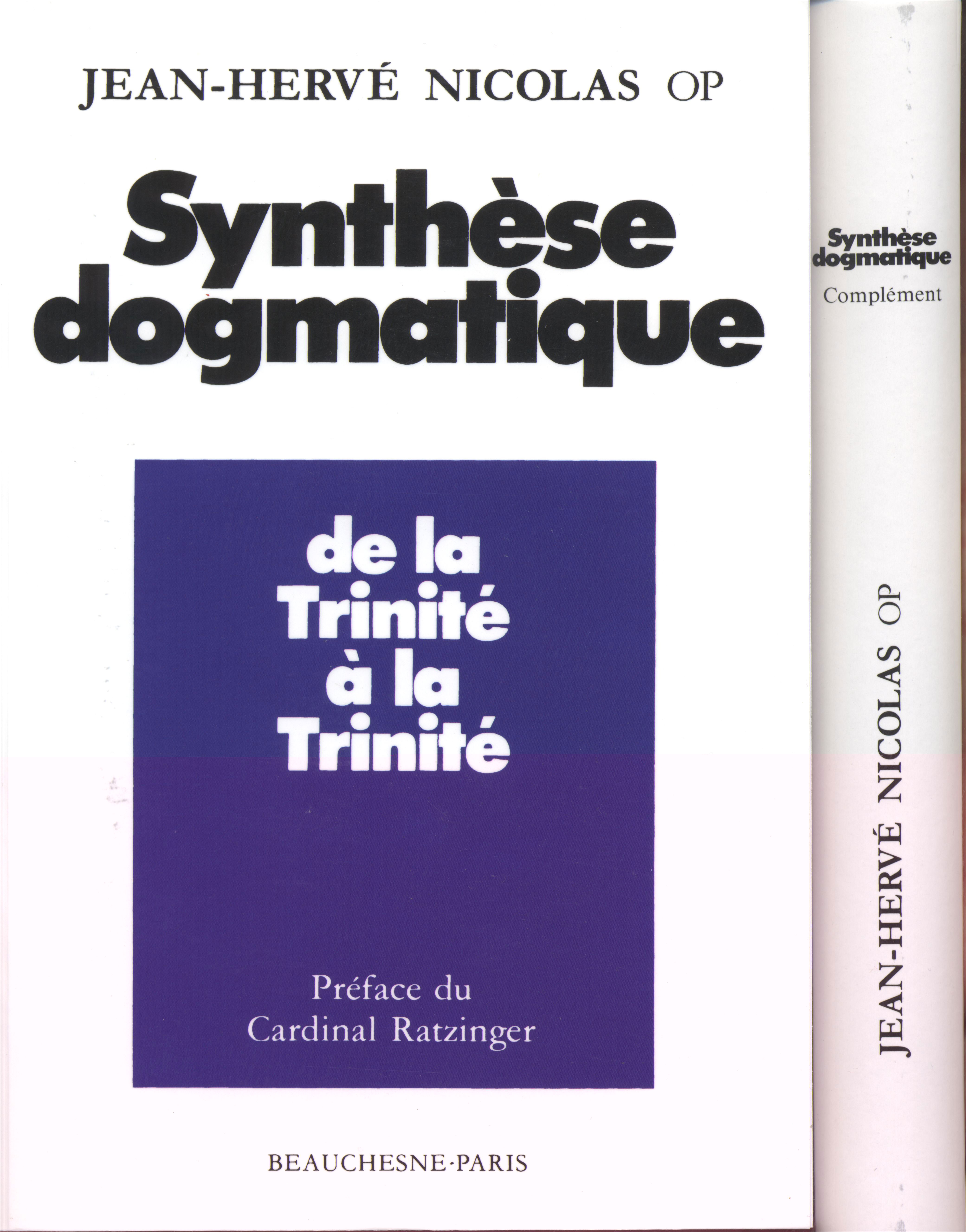0.00 €
TH n°019 LE CHRÉTIEN DEVANT LA SOUFFRANCE. ÉTUDE SUR LA PENSEE DE JEAN CHRYSOSTOME
Date d'ajout : mardi 18 juillet 2017
par Jean DUMORTIER
MÉLANGES DE SCIENCE RELIGIEUSE, VOL. XXXII, 1975
A une époque comme la nôtre où les théologiens tournent résolument le dos aux spéculations et aux systèmes pour s'intéresser à la pastorale et à la morale biblique, on ne peut que saluer avec plaisir un ouvrage consacré à une étude sur la souffrance à la lumière des écrits chrysostomiens, ceux d'un Père de l'Église nourri de l'Écriture. Disons-le tout de suite cependant, la présentation de cet ouvrage n'échappe pas à la critique, encore que l'œuvre même fasse honneur à la collection de Théologie historique. Obéissant sans doute à des préoccupations d'ordre pédagogique, E. Nowak a voulu marquer typographiquement toutes les articulations du plan qu'il a suivi. Les divers chapitres sont divisés en plusieurs parties l, II, III, qui admettent des subdivisions 1, 2, 3, et ces subdivisions des paragraphes a), b), c), qui, à leur tour, présentent des ramifications 1), 2), 3). Cette présentation néo-scolastique semble bien contraire au génie chrysostomien, mais peut-être favorise-t-elle la consultation de l'ouvrage ou sa mémorisation.
Dans une remarquable communication prononcée au symposion de Thessalonique de 1972 et parue en 1973 dans les Analecta Blatad6n (18) sous le titre : The Future of Chrysostom Studies : Theology and Nachleben, Robert Carter rappelait qu'il fallait se souvenir que le monde politique, social et culturel de Jean était bien différent du nôtre, qu'il importait de se placer sur le terrain de l'histoire et de ne pas se borner à emprunter des citations pour étayer un système, qu'on devait enfin éviter de prendre Chrysostome littéralement, car son style est rhétorique et qu'en ce domaine l'exagération et l'imprécision se rencontrent souvent. On eût aimé que l'auteur insistât parfois davantage sur ce dernier point.
L'expérience personnelle de la souffrance et le spectacle de celle d'autrui ont amené Jean à se poser la question de l'origine du mal en ce monde. Sans doute n'a-t-il pas composé de traité philosophique sur ce sujet, qu'il nous aurait été loisible de consulter. Pour vigoureux qu'il soit, son esprit n'est point propre à opérer de vastes synthèses. Jean est un exégète qui scrute les textes pour en tirer les applications morales, et sa pensée sur ce problème est dispersée dans toute son œuvre.
Le premier mérite de E. Nowak, ç'aura été de rassembler ces matériaux et d'en construire un ouvrage structuré comme celui qu'il nous présente ici. Les homélies sur saint Matthieu pour la période d'Antioche et les lettres à Olympias pour le temps de l'exil ont été tout particulièrement utilisées, sans que le reste de l'œuvre ait été pour autant négligé. C'est une petite Somme chrysostomienne sur la souffrance que nous avons désormais à notre disposition.
Le premier chapitre traite successivement de l'attitude de Jean devant le problème du mal et celui de la souffrance. La solution manichéenne qui voit l'origine des maux dans un principe mauvais est irrecevable, car elle est opposée au monothéisme et à la bonté foncière de la création. La réponse fataliste qui nie la liberté humaine rend vaine toute activité. Le démon est sans doute à même de déchaîner beaucoup de calamités, mais il ne peut déployer son activité qu'avec la permission divine et se trouve incapable d'agir sur notre volonté. Il reste que l'homme soit l'auteur du mal. Du même coup, il l'est de la souffrance. Dans ce contexte, Jean fait observer qu'on peut distinguer les choses bonnes, mauvaises et indifférentes. Si notre jugement est droit, nous n'estimerons préjudiciables que les choses réellement mauvaises; or ne sont mauvaises que celles qui portent atteinte à notre valeur morale: le bien véritable. Socrate autrefois ne soutenait pas une thèse différente, quand il prétendait que le criminel est plus malheureux que sa victime ; et les stoïciens ou encore l'auteur plutarchéen du An vitiositas ad infelicitatem sufficiat ? eussent volontiers souscrit à la proposition de Jean que nul ne pourra nuire à celui qui ne se fait pas de tort à lui-même. Notre saint n'avait pas oublié, on le voit, les leçons de ses maîtres païens : le rhéteur Libanios, le philosophe Andragathias. Parfois il se contente d'habiller à la chrétienne une pensée stoïcienne ou socratique, ou, comme le note E. Nowak, « sans effort il passe d'un thème stoïcien à des citations de l'Ecriture, où il trouve des exemples pour illustrer sa conception » (p. 88).
Dans le second chapitre est traitée la question de la relation de Dieu avec la souffrance du monde. Si la lucidité de l'intelligence permet de corriger les opinions erronées sur le bien et sur le mal, et la force d'âme de supporter les inévitables coups du sort et donc d'éviter la souffrance, on peut toujours se demander quelle est la raison de cette souffrance. La foi chrétienne en indique au croyant le pourquoi. Assurément l'homme ne peut accéder au mystère divin : les voies de Dieu demeurent impénétrables, mais il nous est possible de sentir dans notre propre vie et celle d'autrui la main de Dieu. Cette action prend la forme d'une économie providentielle, où la souffrance a sa place marquée, pour le bien véritable de l'homme. Ce n'est point simple vue de l'esprit mais tangible réalité, si l'on croit que Dieu est amour et qu'il a donné son Fils unique pour la rédemption de l'humanité. « Ainsi, remarque E. Nowak, la vieille argumentation philosophique sur la Providence, tirée de la beauté, de l'ordre, de l'harmonie, de l'utilité du monde, a reçu chez Jean un accent nouveau ... » (p. 136).
Le Christ rédempteur a opéré par ses souffrances le salut du monde, le chrétien trouve dans ses propres souffrances la possibilité de se sanctifier. Là encore le Christ est son modèle. Mais la souffrance, loin d'être un mal, a même une valeur positive, tant pour le pécheur que pour le juste: c'est l'objet du troisième chapitre. Dieu permet la souffrance pour punir le péché qui mérite un châtiment, bien plus pour libérer le pécheur du fardeau de ses fautes, mais aussi pour détourner les autres hommes du mal. De la sorte, Dieu se comporte en médecin qui voulant à tout prix sauver son malade lui applique un sévère traitement, mais recourt à ces remèdes en temps opportun. Si la souffrance se révèle favorable au pécheur, elle est également bonne pour le juste. Ce dernier en tire une véritable gloire, car le juste souffrant est pour son entourage un objet d'admiration. Il y trouve un accroissement de ses forces spirituelles et dispense à autrui un enseignement sur la primauté des valeurs morales. La souffrance du juste est en outre un témoignage rendu aux vérités chrétiennes. L'exemple le plus caractéristique est le témoignage du sang versé. Or l'on sait combien était répandu à cette époque chez les chrétiens d'Antioche le culte des martyrs. Enfin le juste souffrant trouvera sa récompense dans son entrée dans le royaume des cieux, car en se conformant au Christ mort au péché, il doit participer à sa résurrection glorieuse.
Dans la conclusion générale E. Nowak présente en raccourci l'attitude de Jean devant le problème de la souffrance. « S'en tenant à la raison, Chrysostome cherche l'intelligence de la souffrance au terme d'une réflexion sur le donné révélé, sur la marche du monde et sur la vie de l'homme » (p. 223). Mais il encourt le même reproche qu'Épictète, celui de rejeter l'expérience humaine et de nier la réalité de la souffrance. On pourrait même être surpris qu'un adversaire aussi résolu des philosophes païens leur ait emprunté tant d'arguments, mais telle est la force des courants d'idées : on condamne les auteurs pernicieux et on suit leur doctrine. En va-t-il autrement aujourd'hui tant pour les clercs que pour les fidèles à l'endroit des philosophies modernes ?
Jean semble parfois identifier le Christ avec le Sage de la Stoa. Il ne montre guère non plus le rapport qui existe entre le péché originel et la souffrance humaine. Mais voit-il dans le péché originel un véritable péché dont les descendants d'Adam fussent responsables ? On est en droit d'en douter. Enfin moraliste et non mystique, il n'applique pas à tout chrétien ce que saint Paul disait de lui-même qu'il accomplissait dans sa chair les souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Mais ce sont là ombres légères. Reconnaissons plutôt avec E. Nowak que « le christianisme, jeune et libre, a trouvé en Chrysostome un de ses plus éminents représentants, un homme qui a mis toutes les richesses de sa haute culture à son service » (p. 228).
Une bibliographie fort précieuse, un index des mots grecs, un index des auteurs cités, un index scripturaire complètent cet ouvrage auquel nous souhaitons une large diffusion.
A la page 213, on corrigera Rhôdes en Philoctète.
A une époque comme la nôtre où les théologiens tournent résolument le dos aux spéculations et aux systèmes pour s'intéresser à la pastorale et à la morale biblique, on ne peut que saluer avec plaisir un ouvrage consacré à une étude sur la souffrance à la lumière des écrits chrysostomiens, ceux d'un Père de l'Église nourri de l'Écriture. Disons-le tout de suite cependant, la présentation de cet ouvrage n'échappe pas à la critique, encore que l'œuvre même fasse honneur à la collection de Théologie historique. Obéissant sans doute à des préoccupations d'ordre pédagogique, E. Nowak a voulu marquer typographiquement toutes les articulations du plan qu'il a suivi. Les divers chapitres sont divisés en plusieurs parties l, II, III, qui admettent des subdivisions 1, 2, 3, et ces subdivisions des paragraphes a), b), c), qui, à leur tour, présentent des ramifications 1), 2), 3). Cette présentation néo-scolastique semble bien contraire au génie chrysostomien, mais peut-être favorise-t-elle la consultation de l'ouvrage ou sa mémorisation.
Dans une remarquable communication prononcée au symposion de Thessalonique de 1972 et parue en 1973 dans les Analecta Blatad6n (18) sous le titre : The Future of Chrysostom Studies : Theology and Nachleben, Robert Carter rappelait qu'il fallait se souvenir que le monde politique, social et culturel de Jean était bien différent du nôtre, qu'il importait de se placer sur le terrain de l'histoire et de ne pas se borner à emprunter des citations pour étayer un système, qu'on devait enfin éviter de prendre Chrysostome littéralement, car son style est rhétorique et qu'en ce domaine l'exagération et l'imprécision se rencontrent souvent. On eût aimé que l'auteur insistât parfois davantage sur ce dernier point.
L'expérience personnelle de la souffrance et le spectacle de celle d'autrui ont amené Jean à se poser la question de l'origine du mal en ce monde. Sans doute n'a-t-il pas composé de traité philosophique sur ce sujet, qu'il nous aurait été loisible de consulter. Pour vigoureux qu'il soit, son esprit n'est point propre à opérer de vastes synthèses. Jean est un exégète qui scrute les textes pour en tirer les applications morales, et sa pensée sur ce problème est dispersée dans toute son œuvre.
Le premier mérite de E. Nowak, ç'aura été de rassembler ces matériaux et d'en construire un ouvrage structuré comme celui qu'il nous présente ici. Les homélies sur saint Matthieu pour la période d'Antioche et les lettres à Olympias pour le temps de l'exil ont été tout particulièrement utilisées, sans que le reste de l'œuvre ait été pour autant négligé. C'est une petite Somme chrysostomienne sur la souffrance que nous avons désormais à notre disposition.
Le premier chapitre traite successivement de l'attitude de Jean devant le problème du mal et celui de la souffrance. La solution manichéenne qui voit l'origine des maux dans un principe mauvais est irrecevable, car elle est opposée au monothéisme et à la bonté foncière de la création. La réponse fataliste qui nie la liberté humaine rend vaine toute activité. Le démon est sans doute à même de déchaîner beaucoup de calamités, mais il ne peut déployer son activité qu'avec la permission divine et se trouve incapable d'agir sur notre volonté. Il reste que l'homme soit l'auteur du mal. Du même coup, il l'est de la souffrance. Dans ce contexte, Jean fait observer qu'on peut distinguer les choses bonnes, mauvaises et indifférentes. Si notre jugement est droit, nous n'estimerons préjudiciables que les choses réellement mauvaises; or ne sont mauvaises que celles qui portent atteinte à notre valeur morale: le bien véritable. Socrate autrefois ne soutenait pas une thèse différente, quand il prétendait que le criminel est plus malheureux que sa victime ; et les stoïciens ou encore l'auteur plutarchéen du An vitiositas ad infelicitatem sufficiat ? eussent volontiers souscrit à la proposition de Jean que nul ne pourra nuire à celui qui ne se fait pas de tort à lui-même. Notre saint n'avait pas oublié, on le voit, les leçons de ses maîtres païens : le rhéteur Libanios, le philosophe Andragathias. Parfois il se contente d'habiller à la chrétienne une pensée stoïcienne ou socratique, ou, comme le note E. Nowak, « sans effort il passe d'un thème stoïcien à des citations de l'Ecriture, où il trouve des exemples pour illustrer sa conception » (p. 88).
Dans le second chapitre est traitée la question de la relation de Dieu avec la souffrance du monde. Si la lucidité de l'intelligence permet de corriger les opinions erronées sur le bien et sur le mal, et la force d'âme de supporter les inévitables coups du sort et donc d'éviter la souffrance, on peut toujours se demander quelle est la raison de cette souffrance. La foi chrétienne en indique au croyant le pourquoi. Assurément l'homme ne peut accéder au mystère divin : les voies de Dieu demeurent impénétrables, mais il nous est possible de sentir dans notre propre vie et celle d'autrui la main de Dieu. Cette action prend la forme d'une économie providentielle, où la souffrance a sa place marquée, pour le bien véritable de l'homme. Ce n'est point simple vue de l'esprit mais tangible réalité, si l'on croit que Dieu est amour et qu'il a donné son Fils unique pour la rédemption de l'humanité. « Ainsi, remarque E. Nowak, la vieille argumentation philosophique sur la Providence, tirée de la beauté, de l'ordre, de l'harmonie, de l'utilité du monde, a reçu chez Jean un accent nouveau ... » (p. 136).
Le Christ rédempteur a opéré par ses souffrances le salut du monde, le chrétien trouve dans ses propres souffrances la possibilité de se sanctifier. Là encore le Christ est son modèle. Mais la souffrance, loin d'être un mal, a même une valeur positive, tant pour le pécheur que pour le juste: c'est l'objet du troisième chapitre. Dieu permet la souffrance pour punir le péché qui mérite un châtiment, bien plus pour libérer le pécheur du fardeau de ses fautes, mais aussi pour détourner les autres hommes du mal. De la sorte, Dieu se comporte en médecin qui voulant à tout prix sauver son malade lui applique un sévère traitement, mais recourt à ces remèdes en temps opportun. Si la souffrance se révèle favorable au pécheur, elle est également bonne pour le juste. Ce dernier en tire une véritable gloire, car le juste souffrant est pour son entourage un objet d'admiration. Il y trouve un accroissement de ses forces spirituelles et dispense à autrui un enseignement sur la primauté des valeurs morales. La souffrance du juste est en outre un témoignage rendu aux vérités chrétiennes. L'exemple le plus caractéristique est le témoignage du sang versé. Or l'on sait combien était répandu à cette époque chez les chrétiens d'Antioche le culte des martyrs. Enfin le juste souffrant trouvera sa récompense dans son entrée dans le royaume des cieux, car en se conformant au Christ mort au péché, il doit participer à sa résurrection glorieuse.
Dans la conclusion générale E. Nowak présente en raccourci l'attitude de Jean devant le problème de la souffrance. « S'en tenant à la raison, Chrysostome cherche l'intelligence de la souffrance au terme d'une réflexion sur le donné révélé, sur la marche du monde et sur la vie de l'homme » (p. 223). Mais il encourt le même reproche qu'Épictète, celui de rejeter l'expérience humaine et de nier la réalité de la souffrance. On pourrait même être surpris qu'un adversaire aussi résolu des philosophes païens leur ait emprunté tant d'arguments, mais telle est la force des courants d'idées : on condamne les auteurs pernicieux et on suit leur doctrine. En va-t-il autrement aujourd'hui tant pour les clercs que pour les fidèles à l'endroit des philosophies modernes ?
Jean semble parfois identifier le Christ avec le Sage de la Stoa. Il ne montre guère non plus le rapport qui existe entre le péché originel et la souffrance humaine. Mais voit-il dans le péché originel un véritable péché dont les descendants d'Adam fussent responsables ? On est en droit d'en douter. Enfin moraliste et non mystique, il n'applique pas à tout chrétien ce que saint Paul disait de lui-même qu'il accomplissait dans sa chair les souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Mais ce sont là ombres légères. Reconnaissons plutôt avec E. Nowak que « le christianisme, jeune et libre, a trouvé en Chrysostome un de ses plus éminents représentants, un homme qui a mis toutes les richesses de sa haute culture à son service » (p. 228).
Une bibliographie fort précieuse, un index des mots grecs, un index des auteurs cités, un index scripturaire complètent cet ouvrage auquel nous souhaitons une large diffusion.
A la page 213, on corrigera Rhôdes en Philoctète.
Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com
Le moteur peut rechercher dans différents champs :
- Un nom d’auteur (AUTEUR)
- Un mot du titre (TITRE)
- Un ISBN
- Un mot du texte de présentation (TEXTE)
- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).
La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.
En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.
Search engine www.editions-beauchesne.com
The engine can search in different fields:
- An author's name (AUTEUR)
- A word from the title (TITRE)
- An ISBN
- A word from the presentation text (TEXTE)
- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).
The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.
Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.