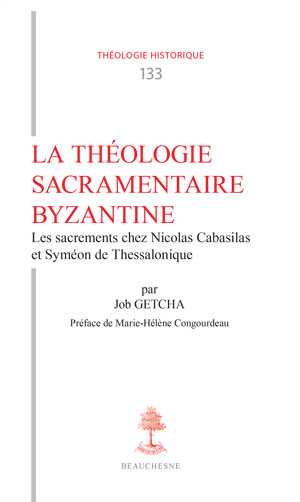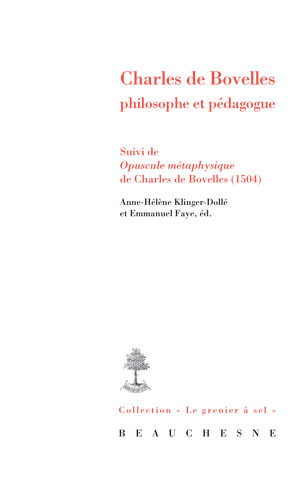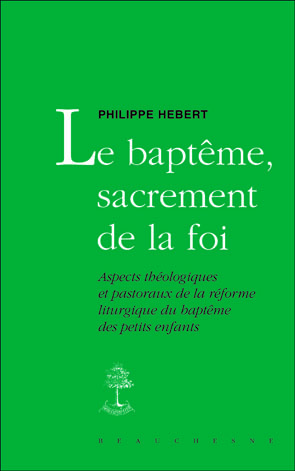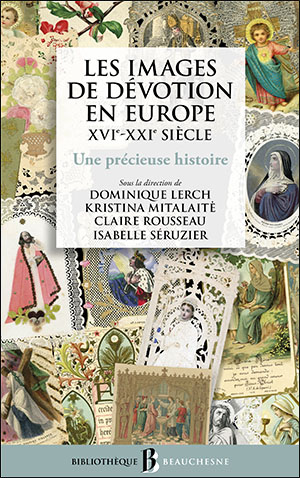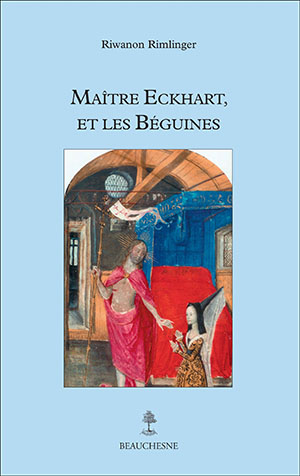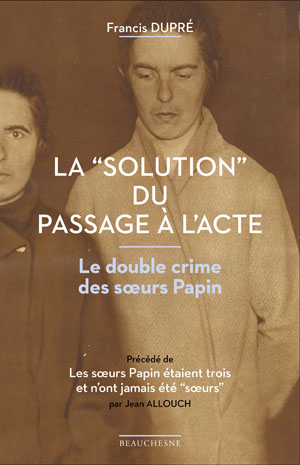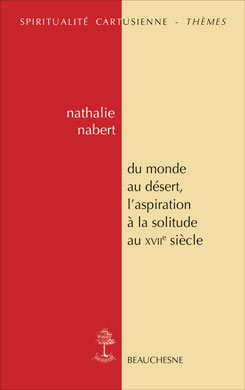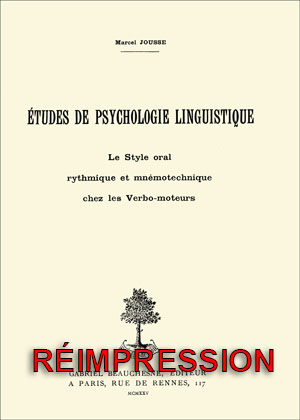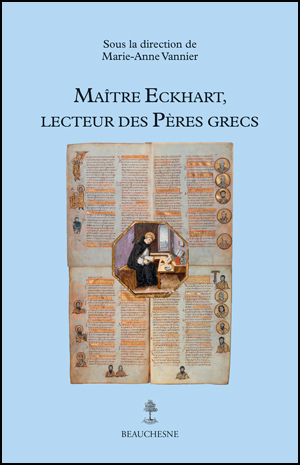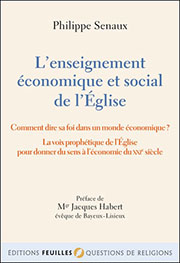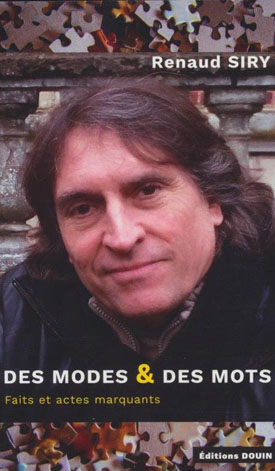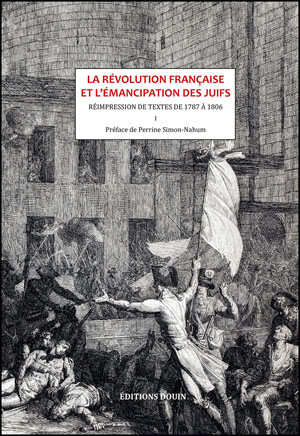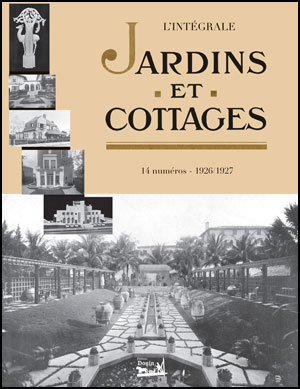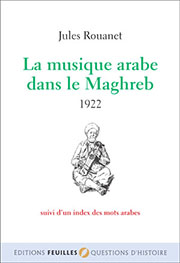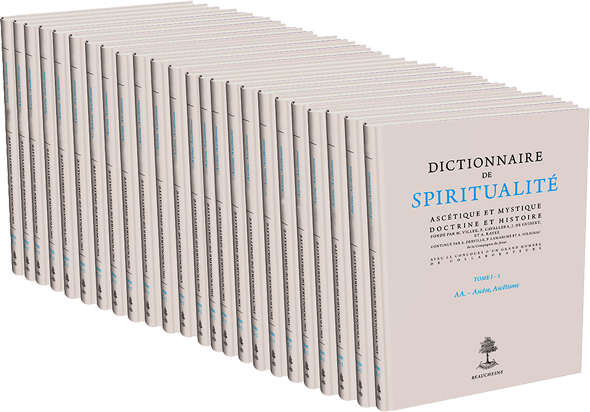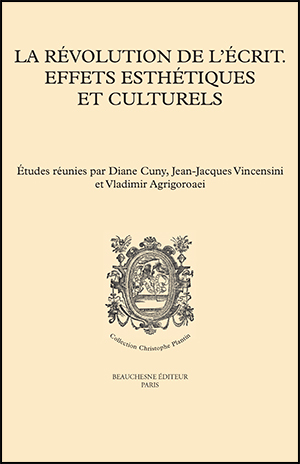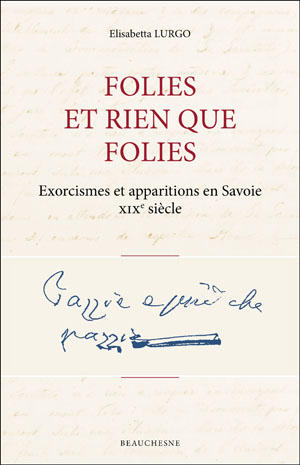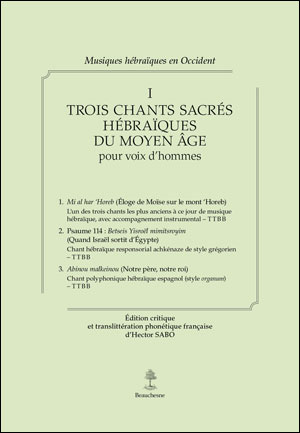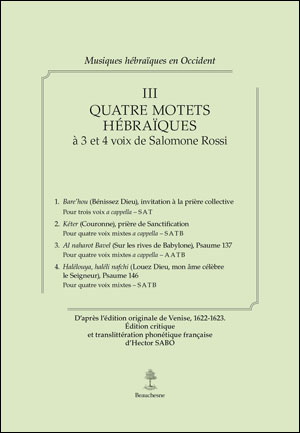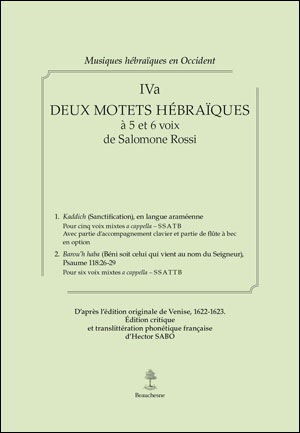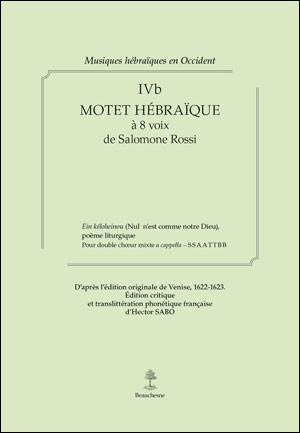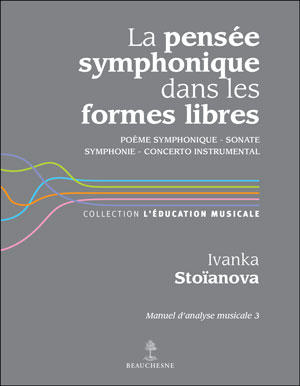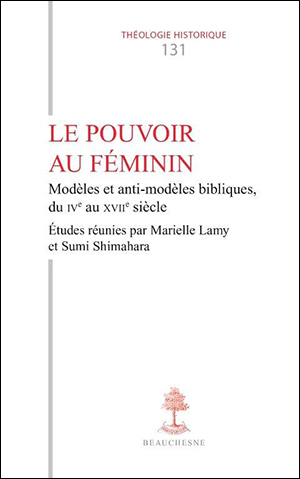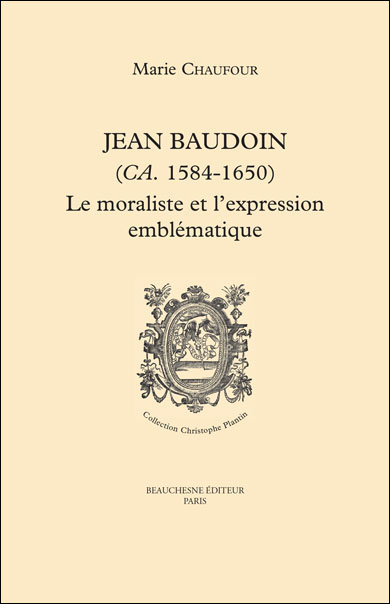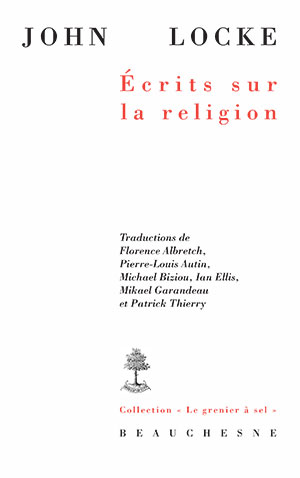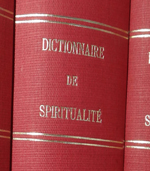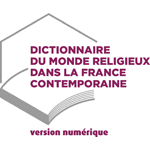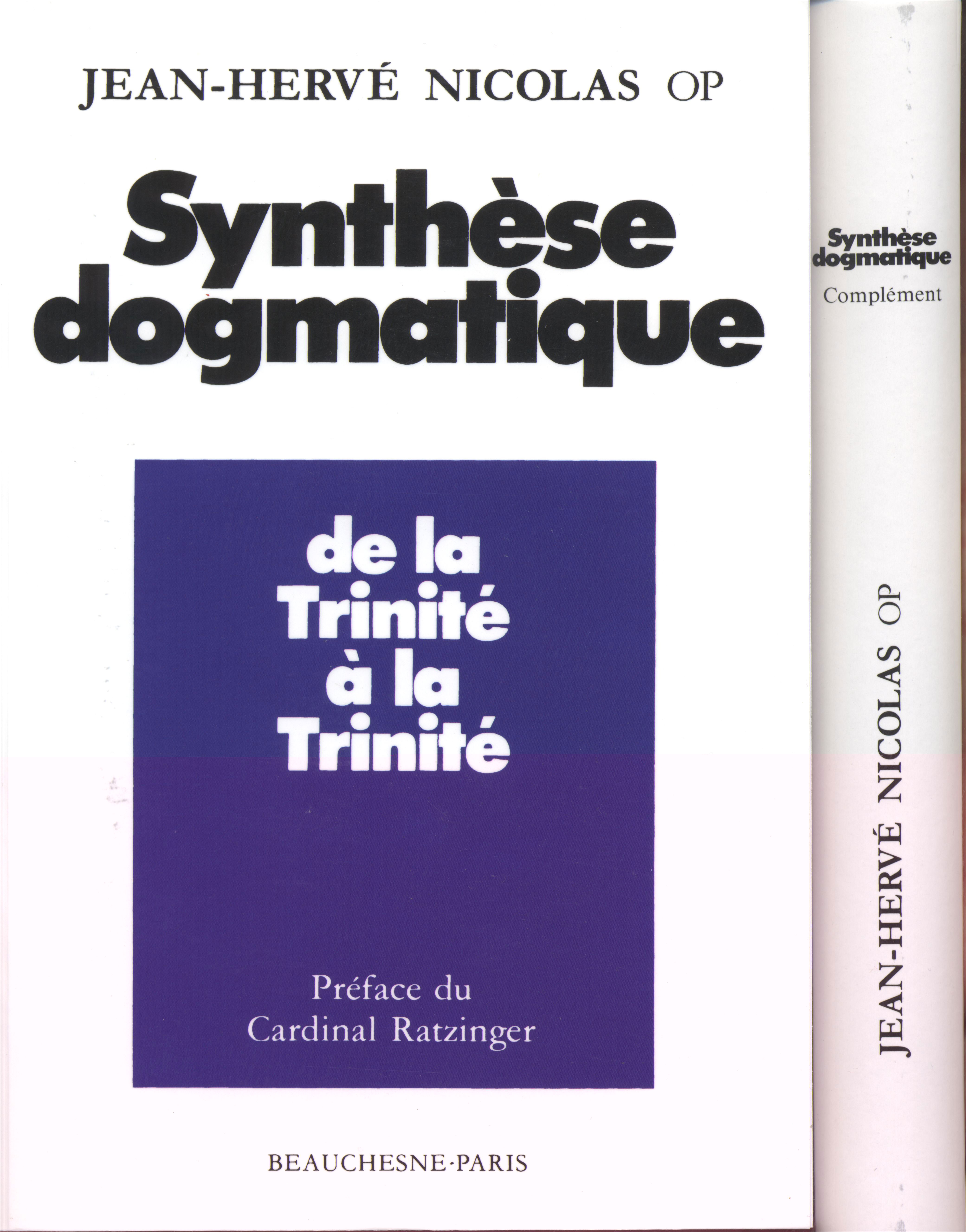0.00 €
TH n°019 LE CHRÉTIEN DEVANT LA SOUFFRANCE. ÉTUDE SUR LA PENSEE DE JEAN CHRYSOSTOME
Date d'ajout : mardi 18 juillet 2017
par P.J COOLS
BIBLIOTECA ORIENTALIS, XXXI, 3-6, novembre 1971
Le problème de la souffrance heurte la pensée humaine depuis toujours. La souffrance physique, le désordre moral, social et religieux ont entraîné beaucoup d'hommes à poser de multiples questions sur le problème du mal. La recherche de l'origine de maux si divers était une question abordée par nombre de philosophes et de sages du temps de St. Jean Chrysostome. Les circonstances ne permettaient pas à celui-ci de se désintéresser d'un problème qui recevait à cette époque des solutions si divergentes d'où naissaient tant d'erreurs et de confusions parmi les fidèles. Jean ne donne pas un exposé méthodique et objectif du mal. Sa pensée, sur ce point comme sur d'autres, est dispersée dans toute son œuvre, exposée selon les besoins du moment. Ce grand orateur et pasteur d'âmes prêche pour un vaste auditoire composé de gens insuffisamment formés dans le christianisme, simples, perméables aux erreurs et incapables d'approfondir l'enseignement qui leur était donné. L'exposé du pasteur devait s'en tenir aux éléments fondamentaux de la doctrine et de morale chrétienne. Dans ce livre, Nowak nous a donné une synthèse très claire et bien ordonnée d'une foule de textes dispersés dans des homélies, des lettres, des commentaires de Jean Chrysostome.
Dans le premier chapitre de son livre, notre auteur fait la recherche des causes de la souffrance sous son aspect philosophique, à savoir dans sa connexion sur l'origine des maux, qu'on ne doit chercher ni dans la nature, ni en Dieu, ni dans un principe éternel du mal, ni dans le démon, ni enfin dans le fatalisme. C'est dans l'intimité de l'être, désignée par le mot proairèsis, qu'il voit l'origine du mal.
Ce mot proairèsis a une riche tradition littéraire et a revêtu dans son histoire des significations diverses. Pour Jean, un des traits caractéristiques de cette proairèsis est le caractère de liberté. Jean s'acharne à défendre cette affirmation, contraint par la nécessité de combattre le fatalisme et le manichéisme. Le deuxième trait est l'élément intellectuel, le jugement que nous portons sur les choses. Le rôle prépondérant dans la fonction de la décision est attribué au facteur intellectuel, à savoir au jugement. La proairèsis est exclusivement dépendante de l'homme, elle lui est propre. C'est elle qui constitue l'homme, plus que l'essence. La conclusion pour Jean est que la proairèsis de l'homme est responsable des causes des maux et que le péché est la vraie cause de la souffrance.
Pour Chrysostome, le seul malheur se présente sous la forme du péché. Le mal véritable, c'est d'offenser Dieu. Ainsi, en parlant de choses indifférentes, il élimina la souffrance, les épreuves, les souffrances atroces, les méchancetés qui font souffrir bien douloureusement les hommes. Ces épreuves, à condition d'être acceptées par le vrai chrétien, 'le philosophe', n'ont rien de redoutable et elles peuvent être dominées par la raison sans le troubler. Faire le mal, c'est le subir ; le subir c'est au contraire recevoir un bien. Nul ne pourra nuire à celui qui ne se fait pas tort à lui-même.
Ces deux principes, remarque Nowak, qui assurent au chrétien-philosophe une conduite sereine dans la souffrance, ne sont cependant pas la fruit de la doctrine chrétienne. Ce sont des thèmes d'origine socratique ou platonicienne, repris ensuite par les Cyniques et les Stoïciens. Cependant la notion du mal moral est sans aucun doute différente chez Chrysostome et chez les Stoïciens. Le Stoïcisme y voit, en effet, la rupture de l'ordre voulu par la nature: le péché, tel que le conçoit Jean, est au contraire l'offense faite à Dieu, bien qu'il garde aussi le sens d'une dégradation de la nature humaine. Pour Chrysostome la souffrance a un caractère rationnel. La souffrance est pour lui un problème, un sujet complexe qui renferme plusieurs données, parfois opposés, qu'il devra ordonner dans une totalité intelligible, satisfaisant aux exigences de la raison. Mais Jean est assez chrétien pour savoir que la réalité divine est un élément essentiel pour résoudre ce problème. Il sait que la réalité divine surpasse infiniment la raison humaine, qui peut seulement pressentir une richesse extraordinaire cachée.
En la plaçant devant le mystère, Jean indique à l'intelligence la clé du problème de la souffrance, dans la mesure où elle peut y accéder. Mais après être arrivé à constater par la raison le mystère, il demeure sur le plan rationel. Il ne semble pas qu'il a pénétré la dimension mystique de la souffrance. S'en tenant à la raison, Chrysostome cherche l'intelligence de la souffrance en termes d'une réflexion sur le donné révélé, sur la marche du monde et sur la vie de l'homme. Notre orateur est resté fidèle à l'idéal intellectuel grec et n'a pas fait d'effort pour le surpasser. Le portrait brossé par le stoïcisme du philosophe-héros, indifférent à la souffrance, soutenant toutes les adversités avec une haute noblesse d'esprit, s'identifie parfaitement avec l'idéal du chrétien-philosophe de Chrystotome.
Mais le fait d'avoir adopté les idées des Stoïciens expose Chrysostome à des critiques. En acceptant la conception stoïcienne de la souffrance, il essaie de supprimer la douleur à force de raisonnements. Ici il faut bien constater une grande différence entre la solution offerte dans le Nouveau Testament au problème de la souffrance et la solution de Chrysostome. Le christianisme ne supprime pas la douleur par des raisonnements, mais la laisse subsister dans ce qu'elle a de tragique et de révoltant, tout en nous conseillant l'union avec le Christ, qui est venu assumer et diviniser la souffrance. Il faut bien constater que cette vue fondamentale du christianisme apparaît peu chez Jean Chrysostome. Parce qu'il adopte la solution philosophique du Stoïcisme, Chrysostome ne réussit pas à élaborer pleinement l'aspect théologique de la souffrance.
Un autre point que la théologie postérieure mettra en évidence, c'est la relation étroite entre la souffrance et le péché originel. Sans aucun doute Jean reconnaît la souffrance comme une de ses conséquences. Pourtant ce point n'a pas été considéré par lui suffisamment et n'apparaît guère dans ses idées.
Jean Chrysostome, un des plus grands orateurs du christianisme, est resté le fils de son temps et de son milieu. Élevé dans la culture grecque, il a gardé toute sa vie les conceptions de son éducation première, s'efforçant de les intégrer, consciemment ou inconsciemment, dans sa vision chrétienne.
L'ouvrage de M. Nowak intéressera, comme dit la couverture, avec les spécialistes des études patristiques, les moralistes et les historiens de la pensée chrétienne.
Le problème de la souffrance heurte la pensée humaine depuis toujours. La souffrance physique, le désordre moral, social et religieux ont entraîné beaucoup d'hommes à poser de multiples questions sur le problème du mal. La recherche de l'origine de maux si divers était une question abordée par nombre de philosophes et de sages du temps de St. Jean Chrysostome. Les circonstances ne permettaient pas à celui-ci de se désintéresser d'un problème qui recevait à cette époque des solutions si divergentes d'où naissaient tant d'erreurs et de confusions parmi les fidèles. Jean ne donne pas un exposé méthodique et objectif du mal. Sa pensée, sur ce point comme sur d'autres, est dispersée dans toute son œuvre, exposée selon les besoins du moment. Ce grand orateur et pasteur d'âmes prêche pour un vaste auditoire composé de gens insuffisamment formés dans le christianisme, simples, perméables aux erreurs et incapables d'approfondir l'enseignement qui leur était donné. L'exposé du pasteur devait s'en tenir aux éléments fondamentaux de la doctrine et de morale chrétienne. Dans ce livre, Nowak nous a donné une synthèse très claire et bien ordonnée d'une foule de textes dispersés dans des homélies, des lettres, des commentaires de Jean Chrysostome.
Dans le premier chapitre de son livre, notre auteur fait la recherche des causes de la souffrance sous son aspect philosophique, à savoir dans sa connexion sur l'origine des maux, qu'on ne doit chercher ni dans la nature, ni en Dieu, ni dans un principe éternel du mal, ni dans le démon, ni enfin dans le fatalisme. C'est dans l'intimité de l'être, désignée par le mot proairèsis, qu'il voit l'origine du mal.
Ce mot proairèsis a une riche tradition littéraire et a revêtu dans son histoire des significations diverses. Pour Jean, un des traits caractéristiques de cette proairèsis est le caractère de liberté. Jean s'acharne à défendre cette affirmation, contraint par la nécessité de combattre le fatalisme et le manichéisme. Le deuxième trait est l'élément intellectuel, le jugement que nous portons sur les choses. Le rôle prépondérant dans la fonction de la décision est attribué au facteur intellectuel, à savoir au jugement. La proairèsis est exclusivement dépendante de l'homme, elle lui est propre. C'est elle qui constitue l'homme, plus que l'essence. La conclusion pour Jean est que la proairèsis de l'homme est responsable des causes des maux et que le péché est la vraie cause de la souffrance.
Pour Chrysostome, le seul malheur se présente sous la forme du péché. Le mal véritable, c'est d'offenser Dieu. Ainsi, en parlant de choses indifférentes, il élimina la souffrance, les épreuves, les souffrances atroces, les méchancetés qui font souffrir bien douloureusement les hommes. Ces épreuves, à condition d'être acceptées par le vrai chrétien, 'le philosophe', n'ont rien de redoutable et elles peuvent être dominées par la raison sans le troubler. Faire le mal, c'est le subir ; le subir c'est au contraire recevoir un bien. Nul ne pourra nuire à celui qui ne se fait pas tort à lui-même.
Ces deux principes, remarque Nowak, qui assurent au chrétien-philosophe une conduite sereine dans la souffrance, ne sont cependant pas la fruit de la doctrine chrétienne. Ce sont des thèmes d'origine socratique ou platonicienne, repris ensuite par les Cyniques et les Stoïciens. Cependant la notion du mal moral est sans aucun doute différente chez Chrysostome et chez les Stoïciens. Le Stoïcisme y voit, en effet, la rupture de l'ordre voulu par la nature: le péché, tel que le conçoit Jean, est au contraire l'offense faite à Dieu, bien qu'il garde aussi le sens d'une dégradation de la nature humaine. Pour Chrysostome la souffrance a un caractère rationnel. La souffrance est pour lui un problème, un sujet complexe qui renferme plusieurs données, parfois opposés, qu'il devra ordonner dans une totalité intelligible, satisfaisant aux exigences de la raison. Mais Jean est assez chrétien pour savoir que la réalité divine est un élément essentiel pour résoudre ce problème. Il sait que la réalité divine surpasse infiniment la raison humaine, qui peut seulement pressentir une richesse extraordinaire cachée.
En la plaçant devant le mystère, Jean indique à l'intelligence la clé du problème de la souffrance, dans la mesure où elle peut y accéder. Mais après être arrivé à constater par la raison le mystère, il demeure sur le plan rationel. Il ne semble pas qu'il a pénétré la dimension mystique de la souffrance. S'en tenant à la raison, Chrysostome cherche l'intelligence de la souffrance en termes d'une réflexion sur le donné révélé, sur la marche du monde et sur la vie de l'homme. Notre orateur est resté fidèle à l'idéal intellectuel grec et n'a pas fait d'effort pour le surpasser. Le portrait brossé par le stoïcisme du philosophe-héros, indifférent à la souffrance, soutenant toutes les adversités avec une haute noblesse d'esprit, s'identifie parfaitement avec l'idéal du chrétien-philosophe de Chrystotome.
Mais le fait d'avoir adopté les idées des Stoïciens expose Chrysostome à des critiques. En acceptant la conception stoïcienne de la souffrance, il essaie de supprimer la douleur à force de raisonnements. Ici il faut bien constater une grande différence entre la solution offerte dans le Nouveau Testament au problème de la souffrance et la solution de Chrysostome. Le christianisme ne supprime pas la douleur par des raisonnements, mais la laisse subsister dans ce qu'elle a de tragique et de révoltant, tout en nous conseillant l'union avec le Christ, qui est venu assumer et diviniser la souffrance. Il faut bien constater que cette vue fondamentale du christianisme apparaît peu chez Jean Chrysostome. Parce qu'il adopte la solution philosophique du Stoïcisme, Chrysostome ne réussit pas à élaborer pleinement l'aspect théologique de la souffrance.
Un autre point que la théologie postérieure mettra en évidence, c'est la relation étroite entre la souffrance et le péché originel. Sans aucun doute Jean reconnaît la souffrance comme une de ses conséquences. Pourtant ce point n'a pas été considéré par lui suffisamment et n'apparaît guère dans ses idées.
Jean Chrysostome, un des plus grands orateurs du christianisme, est resté le fils de son temps et de son milieu. Élevé dans la culture grecque, il a gardé toute sa vie les conceptions de son éducation première, s'efforçant de les intégrer, consciemment ou inconsciemment, dans sa vision chrétienne.
L'ouvrage de M. Nowak intéressera, comme dit la couverture, avec les spécialistes des études patristiques, les moralistes et les historiens de la pensée chrétienne.
Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com
Le moteur peut rechercher dans différents champs :
- Un nom d’auteur (AUTEUR)
- Un mot du titre (TITRE)
- Un ISBN
- Un mot du texte de présentation (TEXTE)
- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).
La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.
En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.
Search engine www.editions-beauchesne.com
The engine can search in different fields:
- An author's name (AUTEUR)
- A word from the title (TITRE)
- An ISBN
- A word from the presentation text (TEXTE)
- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).
The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.
Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.