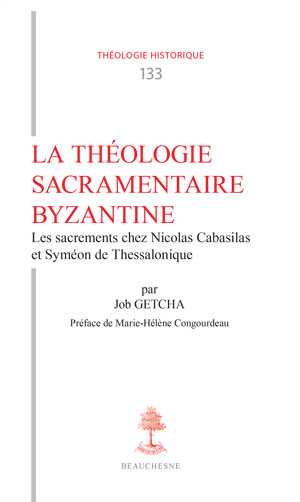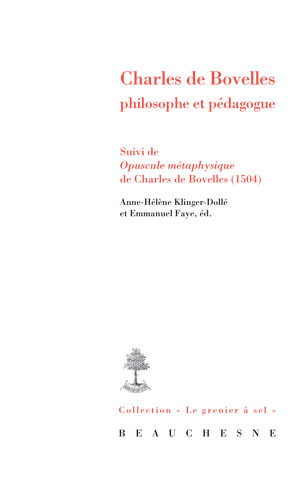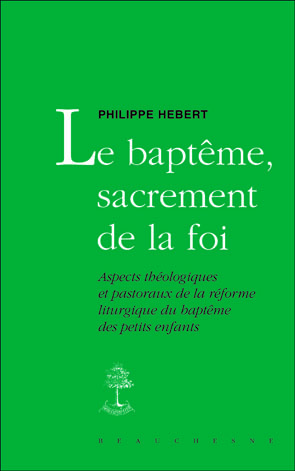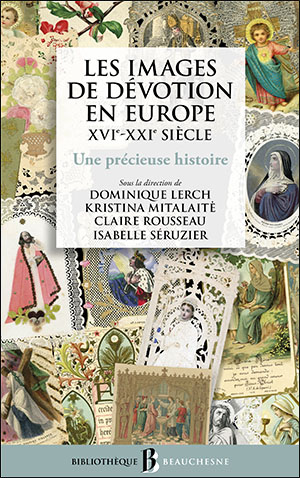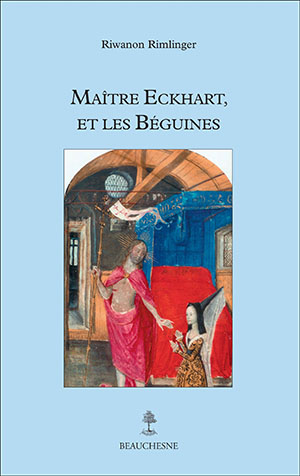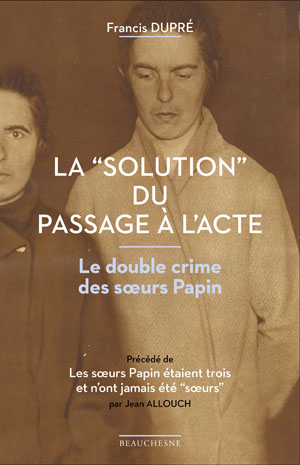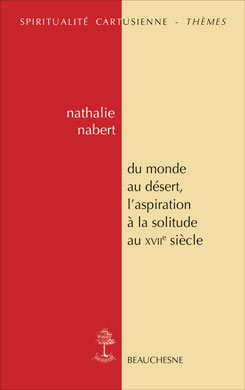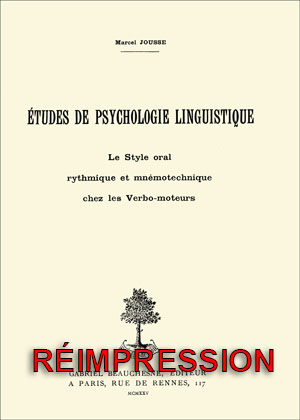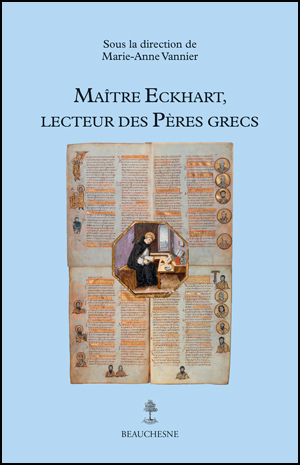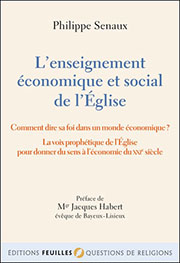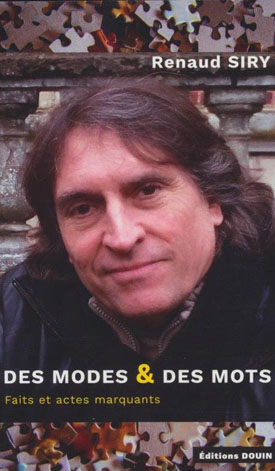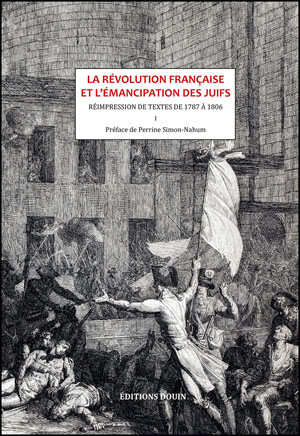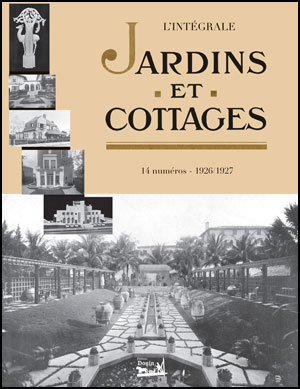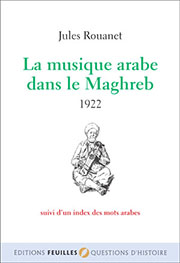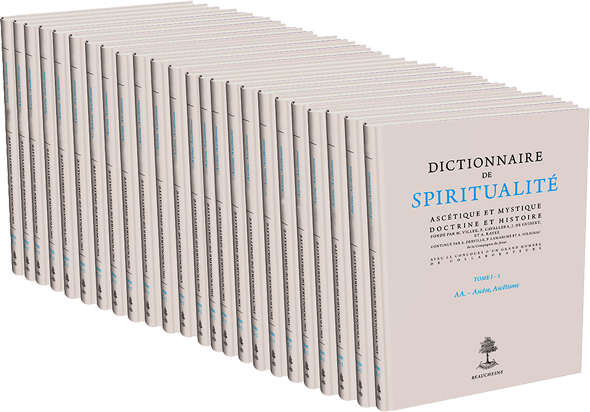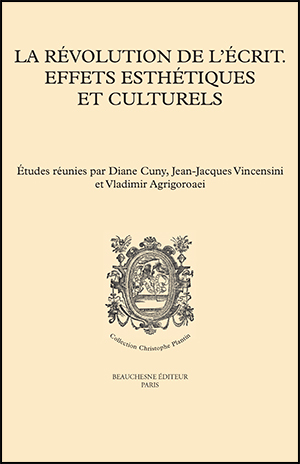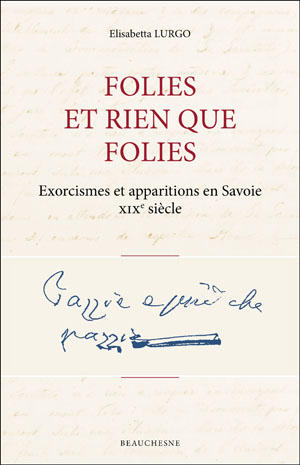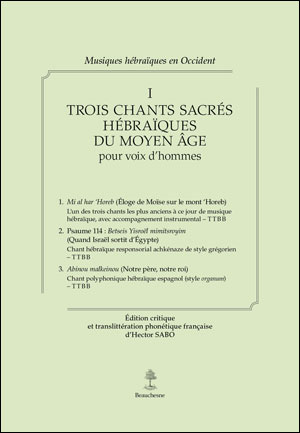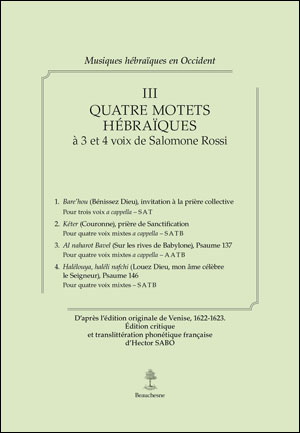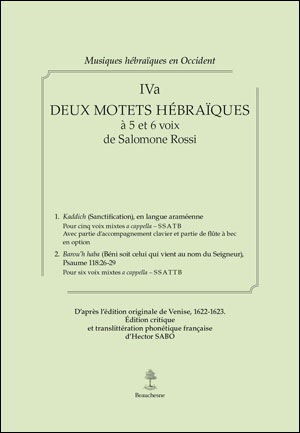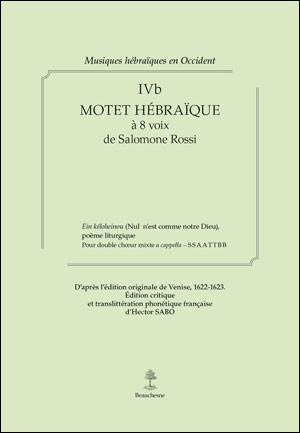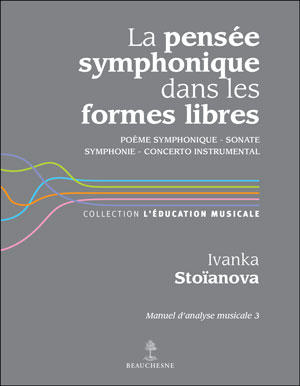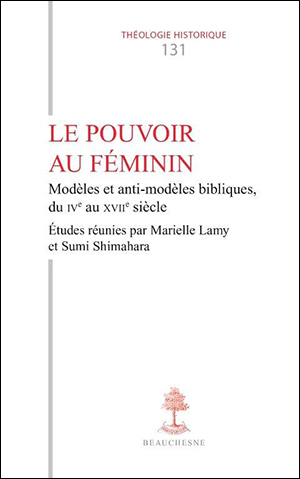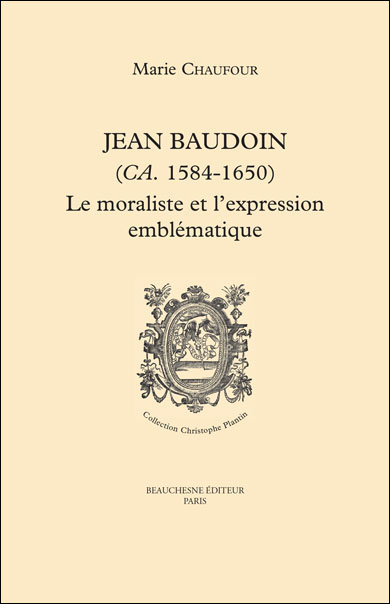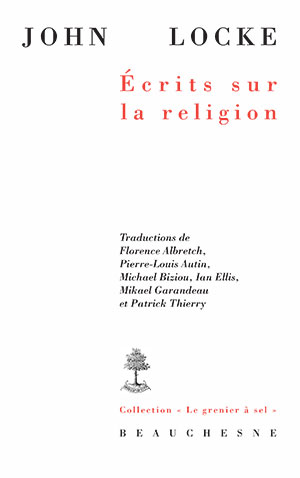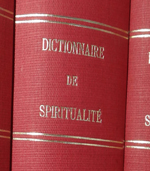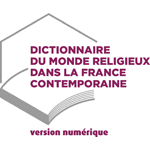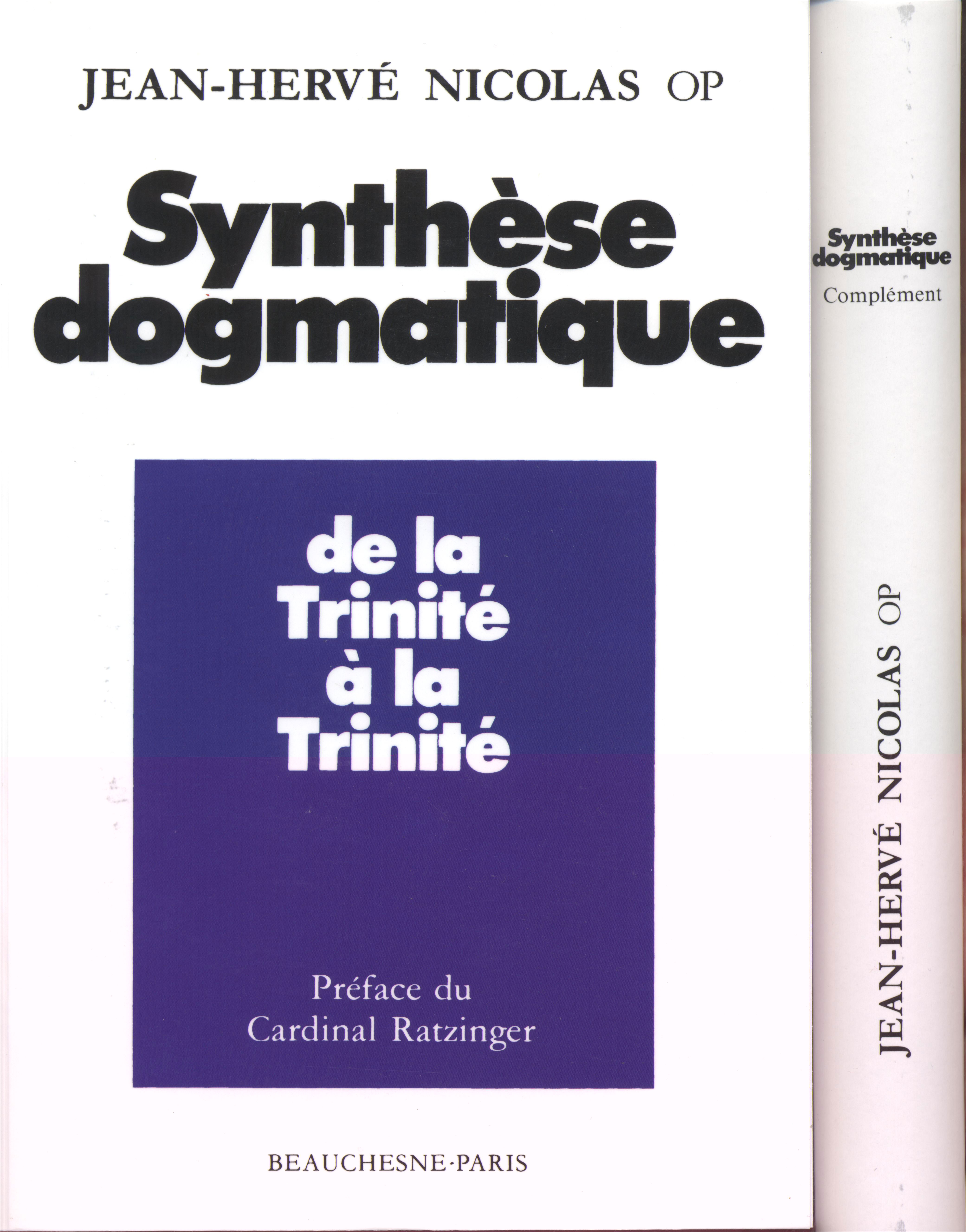Jean-Pierre SCHALLER
|
EAN/ISBN : 9782701022093
|
Nb de pages : 202
|
Année : 2017
|
| 34.00 € |
Confesseur et professeur, théologien et psychologue « praticien», membre de délégations du Saint-Siège à plusieurs Conférences internationales, à l'écoute d'un monde qu'il parcourt sans cesse, M. Jean-Pierre Schaller a trouvé le temps de présenter à l'Université de Paris IV une thèse de troisième cycle qui a fourni la matière du présent ouvrage. C'est dire que ce penseur thomiste, au courant des méthodes médicales et psychanalytiques les plus récentes, a brillamment réussi à se plier aux exigences de la philologie et de l'histoire.
M. Schaller étudie quelque quatre cents volumes, de dates et même de langues différentes. Il a su en faire un ensemble cohérent en cherchant l'unité, non du côté des auteurs, mais de celui du public français qui, depuis cent cinquante ans, s'est nourri non seulement de productions nouvelles, mais de traductions et de rééditions plus ou moins fidèles : ce dernier trait ne doit pas étonner, puisque les lecteurs dévots ont longtemps préféré à la bande « vient de paraître » la consécration des siècles, surtout quand s'y joint l'approbation solennelle de l'Église. Ces « réemplois » ne laissaient pourtant pas de faire problème, car la profonde évolution de la société et des mentalités pendant plusieurs siècles ne permettait pas de lire ces classiques avec les mêmes préoccupations que ceux à qui ils étaient destinés (cela d'autant plus qu'il s'agit généralement de lettres de direction). Mais les scrupules historiques resteront longtemps étrangers aux compilateurs du XIXe siècle : Beaudenom avoue même ne recourir à saint François de Sales que pour « s'adapter plus facilement aux pauvres âmes de son temps ».
Dans la mesure où l'on peut fixer une date, le tournant se place en 1875 avec les « petites leçons » données dans la crypte de Saint-Augustin par le vicaire Henry Huvelin, ancien normalien. Il n'en sortira d'abord qu'un mince recueil, Bossuet, Fénelon et le quiétisme, mais avec son ami Henri Housaye, Huvelin est aussi à l'origine du renouveau de la spiritualité bérullienne, victime pendant deux siècles d'un oubli presque total. Henri Brémond, « écho sonore », mettra à la portée d'un très large public ces intuitions géniales dans son Histoire littéraire du sentiment religieux.
L'effort historique que s'est imposé M. Schaller n'a pas été vain sur d'autres plans. Il lui a permis de montrer que certaines méthodes que l'on croit nouvelles ont, en fait, de solides lettres de noblesse : la recherche des fausses motivations était par exemple recommandée dès le milieu du XVIIe siècle par un Jean-François Senault ou un Jacques Esprit. Un colloque tout récent sur la névrose obsessionnelle (1975) vient d'être illustré par la publication intégrale du Traité des scrupules de J.J. Duguet (1717). « En psychiatrie, écrit le Prof Yves Pélicier, le moderne est souvent de l'ancien oublié. Pour ne rien perdre, ii faut chercher en avant et en arrière » [Yves PÉLICIER, Colloque sur la névrose obsessionnelle suivie de l'intégralité du traité des scrupules de J.J. Duguet (1717). Éditions Pfizer, Vapeurs 2, Paris, 1976 (Laboratoires Pfizer, 86, Rue de Paris, 91400 Orsay), p. 7.]. M. Schaller applique le principe à la direction et il a lui-même souligné le parallélisme de sa démarche « pluridisciplinaire » avec celle du docteur Alexis Carrel, tout en marquant l'impossibilité de ramener le religieux air naturel.
D'aucuns jugeront sans doute qu'une étude sur la direction spirituelle, si réussie qu'elle soit, ne peut plus désormais être qu'un « inventaire après décès » : il ne s'agirait jamais que d'exercices individuels, détournant de l'activité sociale et interposant en outre un homme entre l'inspiration de l'Esprit et des communautés qu'il serait possible d'étudier d'un point de vue quantitatif. Ces modes seraient plus redoutables si elles ne se heurtaient à d'autres tendances : sans parler de la psychanalyse, non seulement des protestants remettent en honneur la cure d'âme, mais on cherche de plus en plus des maîtres spirituels en Perse, en Inde, au Thibet et dans le bouddhisme zen [Voir Le maître spirituel dans les grandes traditions d'Occident et d'Orient, Hermès, N° 4, 1967]. De sorte qu'on permettra à un vieil historien du XVIIe siècle de se reporter quatre siècles en arrière. Le clergé français était alors nombreux, mais incapable, et la Réforme semblait drainer les forces vives du christianisme. Et, pourtant, dès 1690, La Bruyère constatait que c'était se singulariser fâcheusement que de n'avoir pas de directeur. Que le XVIIe siècle français ait vu apparaître des spirituels de génie ne rend qu'en partie compte d'un renversement si rapide. Ils n'étaint malgré tout qu'en très petit nombre : « Choisissez un directeur entre mille. disait Avila, et moi je vous dis entre dix mille » - ce mot stupéfiant est de saint François de Sales - et d'autre part Saint-Cyran (« le directeur chrétien par excellence », aux yeux de Sainte-Beuve) n'eut que quelques dizaines de pénitents. C'est en réalité au livre qu'il faut demander l'explication du phénomène. Si Michel Treuvé a publié en 1690 un Directeur spirituel pour ceux qui n'en ont point (Paris, 1690), des centaines d’autres ouvrages (qu'il s'agisse de traités théoriques ou surtout de démarquages de lettres dont on avait ôté les données concrètes) ont joué le même rôle. Nous ne nous étonnerons donc pas que des « guru de poche » (c'est-à-dire de papier) fournissent à l'heure actuelle un exotisme spirituel à bon marché. Tant par la fermeté de sa pensée que par la richesse des textes qu'il cite, le livre de M. Schaller les remplacera avantageusement. Il sera indispensable à ceux qui pratiquent la direction, « art des arts », que les nouvelles découvertes sur « l'homme, cet inconnu » viennent rendre de plus en plus difficile. Mais ceux qui cherchent un secours dans leurs difficultés intérieures n'en apprécieront que plus ce volume de lecture aisée, d'esprit œcuménique, et où l'on reconnaît la main, « non d'un auteur, mais d'un homme ».
Jean ORCIBAL
|
Avertissement 2017
Préface
Avant-propos
Chapitre 1. DIRECTEUR ET DIRECTION D'ÂME
- Direction traditionnelle
Textes officiels
Direction et confession
Des définitions
- La cure d'âme
- L'entretien pastoral
Chapitre II. MODERNE ET MODERNISTE
- Condamnation de l'Église
- Un problème d'affectivité
- Le sens de la communauté
- Une spiritualité constructive
Le sens de la vie
La présence de Dieu
Inquiétude humaine
- Un point de vue différent
Chapitre III. PRÉCURSEURS D UN ESPRIT NOUVEAU
- L'abbé Huvelin
Spiritualité classique
Un ton novateur
Le directeur d'âme
- Charles de Foucauld
« Obéissance parfaite au directeur »
Sainteté quotidienne
Chapitre IV. UNE PSYCHOLOGIE QUI VA EN PROFONDEUR
- Freud et les motivations
- Morale et médecine
- Un lointain appel
Chapitre V. UN INJUSTE PRÉJUGÉ
- Du côté catholique
- Du côté protestant
- Les faits
- Un équilibre surnaturel
Chapitre VI. UN RAPPROCHEMENT
- Correspondance protestante
- Enseignement et traités
- Évolution
Chapitre VII. LA NOTION DE SAINTETÉ (fin du XIXe siècle et début du vingtième)
- Un regard en arrière
Une optique négative
La sainteté pour chacun
- Le XIXe siècle
Le Curé d'Ars
La fin du siècle
- Le début du XXe siècle
Les premières années du XXe siècle
Points de vue catholique et protestant .
Chapitre VIII. UNE SAINTETÉ PLUS OUVERTE AU MONDE (Première moitié du XXe siècle)
- Un style nouveau
- Le Saint et le Héros
- Une préoccupation générale
Les traductions
Les philosophes
Les romanciers
- L'esprit d'enfance
Postface
Bibliographie
|
 |