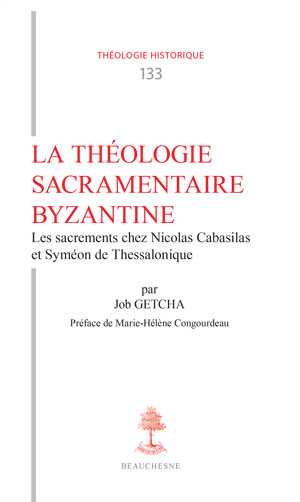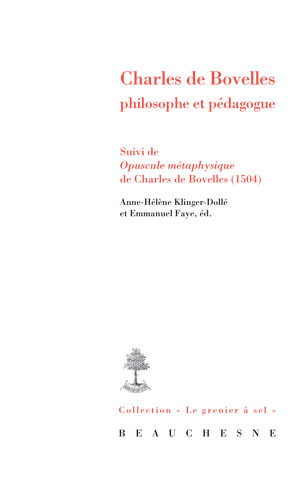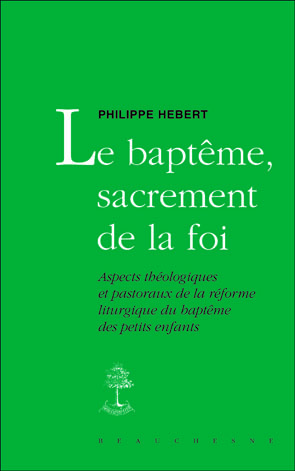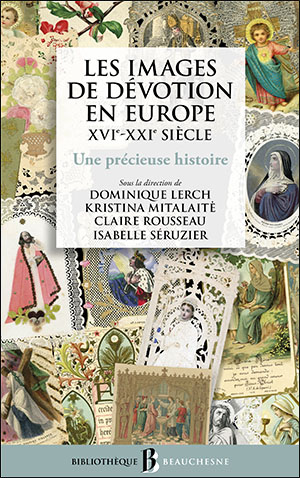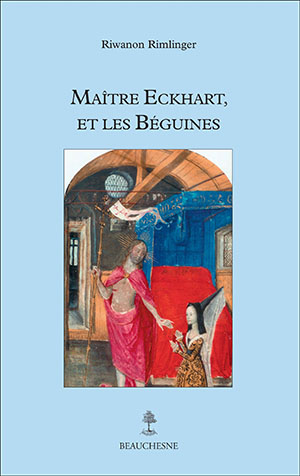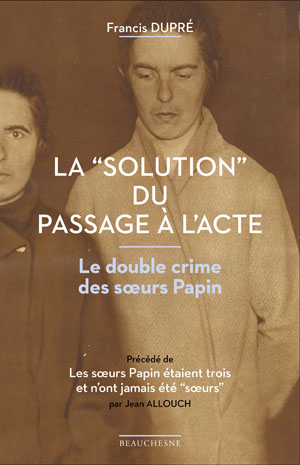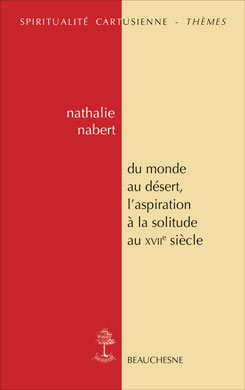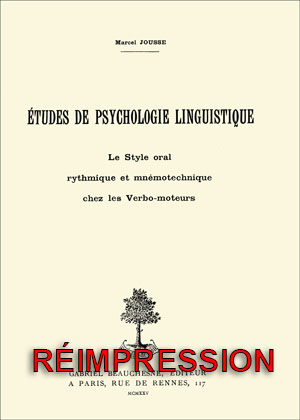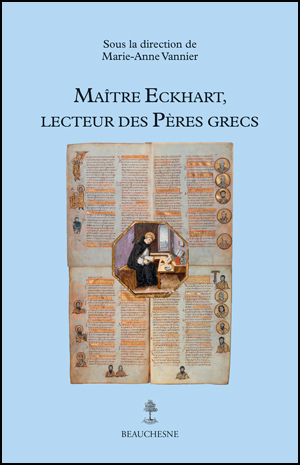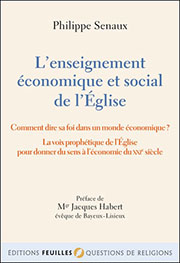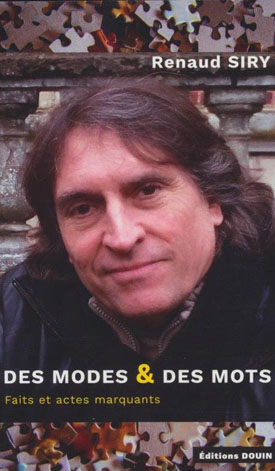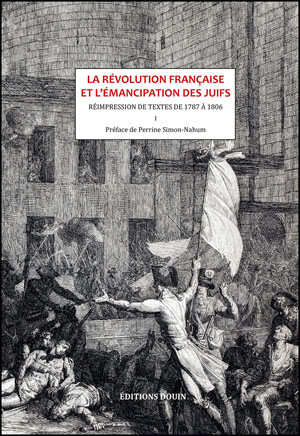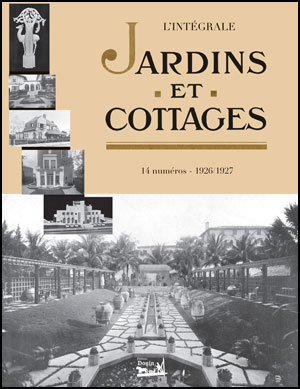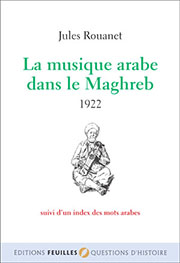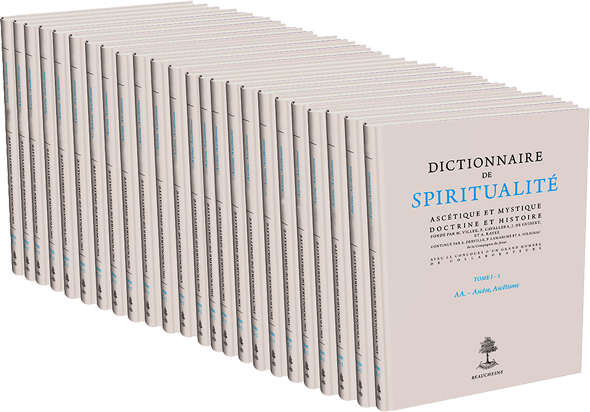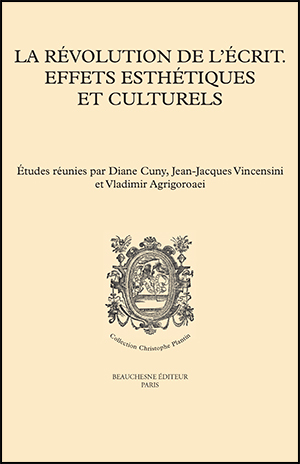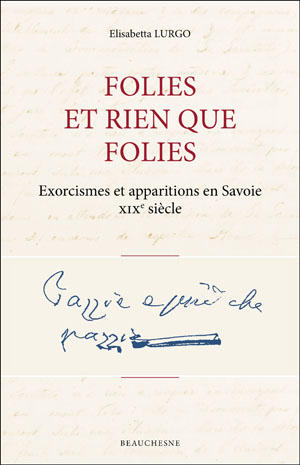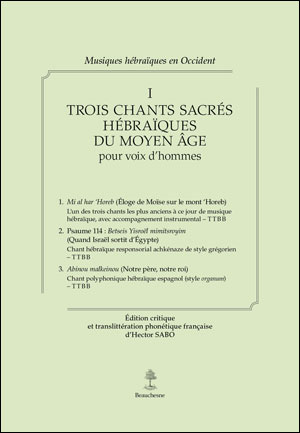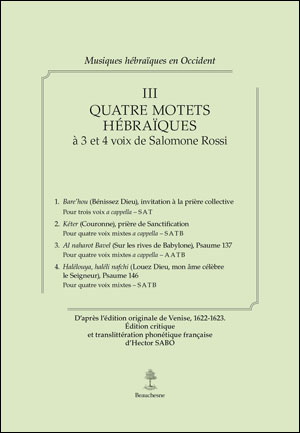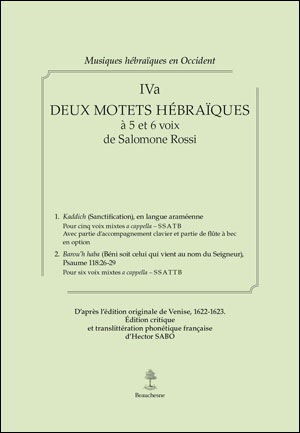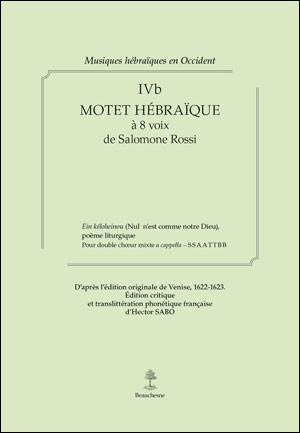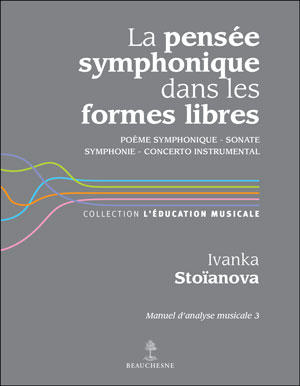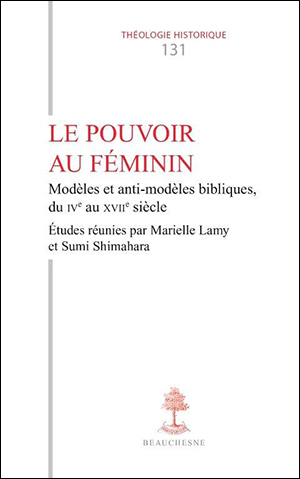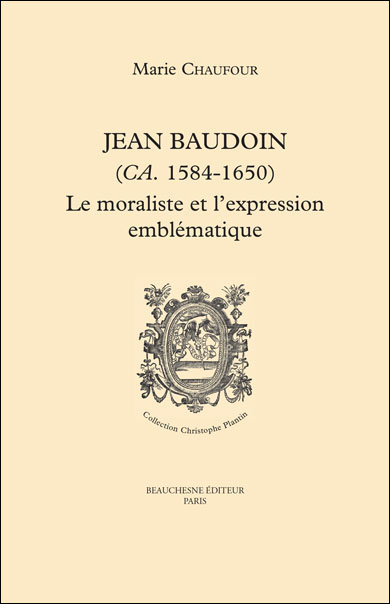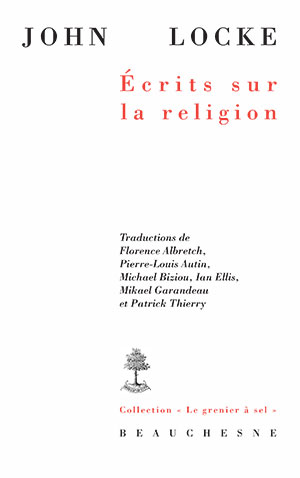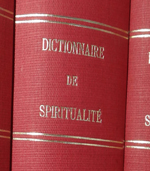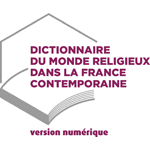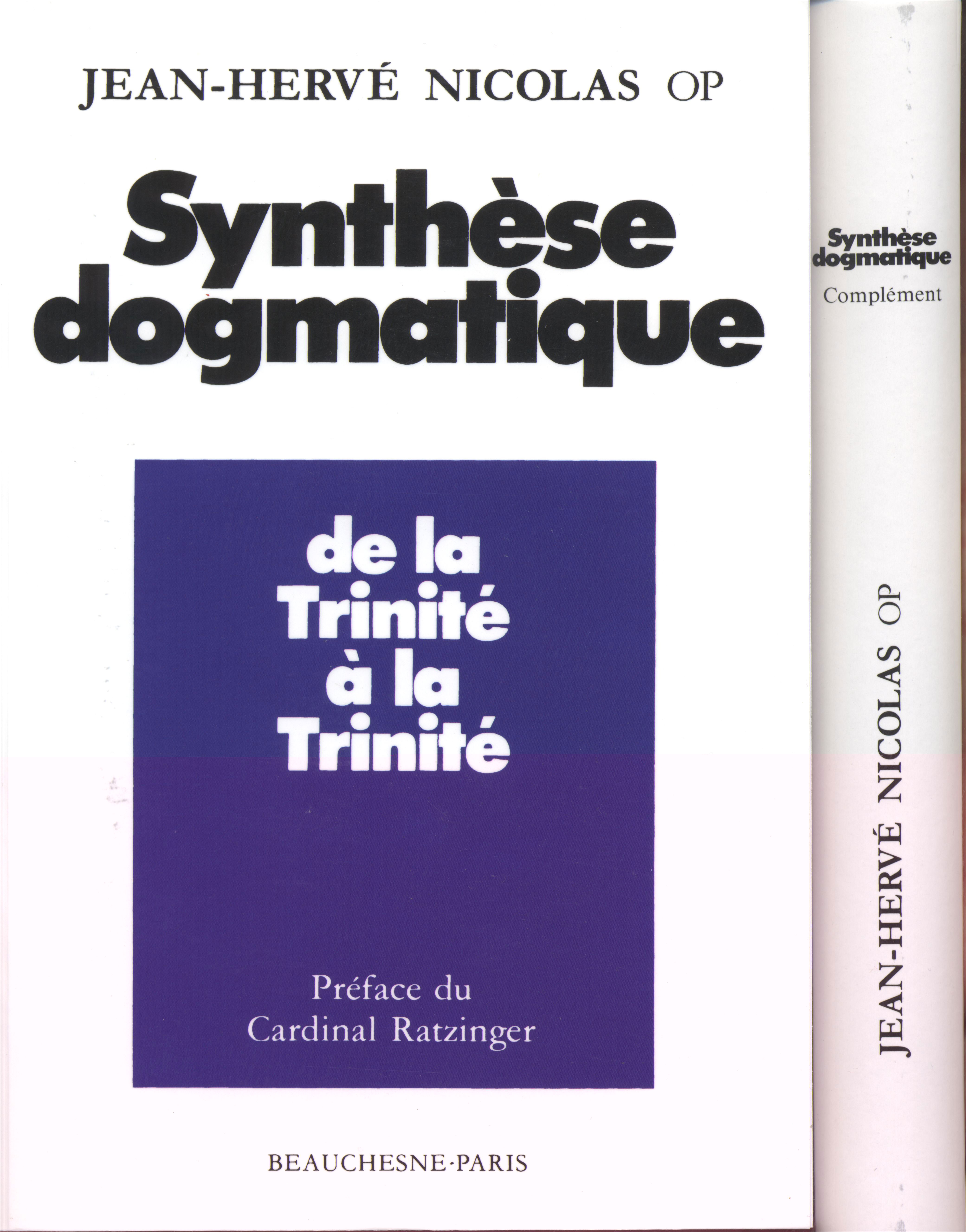Guy DE BROGLIE
|
EAN/ISBN : 9782701003429
|
Nb de pages : 192 p
|
Année : 1965
|
| 24.00 € |
[…] Deux questions, en particulier, nous ont semblé mériter une étude un peu approfondie : 1. Dans quelle mesure l'exposé conciliaire devra-t-il s'appuyer sur l'Écriture sainte et les données fondamentales de la foi, ou, au contraire, sur des arguments de raison, empruntés à des considérations de droit naturel ? et, 2. Quelle attitude la Déclaration devra-t-elle adopter à l'égard des positions antérieures de l'Église, qui, comme on sait, furent pendant quinze siècles peu favorables à la thèse qu'il s'agit maintenant de proclamer ? C'est à ces deux questions que voudraient répondre, au moins en quelque mesure, les deux études qui constituent l'essentiel du présent ouvrage et auxquelles nous avons donné pour titres : Liberté religieuse et Révélation évangélique, Liberté religieuse et Fluctuations théologiques.
La première des deux questions mentionnées est plus complexe qu'il ne semble, parce qu'on a trop souvent ignoré ou méconnu l'équivoque qui se cache sous la notion de « droit à la liberté religieuse ». Il faut, en effet, (et c'est à certains égards la clef de tout), distinguer en matière religieuse deux « droits à la liberté », profondément différents. Il y a d'abord celui qui nous est directement et indubitablement enseigné dans l'Évangile, du fait même que Dieu nous y enseigne la vraie religion ; puisqu'en nous révélant comment Il entend être servi par les hommes, le Créateur nous révèle en même temps et le devoir et le droit que nous avons de Le servir en cette manière, réprouvant et excluant par là même tout prétendu « droit » qui 'voudrait s'y opposer. Mais, en dehors même de ce droit sacré à la liberté, qui nous est révélé dans l'Évangile comme un privilège absolu et inviolable de la vraie religion, on peut parler aussi d'un droit général « à la liberté en matière de religion », c'est-à-dire d'un droit dont bénéficient pareillement tous les tenants d'une opinion quelconque en matière religieuse, que cette opinion soit vraie ou fausse, qu'elle soit positive ou négative (comme chez les agnostiques et les athées), qu'elle naisse d'un désir sincère d'adhérer ainsi à la vérité ou, au contraire, d'un mépris coupable pour toute question de ce genre… Il s'agit alors d'un droit fondé, non plus sur l'excellence de la vérité religieuse et sur les intentions salvifiques de Dieu, mais simplement sur la nature et la dignité de la personne humaine, qui, en certaines matières, et spécialement en ce qui touche ses rapports directs avec le Créateur, échappe de plein droit au contrôle des autres humains, même à celui du pouvoir humain le plus haut, c'est-à-dire de l'autorité publique.
|
AVANT-PROPOS
I. LIBERTÉ RELIGIEUSE ET RÉVÉLATION ÉVANGÉLIQUE
1. Considérations préliminaires : le double « droit » de l'homme à la liberté religieuse
2. Le droit à la liberté chrétienne. Ses fondements révélés. Son importance
3. Doit-on fonder sur la révélation le droit général des hommes à la liberté religieuse ? Position du problème
4. Pourquoi le droit général à la liberté religieuse n'est pas à fonder directement sur la révélation
5. Conclusion
II. LIBERTÉ RELIGIEUSE ET FLUCTUATIONS THÉOLOGIQUES.
1. Comment se pose le problème
2. Comment expliquer le peu de « libéralisme » de l'Église au temps des Pères ?
3. Comment expliquer l'attitude de l'Église à l'égard des hérétiques du XIIe siècle à la fin de l'Ancien Régime ?
4. Pourquoi l'Église refusa de se rallier au libéralisme de Lamennais
5. Pourquoi l'Église refusa de se rallier au libéralisme assagi de Montalembert
6. Conclusion
NOTES ADDITIONNELLES.
I. La « liberté de mal agir » peut-elle être l'objet d'un « droit » ?
II. Respect des consciences ou respect des personnes ?
III. Liberté de « religion » et liberté d' « irréligion »
IV. Le droit à la liberté religieuse chez Tertullien et Lactance
V. Doit-on reconnaître à la parabole de l'ivraie une valeur préceptive ?
VI. Pour mieux entendre la doctrine de saint Thomas sur la « conscience erronée »
|
 |