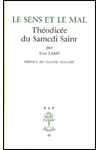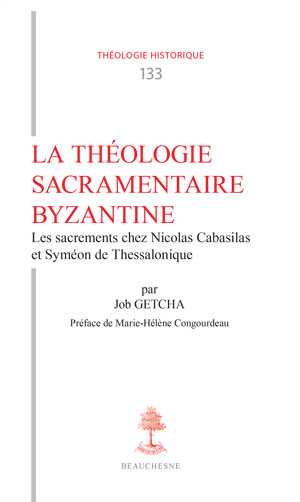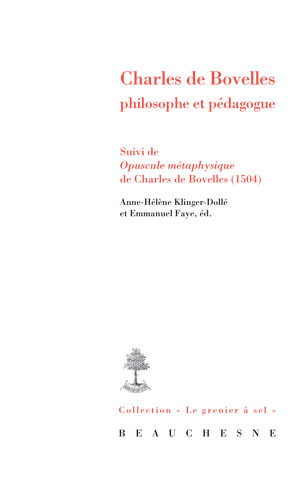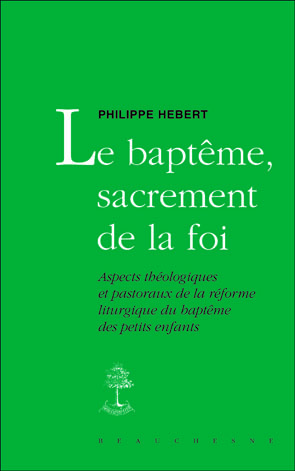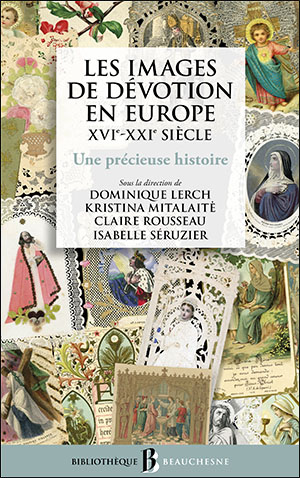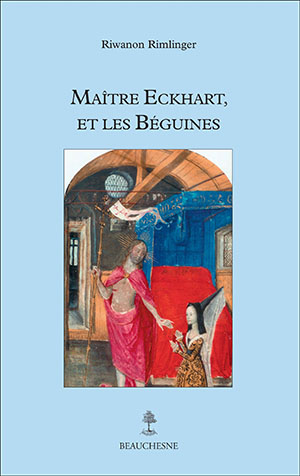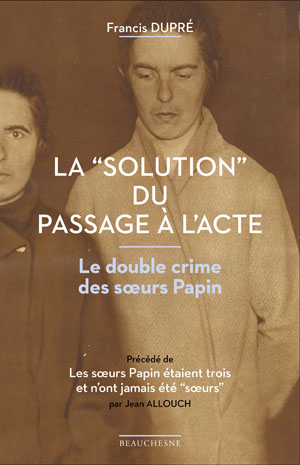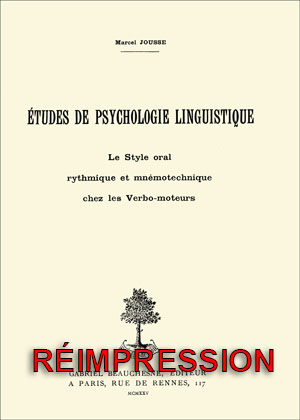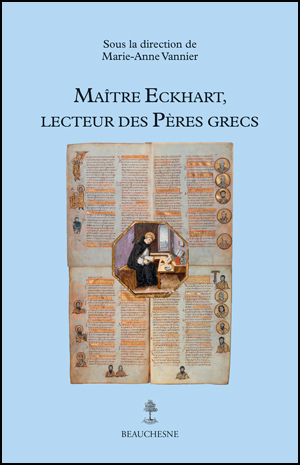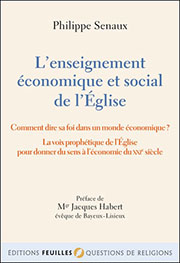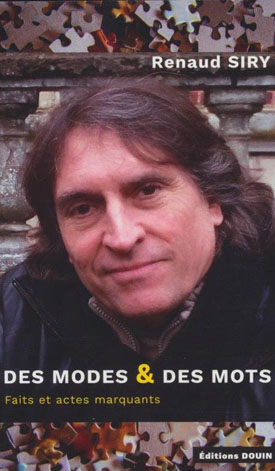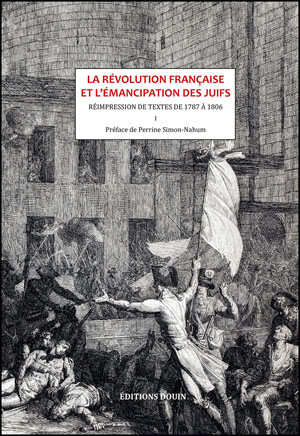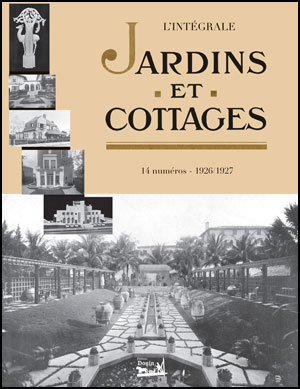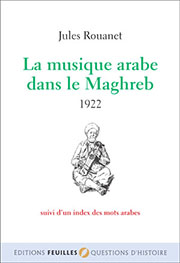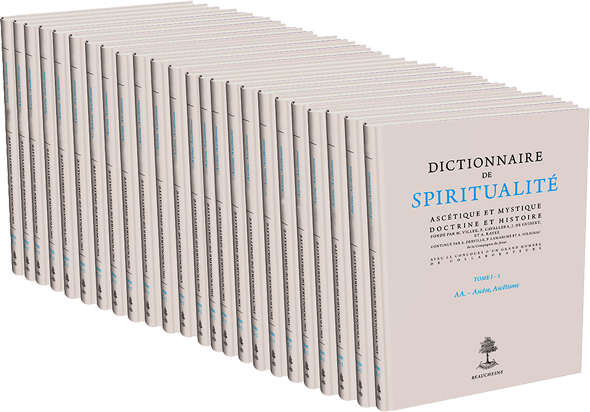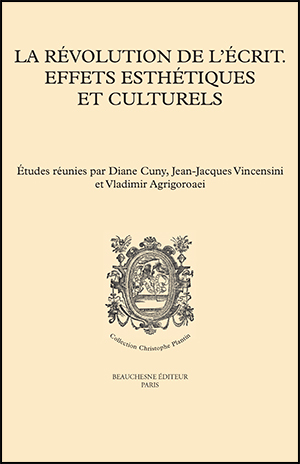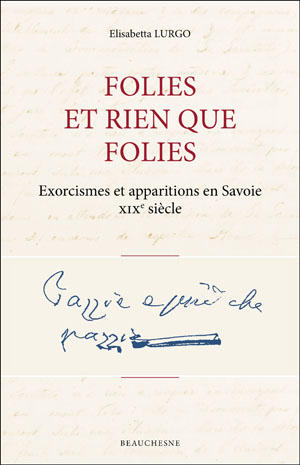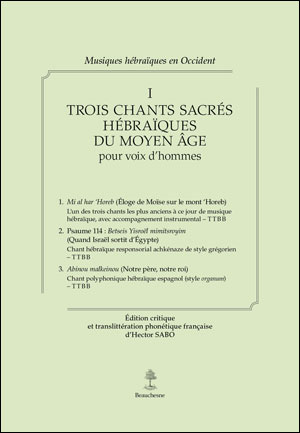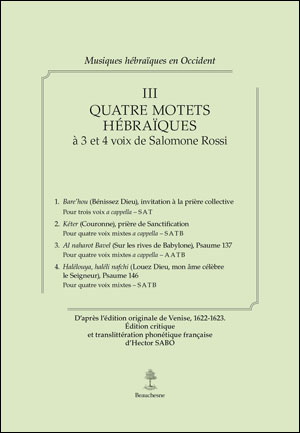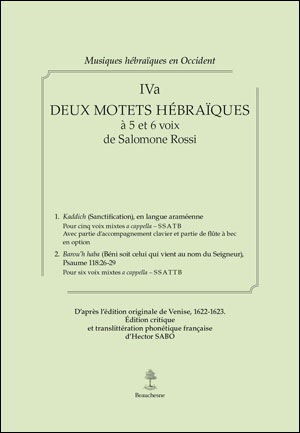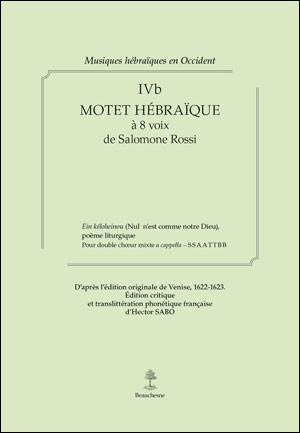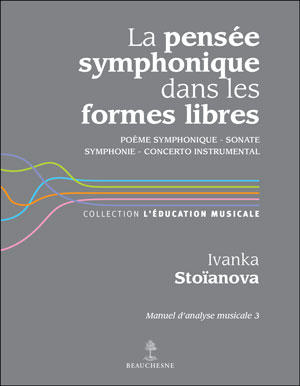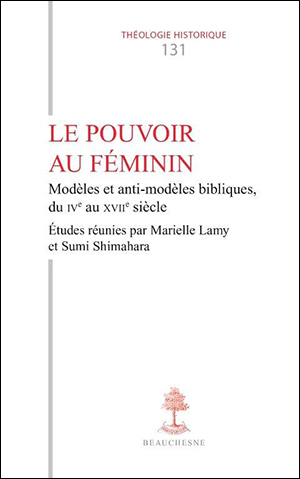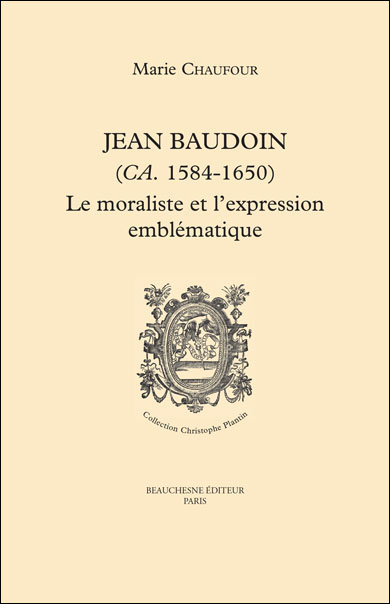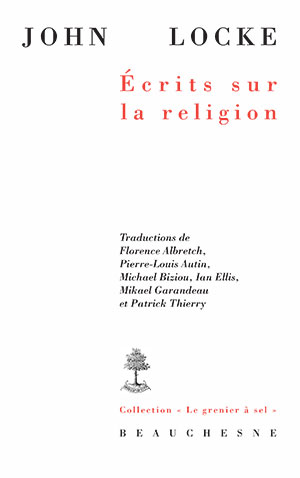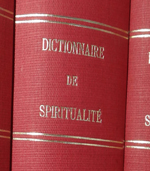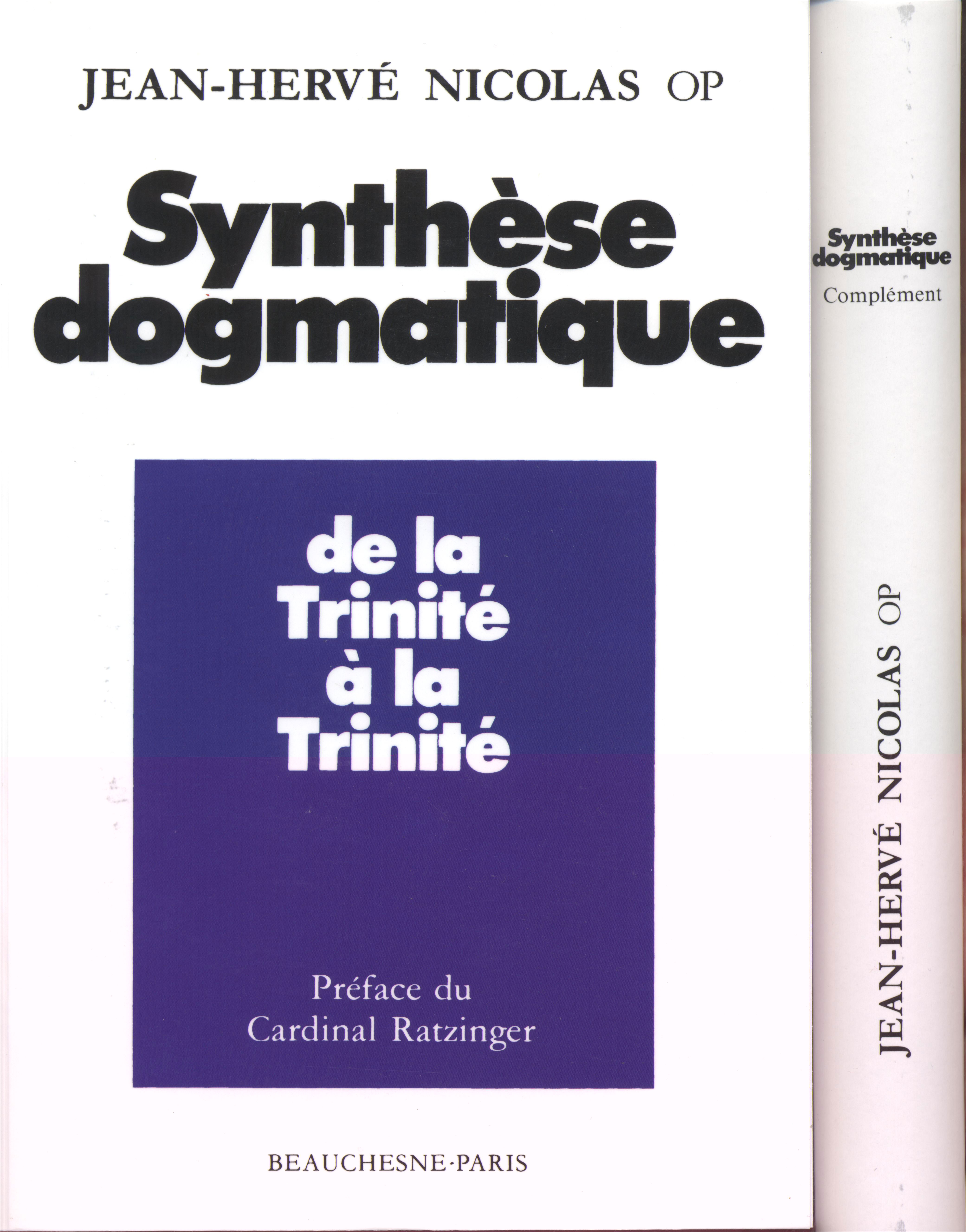69.00 €
BAP n°30 LE SENS ET LE MAL Théodicée du Samedi Saint
Date d'ajout : mardi 22 août 2017
par Paul OLIVIER
RECHERCHES DE SCIENCES RELIGIEUSES, 72, 1984
Cet important ouvrage, qui se propose de penser le mal en raison, porte en sous-titre Théodicée du Samedi Saint. Le choix est délibéré : il entend s'opposer à l'assomption spéculative du Vendredi Saint, telle que la pratique Hegel, maiss aussi Schelling. Ce dernier, en exposant comme une double nécessité, selon les exigences de la raison, l'Offenbarung de l'Amour par le Mal et l'Ausbiidung de la foi par la raison (pp. 462-463), réalise l'universalité rationnelle de la philosophie. En revanche, une théodicée du Samedi Saint, en substituant "une solution de continuité à l'assomption conceptuelle de la Croix" (p. 470), pourrait se placer délibérément en dehors de la philosophie et s'enfermer dans la 'particularité d'une théologie confessante. Telle n'est pas l'intention de Yves Labbé. Afin de maintenir le Caractère universellement médiateur de la raison sans renoncer à la confession de la foi, ni livrer le sujet croyant et philosophant à une ruineuse dualité, il entend ouvrir une troisième voie. Cette troisième voie pourrait se placer sous l'autorité de Pascal et se définit fort clairement dans l'aveu suivant : "parce que nous savons ne pouvoir décider en raison de certains jugements, nous tenons de raison que la pensée et le vouloir passent la raison" (p. 478). C'est dire que ce livre se recommande non seulement par la richesse du contenu, mais "également par la rigueur de la méthode. Un souci critique sans cesse réactualisé accompagne le cheminement de l'auteur, éclaire ses démarches, précise les statut exact de ses conclusions.
Le prologue, consacré à la double conversion, entend montrer comment la tradition philosophique et la tradition chrétienne ont traité différemment le problème de l'origine du mal et de son salut (p. 21). La conclusion de cette enquête pourrait décevoir dans sa banalité ("On ne peut confondre la relation de foi à l'Esprit du Ressuscité et la relation réflexive de l'esprit à lui-même", p. 73), si nous écartions sa signification fondamentale. D'une part, elle nous montre comment la foi chrétienne, dont l'auteur se réclame, peut susciter une interrogation philosophique, ouvrir de nouveau un débat, récuser des conclusions trop hâtives ; d'autre part, elle nous invite à prendre la mesure de la modernité. Le théologien de la modernité est moins confronté à des philosophies pré-chrétiennes qui refusent de prendre en compte l'historicité de l'esprit, qu'à des philosophies postchrétiennes qui, ayant universalisé le contenu de la foi, la coupent de tout rapport à la contingence historique et à la particularité du sujet croyant. Il ne sert alors de rien, campant sur des positions intellectuelles dépassées, de régler harmonieusement les rapports de la théologie positive et de la théologie rationnelle, quand la théologie spéculative de l'Idéalisme absolu menace radicalement la confession du Dieu Sauveur en Christ, tout en rendant justice à son enseignement et en transposant la vérité de la Révélation. Le prologue est comme une anticipation de la troisième voie qui refuse d'épuiser la pensée humaine en une détermination universelle et nécessaire de raison (p. 74). La raison authentique a plutôt pour mission de faire communiquer l'expérience de foi et la nécessité rationnelle dans la pensée du sens.
Penser le mal en raison, c'est reconnaître la primauté du sens et du bien. Au commencement est le sens, le mal n'est pas originaire, telle est la double certitude de toute théodicée. Or la primauté du sens et la pure négativité du mal ne vont plus de soi pour le penseur de la modernité. L'identité à soi du sens n'exclut ni l'altérité ni même l'aliénation, mais à condition que l'altérité soit comprise et l'aliénation dépassée. Le temps symbolise et permet "ce rythme de sortie et de retour, d'extériorité et d'intériorité, d'altérité et d'indentification", que la pensée moderne récuse en découvrant l'espace comme marque de l'être. En effet, "quand l'espace devient lieu de langage, et partant d'être et d'intelligibilité, (quand) l'être de l'espace a subverti l'être du temps, l'intelligibilité de l'erre perd sa référence" (p. 80). Dans "l'espace dessaisi de tout centre et de toute orientation, la relation du vrai à la conscience, le rapport de l'autre que soi à soi-même, se trouve définitivement brisé" (Ibidem). L'être comme espace est dissémination absolue, extériorité pure, multiplicité indépassable. L'extériorité diffuse met alors radicalement en question l'intériorité constituante du sens (p. 81). Certes, dans l'histoire de la métaphysique, l'humanisme feuerbachien ou l'humanisme sartrien peuvent bien rejeter le caractère absolu du discours ontologique, ils ne réduisent pas les illusions de la conversion à soi que dénoncent les pensées post-nietzschéennes. "Gardienne du sens, la métaphysique s'est réalisée en un discours de la conversion, comme retour à soi, jusque dans sa dernière figure, l'humanisme" (p. 131). C'est ce retour à soi que l'anti-humanisme contemporain conteste ; achevant d'"enclore la métaphysique en une temporalité unique", l'anti-humanisme inaugure par "un autre geste de pensée" , une nouvelle figure qui s'exprime dans "la dissolution du sens, l'anéantissement de la conversion, la dispersion absolue". Il faudrait renoncer à toute métaphysique pour laisser l'un du multiple, dans l'espacement de l'origine, produire "un devenir innocent, sans procession ni conversion : dérive et non dérivation" (p. 134). Inversant les trois moments de la métaphysique que sont l'identité originelle, l'extériorisation du Même en l'Autre, le retour du Même à soi dans l'absolu du discours, le refus et le dépassement de la métaphysique se produisent "dans la dispersion de l'être à travers ses deux pratiques de langage, l'analyse et la fable, la critique et la création" (140). Démembrement du discours et répétition de la différence manifestent l'incapacité du Même à reconduire l'Autre à soi. L'Autre est ce qui toujours disperse le Même, de telle sorte que l'éclat du sens est toujours rendu à son éclatement (p. 165). La circularité du sens, qui définissait la métaphysique dans son histoire, est non seulement différée mais définitivement rompue (p. 175).
La situation présente de la pensée nous place devant une alternative : ou bien le retour à soi ou bien la dispersion du sens ; ou bien la détermination de soi par soi de l'infini, ou bien la dissémination du fini (p. 177). Cette alternative cependant ne serait irrécusable et définitive que si la métaphysique elle-même n'avait de choix qu'entre le discours absolu ou l'humanisme, qui n'en est qu'un avatar inconsistant; mais une autre possibilité reste ouverte, suscitée par la foi chrétienne et trop longtemps occultée. Le sens peut être justifié dans une conversion sans retour vers le tout autre (p. 81). Trois termes doivent intervenir dans le débat : intériorité constituante, extériorité diffuse, extériorité constituante. L'approche de Levinas permet de préciser ce troisième terme.
La philosophie, qui est discours du sens dans la recherche d'un sens, ne peut pas renoncer au sens qui la constitue, mais elle n'est pas obligée de lire "la production du sens dans le mouvement de conversion de soi à soi" (p. 86). En déplaçant la conversion du Même vers l'Autre, le philosophe, qui se laisse inspirer par la tradition judéo-chrétienne, fait droit à deux instances irrécusables : "l'attachement de la métaphysique lia conversion, la revendication d'une altérité positive" (p. 180). La pensée de la différence, depuis Nietzsche, exclut la conversion, parce qu'elle refuse la totalité, et affirme la dispersion, parce qu'elle reconnaît l'altérité ; mais ni la conversion n'exige la totalité, ni l'altérité n'impose la dispersion (p. 180). Si "la positivité de l'Autre ne se satisfait ni de la négativité du fini, ni de la vacuité du Même", nous devons concevoir la plénitude du fini et la transcendance de l'Autre dans un même mouvement. Il faut comprendre comment l'Autre peut investir une "existence déjà assurée d'elle-même" (p. 182), ainsi la conversion de soi à l'autre pourra-t-elle remplacer aussi bien "la totalité du fini et de l'infini" que "la dispersion infinie du fini" (Ibidem). .
Une reprise de la pensée de Levinas peut nous guider dans cette entreprise, où nous marquerons trois étapes. A) - Dans un premier moment, nous découvrirons que "l'Infini ne peut être rendu manifeste qu'à une subjectivité établie positivement dans la finitude, comblée d'une jouissance plus originelle que le manque ou la négativité" (pp. 217-218). Y. Labbé reprend essentiellement les thèses de Totalité et Infini, en observant que Autrement qu'être risque d'occulter la positivité de la vie et du contentement, à trop insister sur la vulnérabilité et la passivité de l'exposition à l'autre dans la sensibilité même. B) - Dans un second moment, nous aidant de l'impératif éthique, nous aborderons l'Autre "en vérifiant la distance de l'un à l'autre, en signifiant la responsabilité de l'un pour l'autre" (p. 218). La liberté, où se résume l'assurance du Même a besoin d'être justifiée, et la Justice, dans la dissymétrie d'un temps original, nous vient d'autrui. La subjectivité n'est donc pas univoque : elle est "le Même et l'Autre-dans-le-Même" ; plus exactement encore, "le Même est sensibilité, l'Autre est jugement, l'Autre-dans-le-Même est liberté c'est-à-dire désir de justice" (p. 201). C) - Dans un troisième moment, pour « échapper aux séductions de la théologie négative, qui continuent de fasciner Levinas, nous reconnaîtrons que, "l'autre ou l'Infini ne peut être différent de la parole, de l’irréversibilité du dire et de l’écoute, dans la corrélation du dire et du faire" (p. 218). La Parole, comme "dire qui investit son écoute en lui donnant sens", peut rectifier le discours et fonder en vérité un discours métaphysique positif (p. 217).'
Le discours métaphysique ainsi compris fonde l'assertion de l'Absolu distincte de l'affirmation de Dieu. Le discours philosophique doit montrer en effet que "l'Absolu se produit substantiellement et non pas seulement relativement" (p. 220), car "l'Infini ne serait pas absolument infini si sa présentation s'exténuait dans la finitude du sujet" (p. 220). Le passage d'autrui, comme figure de l'Autre, à l'Autre comme Infini, est assuré par un renouvellement éthique de l'argument ontologique, toutes les précautions étant prises pour éviter le retour du Même. Nous sommes alors capables de concevoir "l'Absolu comme l'infiniment Autre" et non "comme mouvement indéfini du fini" (p.' 232), en l'apercevant dans "la distance de l'Infini à son idée". L'Absolu peut être reconnu comme "la distance, non pas pathétique mais éthique de son idée en moi à lui-même (p. 223).
L'assertion de l'Absolu n'est pas l'affirmation de Dieu, car seule l'expérience du Mal, dans sa positivité et son unité, peut nous conduire à l'affirmation de Dieu (p.J36). De ce point de vue, "l'affirmation de Dieu se distingue de l'assertion de l'Absolu en ce qu'elle intervient dans nos préoccupations à titre de reconnaissance, en fonction d'une interrogation sur le mal" (pp. 238-239). En séparant provisoirement le mal moral des autres formes du mal, nous pouvons poser une première affirmation de Dieu dont la suite fera cependant éclater l'abstraction (p. 251). La réflexion sur le mal moral (la faute, le mal radical, le serf arbitre), qui emprunte beaucoup à Kant et à Luther, reconnaît la réalité du mal dans "le démenti apporté à la position de l'Absolu par l'actualité du monde" (p. 278). La lutte du bien et du mal, au sein de l'expérience humaine, enseigne qu'"Autrui ne suffit pas à fonder la possibilité de réalisation de la relation éthique" (p. 287). Ainsi d'une part, "l'homme ne devient sujet qu'investi par la différence", et, d'autre part, "la différence est irréalisable dans la relation d'homme à homme" ; le paradoxe n'est surmonté que si la différence se pose en dehors de l'humanité même, dans un être absolument juste; d'où la conclusion: "l'unique être absolument juste est le Tout Autre, celui-là même que Je nomme Dieu" (p. 289). Cette formulation a le mérite de faire apparaître non seulement le lien entre l'affirmation de Dieu et l'expérience du mal, mais aussi la référence de l'énoncé au sujet de l'énonciation. L'auto-implication du sujet croyant est requise pour toute affirmation de Dieu qui, comme reconnaissance, se distingue de l'assertion de l'Absolu.
La positivité reconnue du mal nous conduit à l'affirmation de Dieu comme toute justice, mais cette affirmation reste abstraite tant qu'elle n'est pas éprouvée par et dans l'expérience de l'unité du Mal, "Le Mal tient son unité d'une dualité surmontée. Il faut l'injustice et le malheur réunis pour que le mal livre en profondeur deux instances indiscernables" (p. 310). L'innocent malheureux et persécuté, le juste souffrant, en attestant "le désaveu de l'unité de l'équité et du bonheur", semble "remettre en question l'affirmation de l'être infiniment juste" (p. 347). Il nous faut dès lors rencontrer la difficulté de toutes les théodicées et défendre la cause de Dieu. Pour préciser cette difficulté, il faut d'abord reconnaître en Dieu non seulement la Toute Justice, mais aussi le Souverain Amour, dont le couple humain, en liant contentement et consentement, égoïté du bonheur et altérité de la responsabilité, est la figure. Cette précision conduit alors à une conclusion paradoxale : "Dieu ne cesse, en apparence, de désavouer l'Amour qu'il est lui-même" (p 353). Faut-il se résoudre à affirmer la duplicité de Dieu, comme nous avons reconnu dans l'Absolu la condition du Bien et du mal ? Les théodicées entendent rejeter cette duplicité de Dieu en niant la positivité et l'unité du Mal. C'est à quoi nous ne pouvons nous résoudre après avoir reconnu la souffrance du juste et le malheur innocent. La seule solution qui reste, si nous ne voulons pas consentir à l'absurde, est d'accepter le paradoxe d'un Dieu assumant la dualité du bien et du mal (p. 369). Il faut par conséquent penser "l'impossible et pourtant nécessaire rencontre de Dieu et du Mal" (p. 370), Ni un Dieu méchant, ni un Dieu étranger à l'enjeu universel du Mal ne peuvent nous satisfaire (p. 373). Seul un Dieu capable de participer, par la souffrance et la mort, à l'enjeu universel du mal serait capable de régénérer le réel et d'assurer la victoire de l'Amour et du Bien. Pour défendre la cause de Dieu, nous devons donc admettre une différenciation du divin et un dédoublement de Dieu en même temps que l'idée d'une renaissance de l'homme et d'une régénération du réel (p. 373). Mais nous avons l'expérience du monde déchu et non pas celle d'un monde régénéré (p. 375). C'est pourquoi, sollicités par la foi religieuse, nous pouvons penser la possible rencontre en Dieu du Mal et de l'Amour (p. 387), mais non point décider du triomphe, en Dieu et dans le monde, de l'Amour sur la Mort et du Bien sur le Mal. La philosophie ne peut guère nous conduire au-delà de la Promesse et de l'Espérance qu'elle justifie. Les théodicées ont trop longtemps conclu de la promesse à la nécessité.
C'est pourquoi la christologie spéculative de Schelling, telle qu'on peut la saisir dans Les Recherches philosophiques sur l'essence de la Liberté humaine, ne saurait pas davantage nous satisfaire que l'Éthique spinoziste. Schelling développe sa "philosophie de la liberté en rassemblant le Mal de l'être et le Verbe de Dieu" (p. 399). Il fait droit à deux exigences : en plaçant la dualité dans le devenir de l'origine, il sauvegarde l'identité de l'être et la positivité du mal ; en montrant que Dieu a livré son fils à la nature et à l'histoire, il parvient à dominer l'antagonisme du Mal et de l'être. Ainsi, pour Schelling, "le Mal et le Verbe s'appellent l'un l'autre dans la génération du divin" (p. 399). Bien plus, si le Mal, qui touche l'homme dans son existence même, n'atteint Dieu que dans sa condition ténébreuse, alors "le Verbe accomplit et exprime la victoire de Dieu, en Dieu sur ce qui n'est pas Dieu" (p. 416). Une telle approche est infiniment plus concrète que celle de Spinoza, en ce qu'elle confère "à la théologie du Verbe incarné la forme absolue de la nécessité" (p. 400), au lieu de renvoyer aux illusions de l'imagination le Mal et ce qui pourrait le vaincre ; mais est-elle plus satisfaisante en raison et pour la foi ? La théologie spéculative de Schelling présuppose, avec Lessing, la légitimité de la relève rationnelle de la foi, et, avec les théodicées, la nécessité de l'assomption du Mal par l'Amour; or, "le dépassement de la Foi n'est pas plus inéluctable que la justification du Mal" (p. 421). D'une part, l'appropriation spéculative des vérités de foi est parfaitement légitime, mais elle ne saurait être exclusive, sans nier l'originalité de l'acte de foi ; la foi ne se réduit pas à l'énoncé d'un contenu indépendamment du sujet de l'énonciation. La foi n'est pas seulement commencement de la théologie dans un rapport d'autorité et d'enseignement ; elle est aussi origine d'une vie dans un rapport de communion el d'écoute (p. 444). Dès lors, si la foi est origine et non point commencement, il est, aux yeux de la raison même, "une autre appropriation du christianisme que sa relève rationnelle" (p. 445). D'autre part, "Dieu est Dieu si et seulement si l'Amour domine le Mal dans le monde et d'abord en Dieu", mais "ce désaveu du Mal n'est pas le terme nécessaire de ra demande de justification" (p. 451). Le jugement de foi qui affirme : le Crucifié est le Ressuscité ne fait pas l'économie de la mort de Dieu. Si la mort de Dieu est abandon de Dieu par Dieu (p. 548), nous ne pouvons savoir de connaissance commune, la Mort conduit à l'Amour (p. 470). L'épreuve du Samedi Saint est le délai de la Foi. ç'est pourquoi il faut refuser la double nécessité de l'Offenbarung de l'Amour par le Mal et de l'Ausbildung de la raison par la foi.
Cependant, si le dépassement de la foi et le désaveu définitif du Mal "ne constituent pas l'issue unique et nécessaire de l'histoire" (p. 465), il ne faut pas en conclure que l'appropriation théologale de la foi récuse la relève rationnelle de la raison. La pensée ne se réduit pas à la raison, elle est capable de se convertir à la promesse de la régénération sans renoncer à l'intelligence du sens, où les vérités chrétiennes peuvent sans cesse susciter la réflexion.
Le livre de Y. Labbé manifeste, chez son auteur, une grande maîtrise des philosophies classiques comme de la pensée moderne, de la problématique théologique comme de la réflexion critique. Une rare fermeté intellectuelle nous le fait préférer à Humanisme et Théologie dont nous avons aussi rendu compte. S'il fallait faire une réserve, elle porterait sur la forme : une certaine préciosité et la multiplicité des renvois allusifs en rendent parfois la lecture laborieuse ; mais c'est un reproche mineur. Pour le contenu ; l'influence de Kant toujours perceptible impose une rigueur critique que nous ne saurions reprocher à l'auteur sans écrire un autre livre, où le dépassement de l'idéalisme absolu produirait d'autres références et d'autres concepts, Ce n'est pas la pensée critique qui, à notre avis, sauvegarde le mieux l'originalité de l'acte de foi, mais une pensée spéculative qui renoue avec la contingence et la singularité de la raison même, tandis que la Foi aspire à son propre dépassement dans la Vue. Mais c'est là une autre histoire.
Cet important ouvrage, qui se propose de penser le mal en raison, porte en sous-titre Théodicée du Samedi Saint. Le choix est délibéré : il entend s'opposer à l'assomption spéculative du Vendredi Saint, telle que la pratique Hegel, maiss aussi Schelling. Ce dernier, en exposant comme une double nécessité, selon les exigences de la raison, l'Offenbarung de l'Amour par le Mal et l'Ausbiidung de la foi par la raison (pp. 462-463), réalise l'universalité rationnelle de la philosophie. En revanche, une théodicée du Samedi Saint, en substituant "une solution de continuité à l'assomption conceptuelle de la Croix" (p. 470), pourrait se placer délibérément en dehors de la philosophie et s'enfermer dans la 'particularité d'une théologie confessante. Telle n'est pas l'intention de Yves Labbé. Afin de maintenir le Caractère universellement médiateur de la raison sans renoncer à la confession de la foi, ni livrer le sujet croyant et philosophant à une ruineuse dualité, il entend ouvrir une troisième voie. Cette troisième voie pourrait se placer sous l'autorité de Pascal et se définit fort clairement dans l'aveu suivant : "parce que nous savons ne pouvoir décider en raison de certains jugements, nous tenons de raison que la pensée et le vouloir passent la raison" (p. 478). C'est dire que ce livre se recommande non seulement par la richesse du contenu, mais "également par la rigueur de la méthode. Un souci critique sans cesse réactualisé accompagne le cheminement de l'auteur, éclaire ses démarches, précise les statut exact de ses conclusions.
Le prologue, consacré à la double conversion, entend montrer comment la tradition philosophique et la tradition chrétienne ont traité différemment le problème de l'origine du mal et de son salut (p. 21). La conclusion de cette enquête pourrait décevoir dans sa banalité ("On ne peut confondre la relation de foi à l'Esprit du Ressuscité et la relation réflexive de l'esprit à lui-même", p. 73), si nous écartions sa signification fondamentale. D'une part, elle nous montre comment la foi chrétienne, dont l'auteur se réclame, peut susciter une interrogation philosophique, ouvrir de nouveau un débat, récuser des conclusions trop hâtives ; d'autre part, elle nous invite à prendre la mesure de la modernité. Le théologien de la modernité est moins confronté à des philosophies pré-chrétiennes qui refusent de prendre en compte l'historicité de l'esprit, qu'à des philosophies postchrétiennes qui, ayant universalisé le contenu de la foi, la coupent de tout rapport à la contingence historique et à la particularité du sujet croyant. Il ne sert alors de rien, campant sur des positions intellectuelles dépassées, de régler harmonieusement les rapports de la théologie positive et de la théologie rationnelle, quand la théologie spéculative de l'Idéalisme absolu menace radicalement la confession du Dieu Sauveur en Christ, tout en rendant justice à son enseignement et en transposant la vérité de la Révélation. Le prologue est comme une anticipation de la troisième voie qui refuse d'épuiser la pensée humaine en une détermination universelle et nécessaire de raison (p. 74). La raison authentique a plutôt pour mission de faire communiquer l'expérience de foi et la nécessité rationnelle dans la pensée du sens.
Penser le mal en raison, c'est reconnaître la primauté du sens et du bien. Au commencement est le sens, le mal n'est pas originaire, telle est la double certitude de toute théodicée. Or la primauté du sens et la pure négativité du mal ne vont plus de soi pour le penseur de la modernité. L'identité à soi du sens n'exclut ni l'altérité ni même l'aliénation, mais à condition que l'altérité soit comprise et l'aliénation dépassée. Le temps symbolise et permet "ce rythme de sortie et de retour, d'extériorité et d'intériorité, d'altérité et d'indentification", que la pensée moderne récuse en découvrant l'espace comme marque de l'être. En effet, "quand l'espace devient lieu de langage, et partant d'être et d'intelligibilité, (quand) l'être de l'espace a subverti l'être du temps, l'intelligibilité de l'erre perd sa référence" (p. 80). Dans "l'espace dessaisi de tout centre et de toute orientation, la relation du vrai à la conscience, le rapport de l'autre que soi à soi-même, se trouve définitivement brisé" (Ibidem). L'être comme espace est dissémination absolue, extériorité pure, multiplicité indépassable. L'extériorité diffuse met alors radicalement en question l'intériorité constituante du sens (p. 81). Certes, dans l'histoire de la métaphysique, l'humanisme feuerbachien ou l'humanisme sartrien peuvent bien rejeter le caractère absolu du discours ontologique, ils ne réduisent pas les illusions de la conversion à soi que dénoncent les pensées post-nietzschéennes. "Gardienne du sens, la métaphysique s'est réalisée en un discours de la conversion, comme retour à soi, jusque dans sa dernière figure, l'humanisme" (p. 131). C'est ce retour à soi que l'anti-humanisme contemporain conteste ; achevant d'"enclore la métaphysique en une temporalité unique", l'anti-humanisme inaugure par "un autre geste de pensée" , une nouvelle figure qui s'exprime dans "la dissolution du sens, l'anéantissement de la conversion, la dispersion absolue". Il faudrait renoncer à toute métaphysique pour laisser l'un du multiple, dans l'espacement de l'origine, produire "un devenir innocent, sans procession ni conversion : dérive et non dérivation" (p. 134). Inversant les trois moments de la métaphysique que sont l'identité originelle, l'extériorisation du Même en l'Autre, le retour du Même à soi dans l'absolu du discours, le refus et le dépassement de la métaphysique se produisent "dans la dispersion de l'être à travers ses deux pratiques de langage, l'analyse et la fable, la critique et la création" (140). Démembrement du discours et répétition de la différence manifestent l'incapacité du Même à reconduire l'Autre à soi. L'Autre est ce qui toujours disperse le Même, de telle sorte que l'éclat du sens est toujours rendu à son éclatement (p. 165). La circularité du sens, qui définissait la métaphysique dans son histoire, est non seulement différée mais définitivement rompue (p. 175).
La situation présente de la pensée nous place devant une alternative : ou bien le retour à soi ou bien la dispersion du sens ; ou bien la détermination de soi par soi de l'infini, ou bien la dissémination du fini (p. 177). Cette alternative cependant ne serait irrécusable et définitive que si la métaphysique elle-même n'avait de choix qu'entre le discours absolu ou l'humanisme, qui n'en est qu'un avatar inconsistant; mais une autre possibilité reste ouverte, suscitée par la foi chrétienne et trop longtemps occultée. Le sens peut être justifié dans une conversion sans retour vers le tout autre (p. 81). Trois termes doivent intervenir dans le débat : intériorité constituante, extériorité diffuse, extériorité constituante. L'approche de Levinas permet de préciser ce troisième terme.
La philosophie, qui est discours du sens dans la recherche d'un sens, ne peut pas renoncer au sens qui la constitue, mais elle n'est pas obligée de lire "la production du sens dans le mouvement de conversion de soi à soi" (p. 86). En déplaçant la conversion du Même vers l'Autre, le philosophe, qui se laisse inspirer par la tradition judéo-chrétienne, fait droit à deux instances irrécusables : "l'attachement de la métaphysique lia conversion, la revendication d'une altérité positive" (p. 180). La pensée de la différence, depuis Nietzsche, exclut la conversion, parce qu'elle refuse la totalité, et affirme la dispersion, parce qu'elle reconnaît l'altérité ; mais ni la conversion n'exige la totalité, ni l'altérité n'impose la dispersion (p. 180). Si "la positivité de l'Autre ne se satisfait ni de la négativité du fini, ni de la vacuité du Même", nous devons concevoir la plénitude du fini et la transcendance de l'Autre dans un même mouvement. Il faut comprendre comment l'Autre peut investir une "existence déjà assurée d'elle-même" (p. 182), ainsi la conversion de soi à l'autre pourra-t-elle remplacer aussi bien "la totalité du fini et de l'infini" que "la dispersion infinie du fini" (Ibidem). .
Une reprise de la pensée de Levinas peut nous guider dans cette entreprise, où nous marquerons trois étapes. A) - Dans un premier moment, nous découvrirons que "l'Infini ne peut être rendu manifeste qu'à une subjectivité établie positivement dans la finitude, comblée d'une jouissance plus originelle que le manque ou la négativité" (pp. 217-218). Y. Labbé reprend essentiellement les thèses de Totalité et Infini, en observant que Autrement qu'être risque d'occulter la positivité de la vie et du contentement, à trop insister sur la vulnérabilité et la passivité de l'exposition à l'autre dans la sensibilité même. B) - Dans un second moment, nous aidant de l'impératif éthique, nous aborderons l'Autre "en vérifiant la distance de l'un à l'autre, en signifiant la responsabilité de l'un pour l'autre" (p. 218). La liberté, où se résume l'assurance du Même a besoin d'être justifiée, et la Justice, dans la dissymétrie d'un temps original, nous vient d'autrui. La subjectivité n'est donc pas univoque : elle est "le Même et l'Autre-dans-le-Même" ; plus exactement encore, "le Même est sensibilité, l'Autre est jugement, l'Autre-dans-le-Même est liberté c'est-à-dire désir de justice" (p. 201). C) - Dans un troisième moment, pour « échapper aux séductions de la théologie négative, qui continuent de fasciner Levinas, nous reconnaîtrons que, "l'autre ou l'Infini ne peut être différent de la parole, de l’irréversibilité du dire et de l’écoute, dans la corrélation du dire et du faire" (p. 218). La Parole, comme "dire qui investit son écoute en lui donnant sens", peut rectifier le discours et fonder en vérité un discours métaphysique positif (p. 217).'
Le discours métaphysique ainsi compris fonde l'assertion de l'Absolu distincte de l'affirmation de Dieu. Le discours philosophique doit montrer en effet que "l'Absolu se produit substantiellement et non pas seulement relativement" (p. 220), car "l'Infini ne serait pas absolument infini si sa présentation s'exténuait dans la finitude du sujet" (p. 220). Le passage d'autrui, comme figure de l'Autre, à l'Autre comme Infini, est assuré par un renouvellement éthique de l'argument ontologique, toutes les précautions étant prises pour éviter le retour du Même. Nous sommes alors capables de concevoir "l'Absolu comme l'infiniment Autre" et non "comme mouvement indéfini du fini" (p.' 232), en l'apercevant dans "la distance de l'Infini à son idée". L'Absolu peut être reconnu comme "la distance, non pas pathétique mais éthique de son idée en moi à lui-même (p. 223).
L'assertion de l'Absolu n'est pas l'affirmation de Dieu, car seule l'expérience du Mal, dans sa positivité et son unité, peut nous conduire à l'affirmation de Dieu (p.J36). De ce point de vue, "l'affirmation de Dieu se distingue de l'assertion de l'Absolu en ce qu'elle intervient dans nos préoccupations à titre de reconnaissance, en fonction d'une interrogation sur le mal" (pp. 238-239). En séparant provisoirement le mal moral des autres formes du mal, nous pouvons poser une première affirmation de Dieu dont la suite fera cependant éclater l'abstraction (p. 251). La réflexion sur le mal moral (la faute, le mal radical, le serf arbitre), qui emprunte beaucoup à Kant et à Luther, reconnaît la réalité du mal dans "le démenti apporté à la position de l'Absolu par l'actualité du monde" (p. 278). La lutte du bien et du mal, au sein de l'expérience humaine, enseigne qu'"Autrui ne suffit pas à fonder la possibilité de réalisation de la relation éthique" (p. 287). Ainsi d'une part, "l'homme ne devient sujet qu'investi par la différence", et, d'autre part, "la différence est irréalisable dans la relation d'homme à homme" ; le paradoxe n'est surmonté que si la différence se pose en dehors de l'humanité même, dans un être absolument juste; d'où la conclusion: "l'unique être absolument juste est le Tout Autre, celui-là même que Je nomme Dieu" (p. 289). Cette formulation a le mérite de faire apparaître non seulement le lien entre l'affirmation de Dieu et l'expérience du mal, mais aussi la référence de l'énoncé au sujet de l'énonciation. L'auto-implication du sujet croyant est requise pour toute affirmation de Dieu qui, comme reconnaissance, se distingue de l'assertion de l'Absolu.
La positivité reconnue du mal nous conduit à l'affirmation de Dieu comme toute justice, mais cette affirmation reste abstraite tant qu'elle n'est pas éprouvée par et dans l'expérience de l'unité du Mal, "Le Mal tient son unité d'une dualité surmontée. Il faut l'injustice et le malheur réunis pour que le mal livre en profondeur deux instances indiscernables" (p. 310). L'innocent malheureux et persécuté, le juste souffrant, en attestant "le désaveu de l'unité de l'équité et du bonheur", semble "remettre en question l'affirmation de l'être infiniment juste" (p. 347). Il nous faut dès lors rencontrer la difficulté de toutes les théodicées et défendre la cause de Dieu. Pour préciser cette difficulté, il faut d'abord reconnaître en Dieu non seulement la Toute Justice, mais aussi le Souverain Amour, dont le couple humain, en liant contentement et consentement, égoïté du bonheur et altérité de la responsabilité, est la figure. Cette précision conduit alors à une conclusion paradoxale : "Dieu ne cesse, en apparence, de désavouer l'Amour qu'il est lui-même" (p 353). Faut-il se résoudre à affirmer la duplicité de Dieu, comme nous avons reconnu dans l'Absolu la condition du Bien et du mal ? Les théodicées entendent rejeter cette duplicité de Dieu en niant la positivité et l'unité du Mal. C'est à quoi nous ne pouvons nous résoudre après avoir reconnu la souffrance du juste et le malheur innocent. La seule solution qui reste, si nous ne voulons pas consentir à l'absurde, est d'accepter le paradoxe d'un Dieu assumant la dualité du bien et du mal (p. 369). Il faut par conséquent penser "l'impossible et pourtant nécessaire rencontre de Dieu et du Mal" (p. 370), Ni un Dieu méchant, ni un Dieu étranger à l'enjeu universel du Mal ne peuvent nous satisfaire (p. 373). Seul un Dieu capable de participer, par la souffrance et la mort, à l'enjeu universel du mal serait capable de régénérer le réel et d'assurer la victoire de l'Amour et du Bien. Pour défendre la cause de Dieu, nous devons donc admettre une différenciation du divin et un dédoublement de Dieu en même temps que l'idée d'une renaissance de l'homme et d'une régénération du réel (p. 373). Mais nous avons l'expérience du monde déchu et non pas celle d'un monde régénéré (p. 375). C'est pourquoi, sollicités par la foi religieuse, nous pouvons penser la possible rencontre en Dieu du Mal et de l'Amour (p. 387), mais non point décider du triomphe, en Dieu et dans le monde, de l'Amour sur la Mort et du Bien sur le Mal. La philosophie ne peut guère nous conduire au-delà de la Promesse et de l'Espérance qu'elle justifie. Les théodicées ont trop longtemps conclu de la promesse à la nécessité.
C'est pourquoi la christologie spéculative de Schelling, telle qu'on peut la saisir dans Les Recherches philosophiques sur l'essence de la Liberté humaine, ne saurait pas davantage nous satisfaire que l'Éthique spinoziste. Schelling développe sa "philosophie de la liberté en rassemblant le Mal de l'être et le Verbe de Dieu" (p. 399). Il fait droit à deux exigences : en plaçant la dualité dans le devenir de l'origine, il sauvegarde l'identité de l'être et la positivité du mal ; en montrant que Dieu a livré son fils à la nature et à l'histoire, il parvient à dominer l'antagonisme du Mal et de l'être. Ainsi, pour Schelling, "le Mal et le Verbe s'appellent l'un l'autre dans la génération du divin" (p. 399). Bien plus, si le Mal, qui touche l'homme dans son existence même, n'atteint Dieu que dans sa condition ténébreuse, alors "le Verbe accomplit et exprime la victoire de Dieu, en Dieu sur ce qui n'est pas Dieu" (p. 416). Une telle approche est infiniment plus concrète que celle de Spinoza, en ce qu'elle confère "à la théologie du Verbe incarné la forme absolue de la nécessité" (p. 400), au lieu de renvoyer aux illusions de l'imagination le Mal et ce qui pourrait le vaincre ; mais est-elle plus satisfaisante en raison et pour la foi ? La théologie spéculative de Schelling présuppose, avec Lessing, la légitimité de la relève rationnelle de la foi, et, avec les théodicées, la nécessité de l'assomption du Mal par l'Amour; or, "le dépassement de la Foi n'est pas plus inéluctable que la justification du Mal" (p. 421). D'une part, l'appropriation spéculative des vérités de foi est parfaitement légitime, mais elle ne saurait être exclusive, sans nier l'originalité de l'acte de foi ; la foi ne se réduit pas à l'énoncé d'un contenu indépendamment du sujet de l'énonciation. La foi n'est pas seulement commencement de la théologie dans un rapport d'autorité et d'enseignement ; elle est aussi origine d'une vie dans un rapport de communion el d'écoute (p. 444). Dès lors, si la foi est origine et non point commencement, il est, aux yeux de la raison même, "une autre appropriation du christianisme que sa relève rationnelle" (p. 445). D'autre part, "Dieu est Dieu si et seulement si l'Amour domine le Mal dans le monde et d'abord en Dieu", mais "ce désaveu du Mal n'est pas le terme nécessaire de ra demande de justification" (p. 451). Le jugement de foi qui affirme : le Crucifié est le Ressuscité ne fait pas l'économie de la mort de Dieu. Si la mort de Dieu est abandon de Dieu par Dieu (p. 548), nous ne pouvons savoir de connaissance commune, la Mort conduit à l'Amour (p. 470). L'épreuve du Samedi Saint est le délai de la Foi. ç'est pourquoi il faut refuser la double nécessité de l'Offenbarung de l'Amour par le Mal et de l'Ausbildung de la raison par la foi.
Cependant, si le dépassement de la foi et le désaveu définitif du Mal "ne constituent pas l'issue unique et nécessaire de l'histoire" (p. 465), il ne faut pas en conclure que l'appropriation théologale de la foi récuse la relève rationnelle de la raison. La pensée ne se réduit pas à la raison, elle est capable de se convertir à la promesse de la régénération sans renoncer à l'intelligence du sens, où les vérités chrétiennes peuvent sans cesse susciter la réflexion.
Le livre de Y. Labbé manifeste, chez son auteur, une grande maîtrise des philosophies classiques comme de la pensée moderne, de la problématique théologique comme de la réflexion critique. Une rare fermeté intellectuelle nous le fait préférer à Humanisme et Théologie dont nous avons aussi rendu compte. S'il fallait faire une réserve, elle porterait sur la forme : une certaine préciosité et la multiplicité des renvois allusifs en rendent parfois la lecture laborieuse ; mais c'est un reproche mineur. Pour le contenu ; l'influence de Kant toujours perceptible impose une rigueur critique que nous ne saurions reprocher à l'auteur sans écrire un autre livre, où le dépassement de l'idéalisme absolu produirait d'autres références et d'autres concepts, Ce n'est pas la pensée critique qui, à notre avis, sauvegarde le mieux l'originalité de l'acte de foi, mais une pensée spéculative qui renoue avec la contingence et la singularité de la raison même, tandis que la Foi aspire à son propre dépassement dans la Vue. Mais c'est là une autre histoire.
Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com
Le moteur peut rechercher dans différents champs :
- Un nom d’auteur (AUTEUR)
- Un mot du titre (TITRE)
- Un ISBN
- Un mot du texte de présentation (TEXTE)
- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).
La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.
En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.
Search engine www.editions-beauchesne.com
The engine can search in different fields:
- An author's name (AUTEUR)
- A word from the title (TITRE)
- An ISBN
- A word from the presentation text (TEXTE)
- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).
The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.
Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.