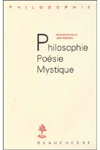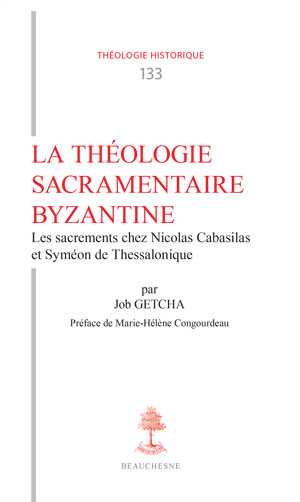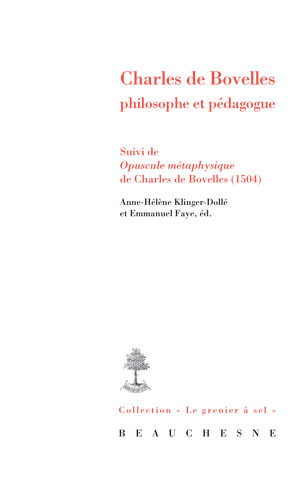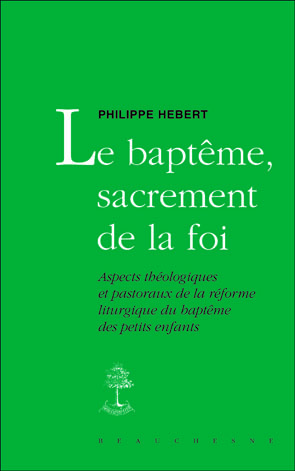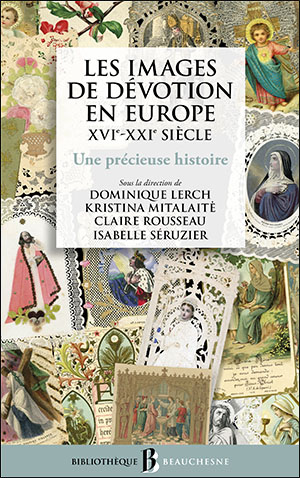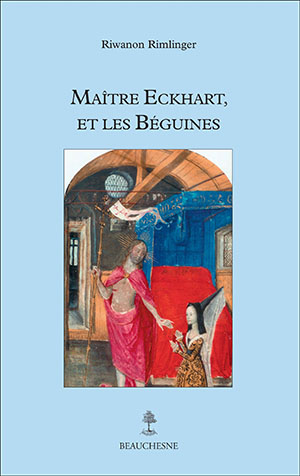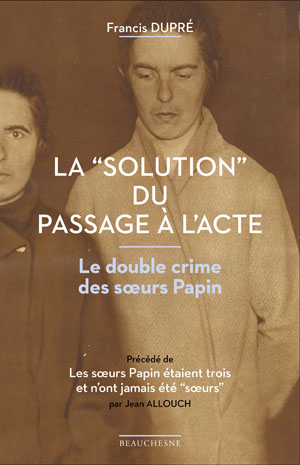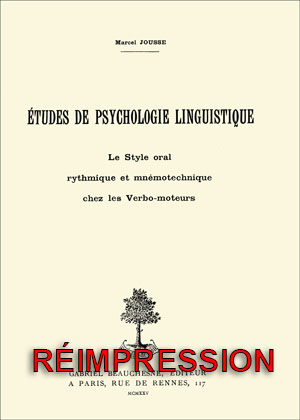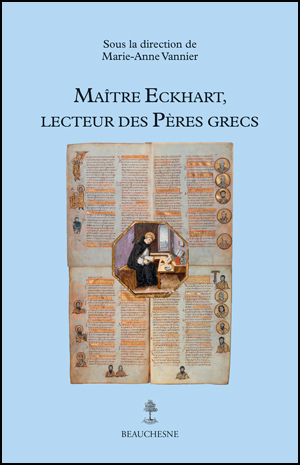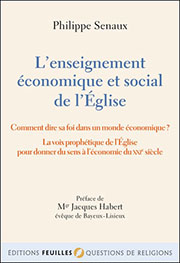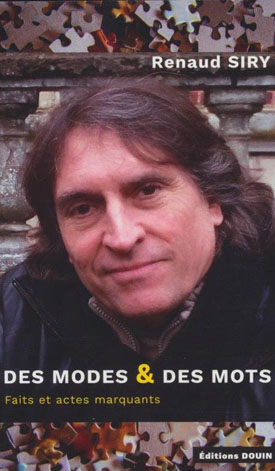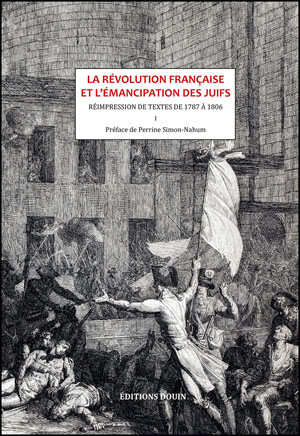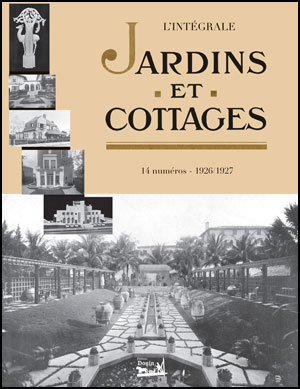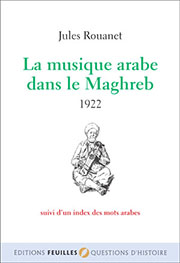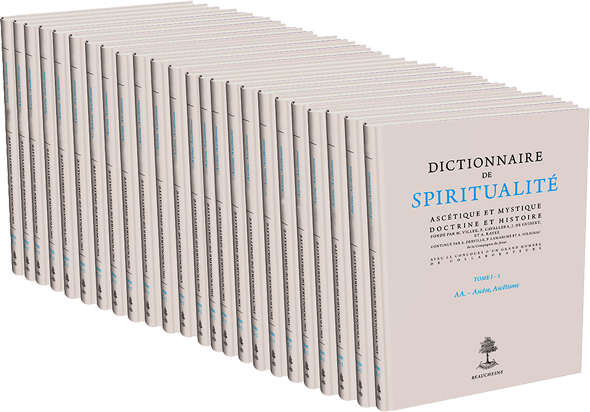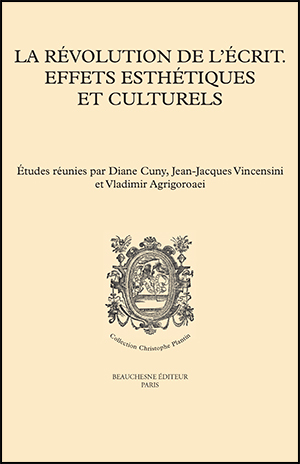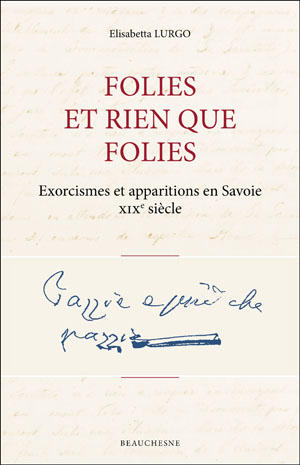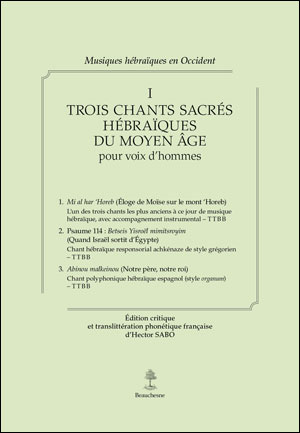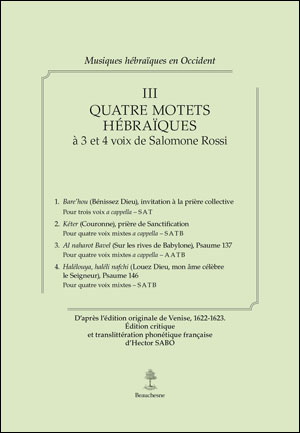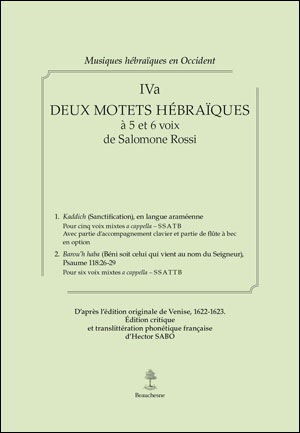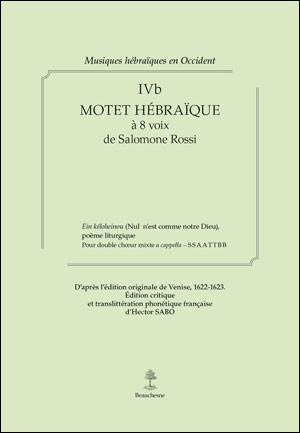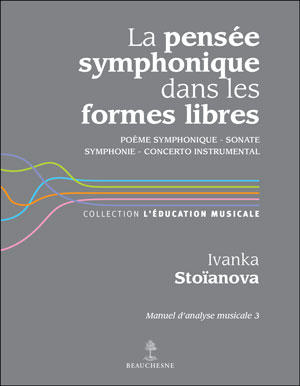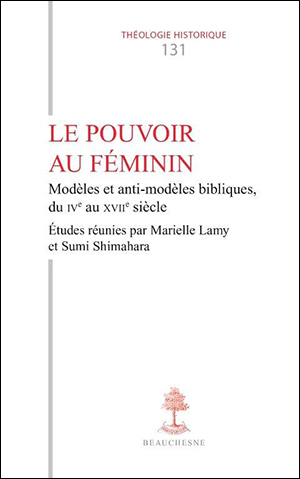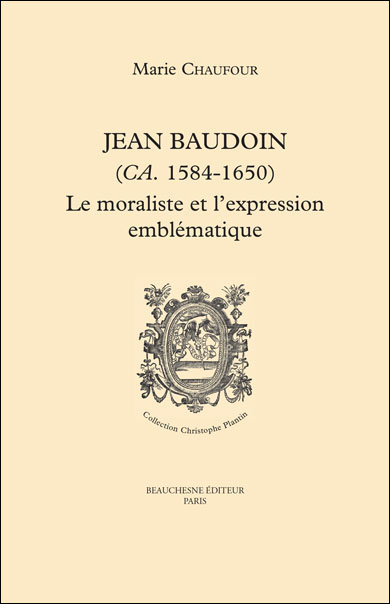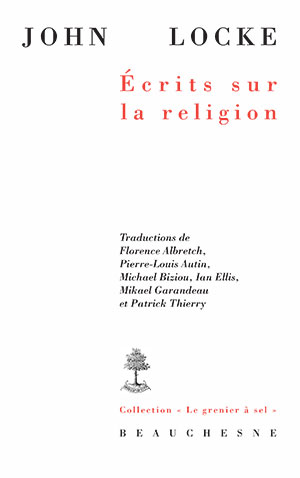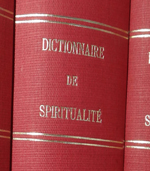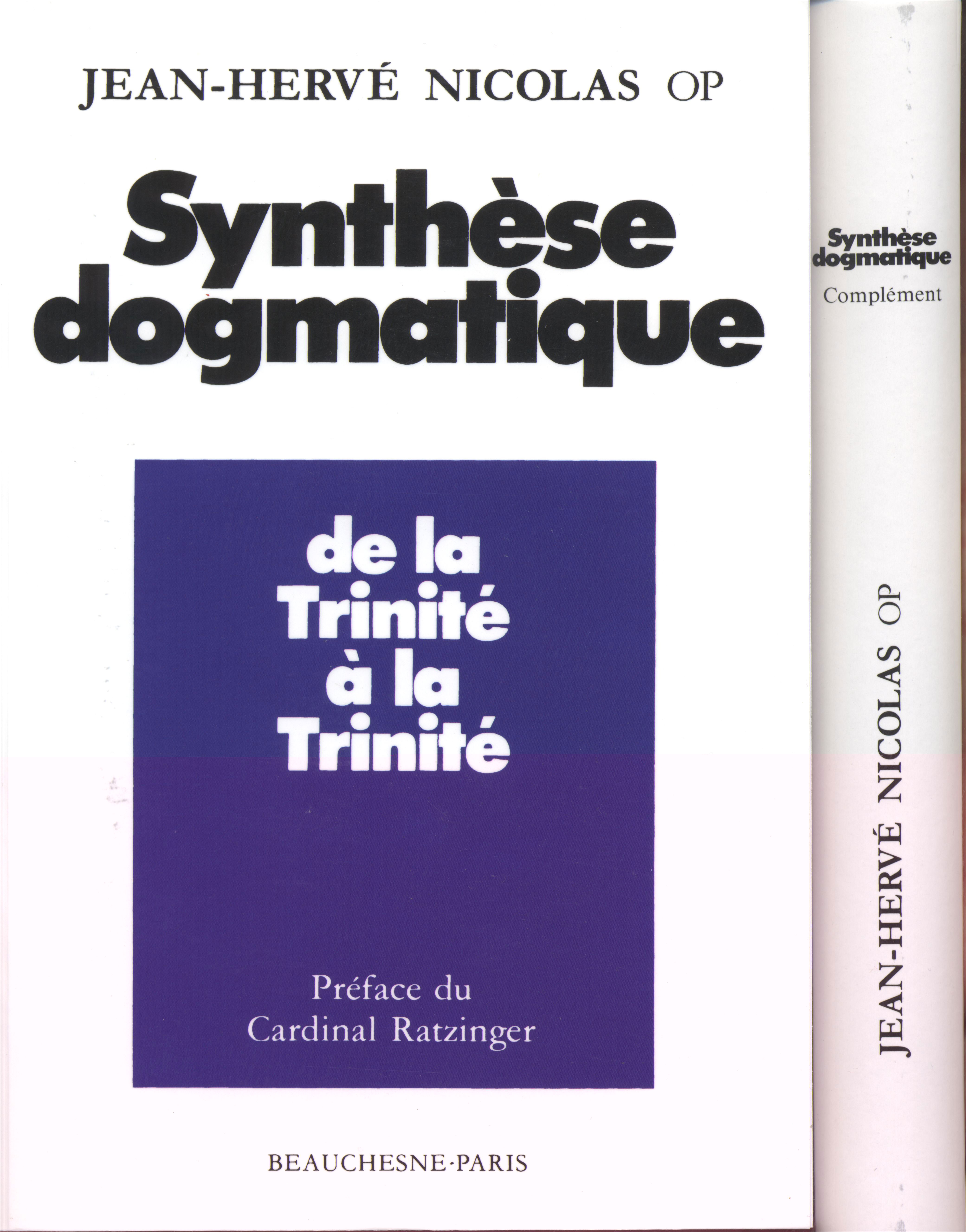0.00 €
PHILOSOPHIE POÉSIE MYSTIQUE
Date d'ajout : mercredi 19 août 2015
par Sr VALLEIX
REVUE : ESPRIT ET VIE n° 17
La faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris propose, tous les deux ans, une série de leçons publiques « susceptibles d'intéresser un public plus vaste que les philosophes de métier ». Elles sont regroupées sous le titre : Philosophie, Poésie, Mystique. La question liminaire de cet ouvrage s'énonce ainsi : « Quel intérêt y a-t-il, pour le philosophe, de se laisser interroger, voire instruire par des discours extra-philosophiques et, plus particulièrement en l'occurrence, par les discours poétiques et mystiques » (p. 5-6). Il faut évidemment éviter toute confusion, il ne saurait s'agir de « philosophie poétique ». Mais « penser le poème est une tâche à laquelle la philosophie ne saurait se dérober » ; elle n'a qu'à recevoir de ce contact avec « l'altérité du discours poétique et du discours mystique » (p. 7). C'est dire que la légitime division du travail ne saurait élever, entre philosophie, poésie et mystique, des barrières infranchissables. C'est par des traits d'union ou par des points de suspension que sont reliés ces trois termes, et il serait contraire à l'essence même de la philosophie que leurs relations soient fixées d'avance. Il s'agit de « fréquentation », peut-être d'échos mutuels, en tout cas d' »entre-écoute » (p. 14).
Maria Villela-Petit part de la formule d'Octavio Paz : « Le poème est poésie et autre chose encore », qu'elle examine comme n'allant pas de soi. Aristote déjà distingue le poète du versificateur. Homère - et non Empédocle - est « le père de toute poésie », « par son art de peindre la figure des héros dans la diversité de leurs caractères et par son pouvoir de configurer une intrigue (muthos) » (p. 16). Ainsi son langage est-il distinct de celui de la philosophie, plus conceptuel ; pour autant il n'est pas impossible de reconnaître les penseurs de l'être ou de la phusis - tel Empédocle comme poètes à part entière.
Pour Octavio Paz, « il n'existe pas de peuples sans poésie » (p. 21). Mais quelle est celle « poésie » qu'est « le poème » ? Elle est, répond Maria Villela-Petit, « cette sorte de grâce qui seule sauve le poème comme poème, c'est-à-dire comme autre chose qu'un discours versifié ou rimé » (p. 22). Le Diotime du Banquet est invoqué et rejoint ici G. Manley Hopkins pour montrer que « la poésie naît d'une surabondance de pensées dans l'âme et sous le signe de l'amour » (p. 24), et qu'elle a à voir avec la révélation de l'unité de toutes choses. Son matériau, le langage, est « la trace ou la marque symbolique de la communauté en nous, marque à travers laquelle nous accédons à l'humain ou le recevons en partage (p. 26). De surcroît, ce matériau est rythme, mesure vivante, qui se traduit « en images et non en concepts » (p. 28). Là encore réside la différence entre poésie et philosophie ; la poésie parle et n'argumente pas. C'est sans doute pourquoi traduire la poésie est aussi impossible qu'indispensable. Car, pour intraduisible qu'elle soit foncièrement, la poésie est « transculturelle », « les poètes se lisent et se reconnaissent par-delà leurs frontières nationales et linguistiques » (p. 32). C'est peut-être cette « universalité » de la poésie - par-delà l'œuvre singulière qu'est le poème - que souligne la formule d'Octavio Paz. L’indicible qui demande à être dit, et que seul le poète pressent, exige de lui qu'il oblige les mots à aller au-delà d'eux-mêmes, qu'il les délie de leurs significations habituelles et convenues. Heidegger, lecteur de Hölderlin, souligne à la fois la parenté et la distance de la poésie et de la pensée, sises sur « deux monts séparés ». Et, selon Maria Villela-Petit, l'accord profond que Heidegger croit avoir établi entre sa pensée et la poésie de Hölderlin relève d'une forme de violence, qui est autant de soustrait à « une véritable compréhension de la pensée du poète » (p. 44). Le poète peut donc donner à penser, mais aucun penseur ne peut le confisquer. C'est sans doute que « la contemplation poétique de l'univers » ne saurait se réduire au concept.
Pierre-Jean Labarrière propose de « chercher à comprendre comment s'entrelacent… ces trois dimensions de la pensée »cchez Michel Deguy (p. 48), indissociablement et distinctement - philosophe et poète. Le terme « mystique » peut être osé concernant Michel Deguy, à condition de ne le référer à aucun « arrière-monde » mais de le prendre comme désignant « un plus que l'homme en l'homme - une surhumanisation de l'humain ». (p. 49). La mort de l'être aimé fait « jeter à tous vents un cri dont nul écho n'est espéré » (p. 49) ; et lever « l'énergie du désespoir ». Il s'agit pour le poète de refuser tout imaginaire compensatoire, toute croyance en une suprématie de la vie sur la mort : « rien en quoi l'esprit… pourrait se réfugier » (p. 51). La seule « vie après la mort » qui soit est celle que mène le sur-vivant, et son seul propos de « surhumanisation » consiste à « s'y faire » : à sa condition de mortel, d'éphémère, pour lequel se délivrer de cette blessure d'absence est inconcevable. Michel Deguy « invite à troquer l'impossible voyage dans les arrière-mondes contre l'aventure aussi abyssale et plus essentielle qui consiste à sonder la profondeur de l'existence commune » (p. 53). Ce qu'il appelle « rapatrier les oxymores divins » dans la contingence de l'histoire, c'est donc retrouver ici-bas « possession et jouissance de ce qui est nôtre par droit d'humanité » (p. 53). C'est ce dont vit le penser poétique, qui consent à l'absence et refuse le leurre des consolations mensongères. Selon P.-J. Labarrière, il n'est pas illégitime de percevoir en cette poétique, lieu d'une « surhumanisation de l'humain », « la résurgence [ ... ] d'une visée mystique » (p. 56). Le poète allemand Ernst Meister écrit que, les dieux étant morts, « il n'y a pas de charge qui ne repose dans sa totalité sur nos seules épaules. La légèreté qui est la nôtre est ce bonheur imprévisible de pouvoir tirer une étincelle de ce qui est tout à fait fini. Cette finitude reste notre infinie propriété ». À quoi fait écho Michel Deguy : « Comprenez-vous qu'il faut de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard changer les livres en notre âme, faire monter dans l'arche toutes les figures, traduire sans relâche les paraboles en poèmes, en citations pour nos circonstances, en entretiens, en ordinaire du jour, traduire dans nos langues les révélations, nous approprier le divin, interpréter l'esprit, et surhumaniser » (p. 60).
Le propos de Jean Greisch s'intitule: « La trace de la trace : entre la langue idolâtre et la langue désencombrée. » Partant du très célèbre aphorisme 125 du Gai Savoir, J. Greisch déploie trois interprétations de la « mort de Dieu » selon Nietzsche : celle de Heidegger, celle de Didier Franck, celle d'Alain Badiou sur laquelle il s'attarde davantage - et vers laquelle la fin de sa leçon reviendra explicitement. Pour Badiou, « celui qui est mort est le Dieu des croyants qui ont cru l'avoir rencontré et qui ont tenté de vivre leur vie en sa présence » (p. 66) ; seul un Dieu qui était vivant - celui de la religion - peut être déclaré définitivement « mort ». Heidegger dira pourtant - formule aporétique selon Alain Badiou - que « seul un Dieu peut encore nous sauver ». Quel est ce Dieu ? Non sans doute celui de la religion ni de la métaphysique. Mais il faut le chercher du côté des poètes, de Hölderlin pour Heidegger. Ce rapport au Dieu poétique n'est, selon Badiou, ni de l'ordre du deuil ni de celui de la critique ; « c'est un rapport nostalgique au sens strict, qui envisage dans la mélancolie les chances d'un réenchantement du monde par l'improbable retour des dieux » (p. 67). Mais l'athéisme de Badiou ne laisse aucune chance au dieu des poètes, voué au même sort que celui des philosophes et celui des croyants. Selon lui, « le poète doit se plier à l'impératif catégorique qui « exige la mise à mort de son propre Dieu » ; il ajoute ce mot d'ordre : « du Dieu de la poésie, il faut que le poème désencombre la langue, en y césurant le dispositif de la perte et du retour. Car nous n'avons rien perdu, et rien ne revient » (p. 68). C'est cette formule que J. Greisch va interroger de façon méticuleuse, en se tournant d'abord vers Hölderlin puis vers Paul Celan (La responsabilité du poète au temps du désastre), donnant de rencontrer conjointement Ossip Mandelstam et Nelly Sachs.
Il faut lire ces analyses attentives et suggestives, il ne saurait être question de les résumer. Ces rencontres conduisent J. Greisch à contester la thèse d'Alain Badiou selon laquelle « la pensée est aujourd'hui sous condition des poètes » (p. 120), c'est-à-dire « prise en otage » par eux, « la philosophie [ … ] livrée à la poésie ». A. Badiou assigne aux philosophes la tâche difficile - de « dé-suturer la philosophie de sa condition poétique » (cette suture risquant d'être mortelle à la philosophie) en même temps qu'il constate que « l'âge des poètes est terminé » (p. 121). J. Greisch questionne à la fois cette tâche et ce constat, et refuse le reproche fait à une philosophie herméneutique de « perpétuer le schème romantique, c'est-à-dire la thèse d'un entrelacement indiscernable du dire du poète et du penser du penseur » (p. 124). À l'encontre de Badiou pour lequel les poèmes de Celan « invitent secrètement le philosophe à occuper la place d'un sujet "sans vis-à-vis" » (p. 125), J. Greisch reprend une autre formule de Celan : « La poésie ne s'impose plus, elle s'expose » (p. 124), et invite le philosophe à la reprendre à son compte, en faisant le pari que « l'écoute des dires irrévocablement autres du mystique et du poète est une des conditions indispensables de sa survie, ce qui ne revient nullement à maintenir une "suture" exclusive entre la philosophie et la poésie » (p. 125).
Nathalie Nabert, spécialiste de littérature spirituelle médiévale, analyse « es dérives de la parole contemplative », montre comment s'élabore une « contemplation affective » et comment « de l'évidement spéculatif à l'infusion divine, l'assomption du silence construit une théorie de la désaffectation des moyens intellectuels et de l'inhabitation divine dans les régions sensibles de l'activité contemplative » (p. 141). Cette construction s'opère par une rhétorique du transfert dont elle répertorie les composantes : transfert des catégories de l'ineffable dans les catégories sensitives de la vision du cœur; transfert des catégories de l'intellect dans celles de l'affectif ; transfert des ténèbres de l'ignorance à l'illumination de la connaissance sur laquelle se fondera la rhétorique nuptiale de la voie unitive. Les traités de contemplation réservent donc au langage un sort paradoxal : incapable de dire l'indicible ou de rendre intelligible l'inintelligible, donc soupçonné sous son mode rationnel, il est par contre sollicité sous le mode de l'amplification poétique. La poétique de la fruition divine, de la fusion, opère « un déplacement du discours contemplatif vers les dérèglements poétiques et les zones synesthésiques des échanges de sensations » (p. 150). C'est précisément ce que N. Nabert perçoit comme « mode déviant et dérive de la parole contemplative » (p. 150).
Pour Henri Meschonnic, « Le poème qui est poème doit transformer la pensée de la pensée ». Son propos est de « penser le poème et de le défendre contre la philosophie » (p. 154), comme aussi « contre l'esthétique», voire contre la poésie elle-même. H. Meschonnic déplore chez les philosophes contemporains la carence d'une théorie du langage et l'incapacité de « penser l'interaction, perdue depuis Aristote, entre la théorie du langage, celle de la littérature et de l'art, l'éthique, le et la politique » (p. 175-76). Selon lui, le conflit entre philosophie et poésie est souvent rendu invisible par les philosophes eux-mêmes ; tel est le cas pour Derrida qui, à la suite de Heidegger, représente une philosophie qui « dévore » la poésie, « se l'incorpore » et « tout en l'adorant parfois, l'annule » (p. 178). La métaphore désormais rebattue de 1'« habitation du monde », la tentative d'une « poéthique », qui lui est liée, relèvent, pour H. Meschonnic, d'une « forme de crime passionnel : l'amour de la poésie, et l'amour de la philosophie de l'amour de la poésie, assassinent la poésie et le poème dans le drapé le plus noble qui soit, et les meilleures intentions du monde » (p. 194). Cette dernière leçon, inscrite sur un arrière-fond culturel très vaste, auquel la référence est constamment allusive, exige de toute évidence des auditeurs - a fortiori des lecteurs - vraiment avertis.
Sr VALLEIX, ursuline
La faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris propose, tous les deux ans, une série de leçons publiques « susceptibles d'intéresser un public plus vaste que les philosophes de métier ». Elles sont regroupées sous le titre : Philosophie, Poésie, Mystique. La question liminaire de cet ouvrage s'énonce ainsi : « Quel intérêt y a-t-il, pour le philosophe, de se laisser interroger, voire instruire par des discours extra-philosophiques et, plus particulièrement en l'occurrence, par les discours poétiques et mystiques » (p. 5-6). Il faut évidemment éviter toute confusion, il ne saurait s'agir de « philosophie poétique ». Mais « penser le poème est une tâche à laquelle la philosophie ne saurait se dérober » ; elle n'a qu'à recevoir de ce contact avec « l'altérité du discours poétique et du discours mystique » (p. 7). C'est dire que la légitime division du travail ne saurait élever, entre philosophie, poésie et mystique, des barrières infranchissables. C'est par des traits d'union ou par des points de suspension que sont reliés ces trois termes, et il serait contraire à l'essence même de la philosophie que leurs relations soient fixées d'avance. Il s'agit de « fréquentation », peut-être d'échos mutuels, en tout cas d' »entre-écoute » (p. 14).
Maria Villela-Petit part de la formule d'Octavio Paz : « Le poème est poésie et autre chose encore », qu'elle examine comme n'allant pas de soi. Aristote déjà distingue le poète du versificateur. Homère - et non Empédocle - est « le père de toute poésie », « par son art de peindre la figure des héros dans la diversité de leurs caractères et par son pouvoir de configurer une intrigue (muthos) » (p. 16). Ainsi son langage est-il distinct de celui de la philosophie, plus conceptuel ; pour autant il n'est pas impossible de reconnaître les penseurs de l'être ou de la phusis - tel Empédocle comme poètes à part entière.
Pour Octavio Paz, « il n'existe pas de peuples sans poésie » (p. 21). Mais quelle est celle « poésie » qu'est « le poème » ? Elle est, répond Maria Villela-Petit, « cette sorte de grâce qui seule sauve le poème comme poème, c'est-à-dire comme autre chose qu'un discours versifié ou rimé » (p. 22). Le Diotime du Banquet est invoqué et rejoint ici G. Manley Hopkins pour montrer que « la poésie naît d'une surabondance de pensées dans l'âme et sous le signe de l'amour » (p. 24), et qu'elle a à voir avec la révélation de l'unité de toutes choses. Son matériau, le langage, est « la trace ou la marque symbolique de la communauté en nous, marque à travers laquelle nous accédons à l'humain ou le recevons en partage (p. 26). De surcroît, ce matériau est rythme, mesure vivante, qui se traduit « en images et non en concepts » (p. 28). Là encore réside la différence entre poésie et philosophie ; la poésie parle et n'argumente pas. C'est sans doute pourquoi traduire la poésie est aussi impossible qu'indispensable. Car, pour intraduisible qu'elle soit foncièrement, la poésie est « transculturelle », « les poètes se lisent et se reconnaissent par-delà leurs frontières nationales et linguistiques » (p. 32). C'est peut-être cette « universalité » de la poésie - par-delà l'œuvre singulière qu'est le poème - que souligne la formule d'Octavio Paz. L’indicible qui demande à être dit, et que seul le poète pressent, exige de lui qu'il oblige les mots à aller au-delà d'eux-mêmes, qu'il les délie de leurs significations habituelles et convenues. Heidegger, lecteur de Hölderlin, souligne à la fois la parenté et la distance de la poésie et de la pensée, sises sur « deux monts séparés ». Et, selon Maria Villela-Petit, l'accord profond que Heidegger croit avoir établi entre sa pensée et la poésie de Hölderlin relève d'une forme de violence, qui est autant de soustrait à « une véritable compréhension de la pensée du poète » (p. 44). Le poète peut donc donner à penser, mais aucun penseur ne peut le confisquer. C'est sans doute que « la contemplation poétique de l'univers » ne saurait se réduire au concept.
Pierre-Jean Labarrière propose de « chercher à comprendre comment s'entrelacent… ces trois dimensions de la pensée »cchez Michel Deguy (p. 48), indissociablement et distinctement - philosophe et poète. Le terme « mystique » peut être osé concernant Michel Deguy, à condition de ne le référer à aucun « arrière-monde » mais de le prendre comme désignant « un plus que l'homme en l'homme - une surhumanisation de l'humain ». (p. 49). La mort de l'être aimé fait « jeter à tous vents un cri dont nul écho n'est espéré » (p. 49) ; et lever « l'énergie du désespoir ». Il s'agit pour le poète de refuser tout imaginaire compensatoire, toute croyance en une suprématie de la vie sur la mort : « rien en quoi l'esprit… pourrait se réfugier » (p. 51). La seule « vie après la mort » qui soit est celle que mène le sur-vivant, et son seul propos de « surhumanisation » consiste à « s'y faire » : à sa condition de mortel, d'éphémère, pour lequel se délivrer de cette blessure d'absence est inconcevable. Michel Deguy « invite à troquer l'impossible voyage dans les arrière-mondes contre l'aventure aussi abyssale et plus essentielle qui consiste à sonder la profondeur de l'existence commune » (p. 53). Ce qu'il appelle « rapatrier les oxymores divins » dans la contingence de l'histoire, c'est donc retrouver ici-bas « possession et jouissance de ce qui est nôtre par droit d'humanité » (p. 53). C'est ce dont vit le penser poétique, qui consent à l'absence et refuse le leurre des consolations mensongères. Selon P.-J. Labarrière, il n'est pas illégitime de percevoir en cette poétique, lieu d'une « surhumanisation de l'humain », « la résurgence [ ... ] d'une visée mystique » (p. 56). Le poète allemand Ernst Meister écrit que, les dieux étant morts, « il n'y a pas de charge qui ne repose dans sa totalité sur nos seules épaules. La légèreté qui est la nôtre est ce bonheur imprévisible de pouvoir tirer une étincelle de ce qui est tout à fait fini. Cette finitude reste notre infinie propriété ». À quoi fait écho Michel Deguy : « Comprenez-vous qu'il faut de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard changer les livres en notre âme, faire monter dans l'arche toutes les figures, traduire sans relâche les paraboles en poèmes, en citations pour nos circonstances, en entretiens, en ordinaire du jour, traduire dans nos langues les révélations, nous approprier le divin, interpréter l'esprit, et surhumaniser » (p. 60).
Le propos de Jean Greisch s'intitule: « La trace de la trace : entre la langue idolâtre et la langue désencombrée. » Partant du très célèbre aphorisme 125 du Gai Savoir, J. Greisch déploie trois interprétations de la « mort de Dieu » selon Nietzsche : celle de Heidegger, celle de Didier Franck, celle d'Alain Badiou sur laquelle il s'attarde davantage - et vers laquelle la fin de sa leçon reviendra explicitement. Pour Badiou, « celui qui est mort est le Dieu des croyants qui ont cru l'avoir rencontré et qui ont tenté de vivre leur vie en sa présence » (p. 66) ; seul un Dieu qui était vivant - celui de la religion - peut être déclaré définitivement « mort ». Heidegger dira pourtant - formule aporétique selon Alain Badiou - que « seul un Dieu peut encore nous sauver ». Quel est ce Dieu ? Non sans doute celui de la religion ni de la métaphysique. Mais il faut le chercher du côté des poètes, de Hölderlin pour Heidegger. Ce rapport au Dieu poétique n'est, selon Badiou, ni de l'ordre du deuil ni de celui de la critique ; « c'est un rapport nostalgique au sens strict, qui envisage dans la mélancolie les chances d'un réenchantement du monde par l'improbable retour des dieux » (p. 67). Mais l'athéisme de Badiou ne laisse aucune chance au dieu des poètes, voué au même sort que celui des philosophes et celui des croyants. Selon lui, « le poète doit se plier à l'impératif catégorique qui « exige la mise à mort de son propre Dieu » ; il ajoute ce mot d'ordre : « du Dieu de la poésie, il faut que le poème désencombre la langue, en y césurant le dispositif de la perte et du retour. Car nous n'avons rien perdu, et rien ne revient » (p. 68). C'est cette formule que J. Greisch va interroger de façon méticuleuse, en se tournant d'abord vers Hölderlin puis vers Paul Celan (La responsabilité du poète au temps du désastre), donnant de rencontrer conjointement Ossip Mandelstam et Nelly Sachs.
Il faut lire ces analyses attentives et suggestives, il ne saurait être question de les résumer. Ces rencontres conduisent J. Greisch à contester la thèse d'Alain Badiou selon laquelle « la pensée est aujourd'hui sous condition des poètes » (p. 120), c'est-à-dire « prise en otage » par eux, « la philosophie [ … ] livrée à la poésie ». A. Badiou assigne aux philosophes la tâche difficile - de « dé-suturer la philosophie de sa condition poétique » (cette suture risquant d'être mortelle à la philosophie) en même temps qu'il constate que « l'âge des poètes est terminé » (p. 121). J. Greisch questionne à la fois cette tâche et ce constat, et refuse le reproche fait à une philosophie herméneutique de « perpétuer le schème romantique, c'est-à-dire la thèse d'un entrelacement indiscernable du dire du poète et du penser du penseur » (p. 124). À l'encontre de Badiou pour lequel les poèmes de Celan « invitent secrètement le philosophe à occuper la place d'un sujet "sans vis-à-vis" » (p. 125), J. Greisch reprend une autre formule de Celan : « La poésie ne s'impose plus, elle s'expose » (p. 124), et invite le philosophe à la reprendre à son compte, en faisant le pari que « l'écoute des dires irrévocablement autres du mystique et du poète est une des conditions indispensables de sa survie, ce qui ne revient nullement à maintenir une "suture" exclusive entre la philosophie et la poésie » (p. 125).
Nathalie Nabert, spécialiste de littérature spirituelle médiévale, analyse « es dérives de la parole contemplative », montre comment s'élabore une « contemplation affective » et comment « de l'évidement spéculatif à l'infusion divine, l'assomption du silence construit une théorie de la désaffectation des moyens intellectuels et de l'inhabitation divine dans les régions sensibles de l'activité contemplative » (p. 141). Cette construction s'opère par une rhétorique du transfert dont elle répertorie les composantes : transfert des catégories de l'ineffable dans les catégories sensitives de la vision du cœur; transfert des catégories de l'intellect dans celles de l'affectif ; transfert des ténèbres de l'ignorance à l'illumination de la connaissance sur laquelle se fondera la rhétorique nuptiale de la voie unitive. Les traités de contemplation réservent donc au langage un sort paradoxal : incapable de dire l'indicible ou de rendre intelligible l'inintelligible, donc soupçonné sous son mode rationnel, il est par contre sollicité sous le mode de l'amplification poétique. La poétique de la fruition divine, de la fusion, opère « un déplacement du discours contemplatif vers les dérèglements poétiques et les zones synesthésiques des échanges de sensations » (p. 150). C'est précisément ce que N. Nabert perçoit comme « mode déviant et dérive de la parole contemplative » (p. 150).
Pour Henri Meschonnic, « Le poème qui est poème doit transformer la pensée de la pensée ». Son propos est de « penser le poème et de le défendre contre la philosophie » (p. 154), comme aussi « contre l'esthétique», voire contre la poésie elle-même. H. Meschonnic déplore chez les philosophes contemporains la carence d'une théorie du langage et l'incapacité de « penser l'interaction, perdue depuis Aristote, entre la théorie du langage, celle de la littérature et de l'art, l'éthique, le et la politique » (p. 175-76). Selon lui, le conflit entre philosophie et poésie est souvent rendu invisible par les philosophes eux-mêmes ; tel est le cas pour Derrida qui, à la suite de Heidegger, représente une philosophie qui « dévore » la poésie, « se l'incorpore » et « tout en l'adorant parfois, l'annule » (p. 178). La métaphore désormais rebattue de 1'« habitation du monde », la tentative d'une « poéthique », qui lui est liée, relèvent, pour H. Meschonnic, d'une « forme de crime passionnel : l'amour de la poésie, et l'amour de la philosophie de l'amour de la poésie, assassinent la poésie et le poème dans le drapé le plus noble qui soit, et les meilleures intentions du monde » (p. 194). Cette dernière leçon, inscrite sur un arrière-fond culturel très vaste, auquel la référence est constamment allusive, exige de toute évidence des auditeurs - a fortiori des lecteurs - vraiment avertis.
Sr VALLEIX, ursuline
Moteur de recherche www.editions-beauchesne.com
Le moteur peut rechercher dans différents champs :
- Un nom d’auteur (AUTEUR)
- Un mot du titre (TITRE)
- Un ISBN
- Un mot du texte de présentation (TEXTE)
- Un mot du sommaire ou de la table des matières (SOMMAIRE).
La recherche dans les champs TEXTE et SOMMAIRE peut être un peu longue.
En cliquant sur un resultat la fiche du livre correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet.
Search engine www.editions-beauchesne.com
The engine can search in different fields:
- An author's name (AUTEUR)
- A word from the title (TITRE)
- An ISBN
- A word from the presentation text (TEXTE)
- A word from the summary or the table of contents (SOMMAIRE).
The search in the TEXTE and SOMMAIRE fields may take some time.
Clicking on a result open the book's sheet in a new tab.